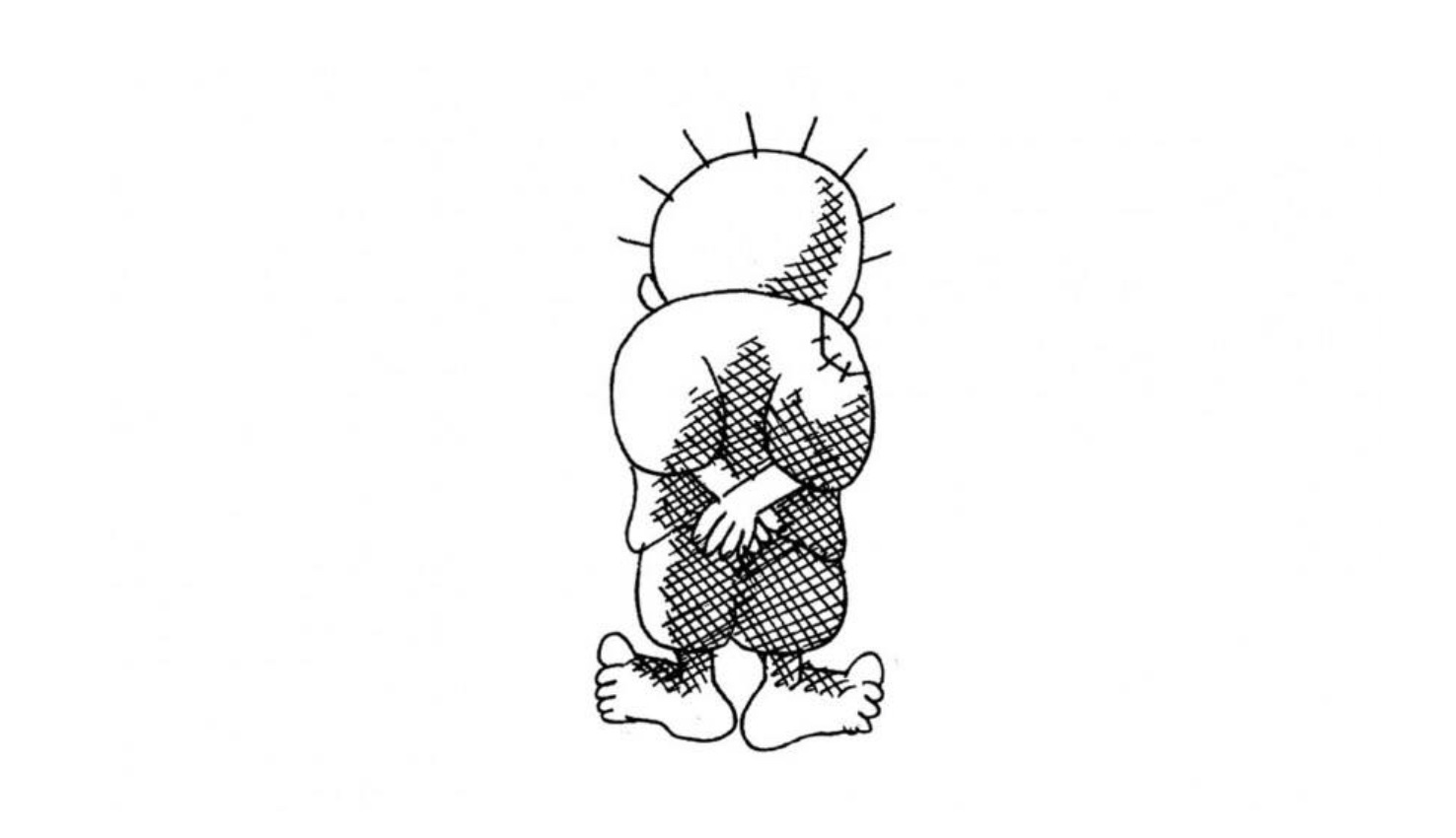Auteur.rice : Déborah BROSTEAUX
Auteur.rice : Déborah BROSTEAUX
Bruxelles, le 31 octobre 2023[1]
Israël/Palestine : nos nœuds indénouables
Les discours politiques qui, en Europe, soutiennent la guerre totale menée actuellement par l’État d’Israël contre le peuple palestinien se réclament inlassablement des leçons du passé, de la mémoire de la Shoah, du cri « plus jamais ça ». La tentation est grande de réduire ces mises en lien à une simple rhétorique venant instrumentaliser la mémoire de la Shoah au profit des logiques d’une guerre impérialiste. Mais chercher à écarter simplement cette référence à la Shoah ne fait que miner davantage le terrain. Et de toute façon elle revient toujours : ce lien ne peut être écarté. Il demande alors à être réarticulé.
Je parlerai ici des affects de celles et ceux qui, en Europe, héritent à la fois des crimes nazis et des crimes coloniaux. Qui sont, comme c’est mon cas, les enfants de celles et ceux qui se sont taillés une place dans le monde en récoltant les fruits des occupations et des pillages coloniaux, et tout à la fois les enfants de celles et ceux qui vivaient ici même, en Europe, lorsque des millions de juifs ont été raflés, déportés et assassinés, et qui s’en sont rendus complices, ou n’ont pas su l’empêcher. La guerre, et les massacres en cours à Gaza, sont, comme on le sait, intimement liés à cette double histoire européenne : l’histoire de la colonisation européenne et le génocide des juifs d’Europe. Sans la violence inouïe de l’histoire européenne, pas d’Israël/Palestine, en tout cas pas sous la forme tragique et sanglante en cours depuis 75 ans. Ce nœud est présent partout, nous y sommes empêtrés jusqu’au cou, et il vient miner jusqu’à notre langage – le rendant littéralement assourdissant.
De nombreuses voix issues de la diaspora juive de gauche se sont élevées, et ce de diverses manières, contre l’instrumentalisation de la mémoire de la Shoah au service de l’alliance des États occidentaux avec les guerres coloniales d’Israël[2] : s’opposant à ce qu’un tel soutien se fasse au nom des souffrances de leur peuple ; refusant la silenciation de la pluralité des voix juives, et la réduction à un statut de victimes désincarnées « au nom desquelles » les pouvoirs politiques se sentent en droit de s’exprimer ; dénonçant l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme comme faire-valoir des politiques islamophobes ; déconstruisant l’assimilation de la judéité au sionisme, ou encore la construction fictive d’une perspective juive unique incarnée par l’État israélien. Des voix cherchent à réarticuler la lutte contre l’antisémitisme à une perspective décoloniale. Ces voix, pour minoritaires qu’elles soient, sont nombreuses et multiples et devraient suffire à couper court à la rhétorique selon laquelle soutenir l’occupation israélienne serait l’unique manière de s’acquitter de la dette européenne envers les juifs.
Mon but ici n’est pas de déconstruire ce récit politique – nous n’en avons pas besoin, l’intensité des rassemblements pour la Palestine témoigne, dans nos rues, que nous ne croyons pas à cette rhétorique – mais plutôt d’essayer de comprendre ce qu’il performe. Car se contenter ici de dissiper les fictions, de déconstruire les arguments fallacieux, amènerait à se méprendre au sujet des dynamiques affectives dont se nourrissent les logiques de guerre actuelles. Cette capture politique de la mémoire de la Shoah puise sa source dans des liens profonds – des liens qui se retrouvent captés, filtrés, canalisés, déviés et déversés dans un arsenal discursif majoritaire mis au service de la guerre totale contre le peuple palestinien. Ces discours ne sont pas les nôtres, mais ils nous parlent de nous. Ils nous soudent au massacre d’un peuple, tout en nous confrontant à la question de savoir comment reprendre au présent le cri « plus jamais ça » – comment ne pas l’abandonner entre des mains meurtrières. La seule chose que nous pouvons leur accorder, c’est qu’effectivement, cette histoire est loin d’être derrière nous.
Captures guerrières de la mémoire de la Shoah : le cas de l’Allemagne
Pour suivre dans le détail les manières dont opèrent, ici en Europe, ces captures affectives, je vais me focaliser dans ce qui suit sur la situation en Allemagne. C’est là bien sûr que le travail de mémoire face aux crimes du nazisme a été le plus nécessaire. C’est là aussi que s’opère aujourd’hui la capture la plus forte de la mémoire de la Shoah dans le soutien à la guerre meurtrière menée par Israël. Et c’est également en Allemagne que vit l’une des plus larges communautés palestiniennes d’Europe, à qui le droit à la mémoire, celle de la Nakba et de sa perpétuation, est refusé[3].
Dans la grande majorité des médias allemands, le soutien à Israël et le filtrage des informations et des affects est drastique, unilatéral, sans rapport de force ou contre-point. Alors que les bombes s’abattent depuis 25 jours[4] sur les hommes, femmes et enfants de Gaza, faisant plus de 8000 morts, 1,4 millions de déplacés, des milliers de bâtiments rasés – maisons, écoles, hôpitaux, universités, mosquées –, que l’aide humanitaire est massivement bloquée, que les hôpitaux n’ont plus les moyens de soigner les blessés, un silence de mort pèse dans la presse allemande. Presqu’aucun article sur ce qui se passe à Gaza, on peine à y trouver jusqu’aux chiffres des morts et des blessés. Sans parler de faire entendre des voix palestiniennes. Dans la presse allemande, le monde semble s’être arrêté après les attaques du Hamas du 7 octobre. L’armée israélienne semble, dans la plupart des articles, faire la guerre à un monde sans civil. La majorité des manifestations pro-Palestine sont interdites sur le sol allemand, et qualifiées de « manifestations de haine antisémite ». Et cela est bien sûr motivé, justifié article après article, discours après discours, par le devoir allemand de racheter les crimes nazis[5].
L’adhésion à la guerre d’anéantissement menée contre la population de Gaza est soutenue ici par un silence massif autour du massacre en cours. Massacre qui se retrouve justifié dans le geste même qui l’occulte. Cette occultation dit tout l’effort pour ne pas voir, pour ne pas se sentir concerné, qui doit ici être mis en œuvre pour pouvoir continuer à revendiquer cette impossibilité, érigée en principe, d’un soutien aux Palestiniens au nom de la dette allemande envers les juifs. Une telle perspective, pour pouvoir se soutenir elle-même, doit s’emmurer très concrètement, bâtir des murs de silence et multiplier les angles morts de manière à cadrer ce qui sera pris en compte et ce qui sera écarté, tu, minimisé et dévalué. Cette manière de répartir entre les vies dignes d’être pleurées et les vies qui ne comptent pas – soutenue sous les mots par la répartition coloniale entre les barbares et les civilisés – fait, comme l’a montré Judith Butler[6], profondément partie des dynamiques de la guerre.
Le profond tunnel médiatique et politique qui se creuse actuellement en Allemagne a, bien sûr, une histoire. Si, au cours des années que j’ai passées en Allemagne, j’ai rarement entendu de prise de position directe en faveur des politiques coloniales d’Israël, le silence autour de la Palestine, lui, est palpable, il s’observe et se sent : une manière de ne pas en faire un sujet. Ce silence répond à des mécanismes précis. Le théoricien de la culture Klaus Theweleit par exemple – qui a plaidé de manière puissante, dans les années 1970, pour la nécessité d’écrire l’histoire des corps allemands afin de cerner, sous le calme apparent de la paix démocratique retrouvée, les passions fascistes qui continuaient de couver – réclamait avec force ce silence dans les années 1990 : après le génocide des juifs d’Europe, la seule attitude décente des Allemands vis-à-vis d’Israël ne peut être, écrit-il, qu’une attitude de soutien – ou a minima ajoute-t-il, pour celles et ceux qui en seraient incapables, une attitude de silence et de retrait[7]. Au fond de cette exigence de silence, il y a une véritable paralysie, un effroi réel à la perspective de prendre position contre les violences d’un État dont la raison d’être est directement liée aux crimes de l’Allemagne. Il y a le désir, pour beaucoup profond et sincère, de ne plus jamais adopter de position politique pouvant être liée à des violences endurées par des juifs. Dans la séquence actuelle, après les massacres du Hamas, cette paralysie et cette intériorisation à la fois du devoir de soutien, et de silence sur les effets de ce soutien, est à son comble.
Mon but ici n’est sûrement pas de plaider contre cette inquiétude – vivifiée par la conscience que l’antisémitisme, enfoui mais jamais éteint, connaît aujourd’hui, sous l’impulsion de l’AfD (le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne), un nouvel éveil parmi les blancs d’Allemagne. Je voudrais par contre affirmer que le geste qui consiste, pour faire droit et soutenir cette inquiétude, à se barricader « quoi qu’il en coûte » dans un devoir coupable érigé en impératif catégorique abstrait, refusant de s’engager dans le concret des situations qu’il contribue pourtant à créer, échoue de manière radicale, tant affectivement, éthiquement, que politiquement. Ce que dit le cri « soutien inconditionnel à Israël et à ses guerres au nom de la mémoire de la Shoah », c’est la recherche désespérée d’une position à l’abri de tout reproche, un abri pour la mauvaise conscience, depuis lequel elle n’aura plus jamais de nouveaux comptes à rendre. Or cet abri n’existe pas, ne peut exister. Nous en perdons toute capacité à répondre de nos propres positionnements et de leurs effets, multipliant les complicités et les dénis afin de nous y endiguer plus fermement. À combien de victimes palestiniennes s’élève le prix de ce rachat de la conscience allemande et, plus largement, européenne ?
Le cri « plus jamais ça » est né face aux chapes de silence et de déni qui entouraient le génocide des juifs d’Europe dans les années d’après-guerre. Ce cri partait du constat que les forces qui ont rendu possible le nazisme continuaient, bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à distiller leur poison dans les veines de l’Europe. Le travail qu’il a enclenché présente au moins deux dimensions. D’une part, un travail de mémoire : rassembler les traces, constituer des archives, rassembler les témoignages des survivants et des morts. Analyser, aussi, les modalités propres aux crimes de masse nazis, ainsi qu’à la Shoah plus spécifiquement : faire l’histoire de cette violence dans sa spécificité, dans son caractère non fongible, interchangeable avec aucune autre. D’autre part, il exigeait aussi, pour celles et ceux qui héritaient de ces crimes, de se rendre attentifs aux mécanismes plus larges qui les ont rendus possible. C’est le cri qu’on entend dans le texte de Jean Cayrol, à la fin de Nuit et brouillard, en pleine guerre d’Algérie :
Et il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s’éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire, nous qui feignons de croire que tout cela est d’un seul temps et d’un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous et qui n’entendons pas qu’on crie sans fin[8].
C’est également le cri d’Aimé Césaire, dans son Discours sur le colonialisme, qui s’en prend à l’idée selon laquelle la barbarie du nazisme ne se comprendrait que comme rupture radicale avec la civilisation européenne. Il faut au contraire, écrit Césaire, resituer cette explosion de haine raciale au cœur de l’Europe comme l’aboutissement d’un long processus d’ensauvagement du continent, qui plonge directement ses racines dans la violence coloniale, et qui continue à s’y perpétuer :
On s’étonne, on s’indigne. On dit : « Comme c’est curieux ! Mais, bah ! C’est le nazisme, ça passera ! » Et on attend, et on espère ; et on se tait à soi-même la vérité, que c’est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries […][9].
Le cri « plus jamais ça » est ici refus de faire des crimes nazis un chapitre clos de l’histoire, placés dans une parenthèse qu’on pourra s’empresser de refermer. Il demande que nous nous rendions capables de vigilance à l’égard de nous-mêmes, que nous apprenions à voir et à articuler au présent les multiples ramifications de la violence raciale qui parcourent l’histoire occidentale, et la multiplicité des formes que peut prendre le désastre.
Revenons à l’actualité de la mémoire de la Shoah en Allemagne : au printemps 2023, la revue progressiste juive américaine Jewish Currents consacrait une analyse aux devenirs, sous certains aspects très problématiques, des politiques contemporaines de mémoire allemandes. Les auteur·e·s de l’article « Bad Memory[10] », s’appuyant sur l’ouvrage récemment paru Subcontractors of Guilt de l’anthropologue Esra Özyürek[11], se penchent sur les programmes éducatifs tournés vers la mémoire de la Shoah qui se retrouvent inclus dans les politiques d’intégration ciblant les communautés de migrants arabes et musulmans. Ce travail de conscientisation, compris comme un rite d’intégration à la conscience nationale, attend des communautés issues de l’émigration post-coloniale qu’elles prennent part à la culpabilité allemande. Pourtant, en visitant les lieux de mémoire du génocide, les personnes qui participent à ces programmes sont régulièrement parcourues par un autre sentiment, un autre type d’effroi : « est-ce qu’ils pourraient en venir à nous faire cela à nous aussi ? » Ces réactions affectives, par lesquelles certains migrants d’Allemagne se sentent moins proches des bourreaux repentis que des victimes potentielles, sont généralement perçues comme des émotions déplacées, « n’ayant pas leur place ici », et comme le signe d’une incapacité à s’intégrer en Allemagne.
Rendre actif ici le cri « plus jamais ça » impliquerait de prendre au sérieux cette peur, d’y répondre avec une profonde inquiétude, de se demander comment on en vient à pactiser ici avec une exclusion raciale, et de s’interroger sérieusement sur les menaces qu’elle renferme. Le cri « plus jamais ça » implique de se sentir, non pas coupable, mais compromis : comme l’écrivait Primo Levi au sujet de la capacité à ressentir la honte, cette attention aux compromissions est une manière de ne pas tourner le dos, de ne pas se rendre complice en refusant de voir, d’écouter, de se sentir atteint :
Il en est, cependant, qui, devant la faute d’autrui, ou leur propre faute, tournent le dos, pour ne pas la voir et ne pas s’en sentir atteints : c’est ce qu’ont fait la majorité des Allemands pendant les douze années hitlériennes, dans l’illusion que ne pas voir c’était ne pas savoir, et que ne pas savoir les soulageait de leur part de complicité ou de connivence[12].
Être capable de ressentir la honte au sens de Levi, c’est sentir les dangers que les migrants interrogés par Esra Özyürek nous désignent, prendre au sérieux ce que ces mises en lien nous racontent ; les signaux qui relient entre elles les violences passées, présentes, à venir.
Tours et détours de la haine raciale
La séquence que nous traversons révèle à quel point ces peurs sont justifiées. Les massacres du Hamas servent, partout en Occident, de prétexte au déversement d’une haine islamophobe frénétique. Dans les médias allemands, les affects de la droite extrême circulent sans obstacle à travers la presse traditionnellement socio-démocrate, et dans les discours officiels du Parti social-démocrate d’Allemagne à la tête de la coalition gouvernementale. Au milieu de cela, capturée, déformée, brandie comme caution, comme légitimation, la mémoire de la Shoah.
Ainsi, dans un long entretien paru le 20 octobre dans le Spiegel[13], le chancelier Olaf Scholz commence par assurer le devoir allemand de soutien inconditionnel à Israël face aux crimes du Hamas, crimes eux-mêmes rapprochés de la Shoah. L’entretien passe alors à la nécessité de combattre l’antisémitisme sur le sol allemand, présenté, au prix d’une torsion supplémentaire… comme un produit d’importation introduit par les migrants musulmans. Et il continue ensuite longuement sur la nécessité de renforcer le contrôle aux frontières allemandes, et de déporter plus rapidement et efficacement les sans-papiers. D’une pierre, deux coups : c’est la conscience blanche réconciliée avec elle-même : « les vrais garants de la lutte contre l’antisémitisme, c’est nous »… et ce, tout en faisant de l’œil aux électeurs de l’AfD. Ce qu’illustre la manœuvre d’Olaf Scholz, ce qu’on voit se dessiner si clairement lorsqu’on parcourt les médias allemands, mais qui traverse aussi la Belgique, la France… c’est les tours et détours particulièrement retors d’une mauvaise conscience qui cherche à se disculper, et finit par transférer sur d’autres le sens de sa propre complicité, jusqu’à parvenir au point où on peut déclarer en toute impunité : « les vrais résistants au nazisme, c’est nous ! » Tours et détours également de la haine raciale, dans lesquels on entend presque une sorte de défi, voire même de promesse : « nous voulons bien faire amende honorable pour les juifs, mais nous ne lâcherons pas notre haine islamophobe ». Qui ce langage cherche-t-il à rassurer ?
Prenons pour l’exemple un reportage du Spiegel paru le 13 octobre[14], parti à l’assaut de musulmans à interroger dans les petits commerces de Neuköln à Berlin. Parmi les personnes rencontrées, beaucoup sont des Palestiniens en exil. Tout au long de l’article, le moindre propos de colère vis-à-vis d’Israël est taxé purement et simplement de haine antisémite. Avec un message clair qui transparaît dans tout le texte : l’Allemagne, garante de la défense du peuple juif, doit faire face à cette invasion sur son propre sol d’une barbarie antisémite venue du dehors.
L’article s’arrête lourdement sur l’enregistrement audio du Coran qui passe dans une boutique ; sur le poster, accroché à un mur, de la mosquée Al-Aqsa de Jerusalem, à côté du portrait de Yasser Arafat ; sur la fréquence du prénom « Mohammad » – même les hommes, insiste-t-il, qui s’appellent autrement demandent à se faire appeler « Mohammad » ; insistance, encore, sur les cils artificiels et le voile d’une femme. Sans surprise, l’unique question qui taraude la journaliste, Katrina Elger, est : « condamnez-vous les crimes du Hamas ? » Mais ce que pourraient avoir à lui dire les personnes qu’elle assaille ainsi ne l’intéresse aucunement. Les personnes interrogées multiplient les tentatives d’esquive : un homme lui assure qu’il déteste le Hamas et la félicite pour la liberté d’opinion allemande, tout en lui expliquant qu’il « n’est pas désireux d’engager la conversation sur le sujet » ; alors qu’Elger demande à un autre homme « s’il ne se sent pas peiné pour les victimes du Hamas, qui pour beaucoup avaient son âge ? », l’ami qui l’accompagne finit par lui lancer dans un rire jaune : « réponds juste que tu trouves cela terrible quand des personnes innocentes meurent » ; et une femme choisit d’ignorer la question des victimes israéliennes du Hamas pour demander en retour « Où étaient nos soutiens lorsque des Israéliens ont massacré des Palestiniens ? Ils l’ont fait souvent. » Il ne semble pas venir à l’esprit de la journaliste que ces esquives ont sans doute bien moins à voir ici avec une haine dissimulée pour les juifs, qu’avec la conscience du chausse-trappe évident qu’elle ne cesse de leur tendre, et dans lequel elle semble s’être elle-même enfermée. Les paroles réitérées des personnes interrogées sur les enfants victimes des bombardements à Gaza, sur les souffrances des Palestiniens privés d’eau, de nourriture et d’électricité, sur l’importance de resituer l’attaque du Hamas comme une réaction aux violences auxquelles les Palestiniens sont sujets depuis 75 ans : tout cela est mis par Elger sur le compte d’une crédulité pour les fake news de TikTok et d’Instagram véhiculées en langue arabe (lourde insistance d’Elger sur ce dernier point), sur le compte, je la cite, du « récit victimaire », et d’une absence d’empathie nourrie à l’antisémitisme. Et enfin vient, pour clôturer l’article, la question, assénée telle une sentence : « [Mohammad] n’a-t-il pas réalisé, à son arrivée en Allemagne, que cette dernière a une responsabilité spéciale envers Israël, issue du meurtre par les nazis de 6 millions de juifs ? »
La journaliste peut rentrer chez elle avec ses trophées, ayant récolté avec succès cette absence d’empathie pour les victimes israéliennes du Hamas, sur laquelle elle semblait tant compter, de la part des Palestiniens et plus largement des musulmans de Neuköln. Ce qui semble lui échapper, c’est la part active qu’elle vient de jouer, elle et la quasi entièreté du discours public allemand, dans cet impossible entremêlement des tristesses. Elle leur a refusé toutes leurs nuances, a nié tous leurs deuils, les a rendus littéralement inaudibles, a brutalisé chacune de leurs colères, et il est évident qu’une telle entreprise ne laisse rien ni personne indemne. Arielle Angel, rédactrice en chef de la revue Jewish Currents, dans un texte paru le 12 octobre dans lequel elle se demande « [c]omment pleurer publiquement la mort et la souffrance des Israélien·nes sans que nos sentiments soient métabolisés contre les Palestiniens ? » formule, depuis la place des juifs pro-palestiniens au sein de la gauche, cette spirale de déshumanisation en ces termes :
Je sais que j’ai beaucoup d’amis, et que Jewish Currents a de nombreux lecteur·rice·s, qui se demandent comment faire partie d’une gauche qui semble considérer la mort d’Israélien·ne·s comme un mal nécessaire, sinon souhaitable, de la libération palestinienne. Mais ce que nous rappelle l’Exode, c’est que la déshumanisation nécessaire à l’oppression et l’occupation d’un peuple déshumanise toujours, aussi, celui qui l’opprime.
Si certain·e·s sentent que leur douleur est dépréciée, c’est parce qu’elle l’est : c’est la marque d’une spirale de dévalorisation de la vie humaine. Comme le dit la géographe abolitionniste [des prisons et de la police, ndlt] Ruth Wilson Gilmore : « Là où la vie est précieuse, la vie est précieuse »[15].
« Plus jamais ça » : multiplier les prises
Dans Les Blancs les Juifs et nous, Houria Bouteldja résumait ainsi les opérations par lesquelles les Blancs en viennent à se laver les mains de la Shoah en transférant leur culpabilité : « partager la Shoah, la diluer, déraciner Hitler, le déménager chez les peuples colonisés et au final, blanchir les Blancs[16] ». Tout en analysant, dans les termes de l’ensauvagement des indigènes, les manières dont l’antisémitisme se déplace lui aussi, s’emparant des siens, elle affirmait avec force dans son livre, à l’adresse des Blancs : Hitler est votre ombre, votre honte, et non la nôtre.
Il y a un véritable enjeu à reprendre cette adresse lancée aux Blancs. Que faisons-nous de cette ombre et de cette honte ? Comment en faire autre chose que cette mauvaise conscience dont le propre est de chercher à se disculper, aux termes de tours de passe-passe et de transferts hideux ? Quel sens donner aujourd’hui au cri « plus jamais ça », en tant qu’il nous engage vis-à-vis des enfants des survivants de la Shoah ? Quel sens donner à ce cri, quand il est repris de toutes parts comme un cri de guerre ; quand la mémoire de la Shoah se retrouve surarmée (au moment où j’écris ces lignes, l’ambassadeur israélien vient de se présenter au Conseil de l’ONU avec une étoile jaune frappée des mots « Never Again ») ?
Ce qui est sûr, comme le dit Volia Vizeltze dans sa « Lettre d’un juif français de gauche, à qui veut bien l’entendre[17] », c’est que la gauche pro-palestinienne fait une erreur en abandonnant, trop souvent, ce cri à l’ennemi. Rabattre purement et simplement l’histoire de l’État d’Israël sur son histoire coloniale, en considérant comme aujourd’hui négligeable l’état de violence et de dévastation absolue d’où a émergé, pour des millions de juifs, la nécessité de son émergence est, du point de vue d’une politique des affects, une erreur. Que les choses soient claires : nous n’avons en la matière aucune leçon à donner aux Palestiniens. C’est depuis notre propre perspective, depuis la place qu’occupe notre province Europe dans cette guerre et son histoire, que nous devons articuler ce nœud indénouable, mêler les histoires pour aussi espérer démêler les poisons qu’elles sécrètent.
La disproportion des morts et des destructions est immense, et faire comme si cela ne comptait pas est un déni terrible. Elle n’efface pas pour autant l’entremêlement des peurs et des tristesses, qui portent avec elles leurs histoires. Les massacres du 7 octobre ont bel et bien ravivé, pour beaucoup de juifs israéliens et de la diaspora, la mémoire des pogroms. Des synagogues ont été attaquées ou ont dû prendre la décision de fermer, des événements culturels juifs ont été annulés, les dispositifs policiers autour des écoles juives sont renforcés. Il faut faire en nous et parmi nous de la place pour ces peurs, pour les entendre et les prendre au sérieux, une place qui refuse de céder le terrain aux cris de guerre omniprésents et assourdissants qui surarment ces affects, et les entraînent dans les dynamiques d’une guerre totale qui ne protège personne. Ces affects sont réels, et ils sont justifiés. Ne pas parvenir à leur faire de la place, c’est demeurer prisonnier des captures affectives dans lesquelles cette guerre tend à enfermer tout le monde. Face aux massacres du Hamas, nous avons eu la force de refuser les rhétoriques selon lesquelles « comprendre, c’est justifier », avec leurs injonctions à ne pas penser, à ne pas articuler. Il me semble important de ne pas se laisser prendre à cette même rhétorique, à l’œuvre notamment quand on refuse de comprendre et de reconnaître le désir de sécurité qui attache de nombreux juifs à l’État d’Israël[18], sous prétexte que cela reviendrait à justifier les logiques guerrières et coloniales qui capitalisent sur cette peur. Je vois bien à quel point il est, ici à nouveau, impossible d’adopter une perspective à l’abri de tout reproche : car il est tout aussi vrai que l’État d’Israël est, dans son acte de naissance même, colonial. La Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël coïncide avec la Nakba. Ce lien est indénouable – ce qui n’a pas empêché de nombreux acteurs des deux camps, et de nombreuses organisations internationales, de travailler depuis des décennies à la possibilité d’une réconciliation et d’une juste cohabitation.
Le cri « plus jamais ça » arraché à l’ennemi exige, autrement dit, de multiplier les prises sur les nœuds indénouables dans lesquels nous nous retrouvons engagés. Cela implique d’en tirer, non pas un impératif moral abstrait, mais une force affective qui résiste aux perspectives qui se bâtissent telles des îles ou des bunkers, et qui nous rend capable d’articuler les modalités multiples de la violence raciale qui traversent notre histoire, et dans lesquelles nous sommes plus que jamais empêtrés.
- [1] L’élaboration de ce texte doit beaucoup aux réflexions et aux explorations médiatiques menées en commun avec Renaud-Selim Sanli. Je tiens aussi à remercier l’équipe de l’ARC pour le suivi éditorial, et tout particulièrement Mona Malak pour ses retours et sa confiance. Merci également à Jumanah Bawazir et Omar Ferwati pour les précieux échanges, et à Guillermo Kozlowski pour sa lecture. Bien entendu, les perspectives défendues dans ce texte n’engagent que son autrice.
- [2] Voir notamment : de nombreux articles du Jewish Current, [en ligne] https://jewishcurrents.org/ ; l’ouvrage de Judith Butler Parting Ways: Jewishness and the Critic of Zionism, New York, Columbia University Press, 2013 ainsi que son article « The Compass of Mourning », in London Review of Books, vol. 45 n°20, octobre 2023, [en ligne] https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n20/judith-butler/the-compass-of-mourning?fbclid=IwAR1jvdury4d7L6HtaYfeppt2XvARy6PEaN3lZSeq7wiWHJEF5T5cKbVs-EU ; la tribune « Frappes sur Gaza : Vous n’aurez pas le silence des juifs de France », signé par 85 personnalités juives, in Libération, octobre 2023, [en ligne] https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/frappes-sur-gaza-vous-naurez-pas-le-silence-des-juifs-de-france-20231031_LJEAHTHDXNFPHJGGTG6NRHDHII/?fbclid=IwAR1MByQ1J7qRI1awlXOGsPx_qBg2ElEYliDUGsTcA3xxDkwNOdbP7hztj0A ; les communiqués de Tsedek! Collectif juif décolonial, dont [en ligne] https://tsedekdecolonial.wordpress.com/?fbclid=IwAR1pgaeUUN_ay1kIg9yv-J835Q-GRLIWEcQGPV6ShH2ZV3316FnvPGa50D0 ; les articles de l’UPJB dont « L’État d’Israël ne nous représente pas », octobre 2023, [en ligne] https://upjb.be/manifestation-22-10/.
- [3] Deux articles à ce sujet : « ‘Complete censorship’: Germany’s Palestinian diaspora fights crackdown », in Aljazeera, 26 octobre 2023, [en ligne] https://www.aljazeera.com/features/2023/10/26/complete-censorship-germanys-palestinian-diaspora-fights-crackdown ; « Germany’s anti-Palestinianism is escalating », in Aljazeera, 10 juin 2023, [en ligne] https://www.aljazeera.com/opinions/2023/6/10/palestinians-should-not-have-to-pay-for-german-sins.
- [4] À l’heure où j’écris ces lignes, soit le 31 octobre 2023.
- [5] À titre d’exemples : « Deutschland muss Israel beistehen », in Der Spiegel, 13 octobre 2023, [en ligne] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/terror-der-hamas-deutschland-muss-israel-beistehen-a-a8dda55b-e5a4-4c2c-9dc8-6693487f57a0 ; « An der Seite unserer Freunde zahlen wir an ihre Feinde », in Die Welt, 14 octobre 2023, [en ligne] https://www.welt.de/kultur/plus247917108/Deutschland-und-Israel-An-der-Seite-unserer-Freunde-zahlen-wir-an-ihre-Feinde.html ; « Haben sie das Mitgefühl verlernt? », in Die Zeit, 25 octobre 2023, [en ligne] https://www.zeit.de/2023/45/hamas-terror-aktivisten-diskussion-mitgefuehl.
- [6] Voir Butler Judith, « What is the value of Palestinian lives? », Edward Said Memorial Lecture, Washigton DC, 2014, [en ligne] https://autonomies.org/2023/10/judith-butler-what-is-the-value-of-palestinian-lives/?fbclid=IwAR37JHGOabk3wCJCjEnc8Jz0hylvmonGGFhHUA0g27Hkkv6Qri32DHBN-bA ; ainsi que Frames of War. When Is Life Grievable ?, Londres/New York, Verso, 2009.
- [7] Theweleit Klaus, « Neues und Altes vom Brennenden Busch zum Golfkrieg », in Das Land, das Ausland heißt, Munich, Dtv, 1995, p. 74.
- [8] Resnais Alain, Nuit et Brouillard, 1955.
- [9] Césaire Aimé, Discours sur le colonialisme (1950), Paris, Présence africaine, 2004, p. 12 sq.
- [10] Dische-Becker Emily, Ratskoff Ben, Rothberg Micheal, Zimmerer Jürgen, « Bad Memory » in Jewish Current, printemps 2023, [en ligne] https://jewishcurrents.org/bad-memory-2.
- [11] Özyürek Esra, Subcontractors of Guilt. Holocaust Memory and Muslim Belonging in Postwar Germany, Redwood City, Standford University Press, 2023.
- [12] Levi Primo, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, p. 84.
- [13] « Interview with German Chancellor Olaf Scholz : “We Have to Deport People More Often and Faster” », in Spiegel Online International, 20-10-2023, [en ligne] https://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-chancellor-olaf-scholz-we-have-to-deport-people-more-often-and-faster-a-790a033c-a658-4be5-8611-285086d39d38.
- [14] « Hate on the Streets of Berlins « I Actually Don’t Like Hamas, But… » », in Spiegel Online International, 13-10-2023, [en ligne] https://www.spiegel.de/international/germany/the-mood-on-the-berlin-streets-i-actually-don-t-like-hamas-but-a-ee0ebdc3-eade-4915-92a0-5f69653e287a.
- [15] Angel Arielle, « Nous ne traverserons pas tant que nous ne nous portons pas entre nous », traduit de l’anglais par Sarah Benichou & Arno Soheil Pedram, 18-10-2023, in Blog Mediapart, [en ligne] https://blogs.mediapart.fr/jewish-currents-version-francaise/blog/181023/nous-ne-traverserons-pas-tant-que-nous-ne-nous-portons-pas-entre-nous?fbclid=IwAR3Rpk4SBCSgFMYlfVI5l2efw3sChgJKRcyFPT-obmarwuyeohTsV7Ngu8M ; parution originale « We Cannot Cross Until We Carry Each Other », in Jewish Currents, [en ligne] https://jewishcurrents.org/we-cannot-cross-until-we-carry-each-other.
- [16] Bouteldja Houria, Les Blancs, les Juifs et nous, Paris, La Fabrique, 2016, p. 57.
- [17] Vizeltzer Volia, « Lettre d’un juif français de gauche, à qui veut bien l’entendre », 28-10-2023, in Blog Mediapart, [en ligne] https://blogs.mediapart.fr/volia-vizeltzer/blog/281023/lettre-d-un-juif-francais-de-gauche-qui-veut-bien-entendre.
- [18] Voir à ce sujet Dann Naomi, « Revolutionary Love, Revolutionary Heartbreak », recension de Les Blancs, les Juifs et nous de Houria Bouteldja, printemps 2018, in Jewish Currents, [en ligne] https://jewishcurrents.org/revolutionary-love-revolutionary-heartbreak. Un article qui, au passage, fait la preuve qu’en dehors de l’hystérisation des débats en France, il est tout à fait possible d’entrer dans une discussion critique sérieuse avec ce livre sans que cela n’implique de noyer son autrice sous des procès d’intention fallacieux.