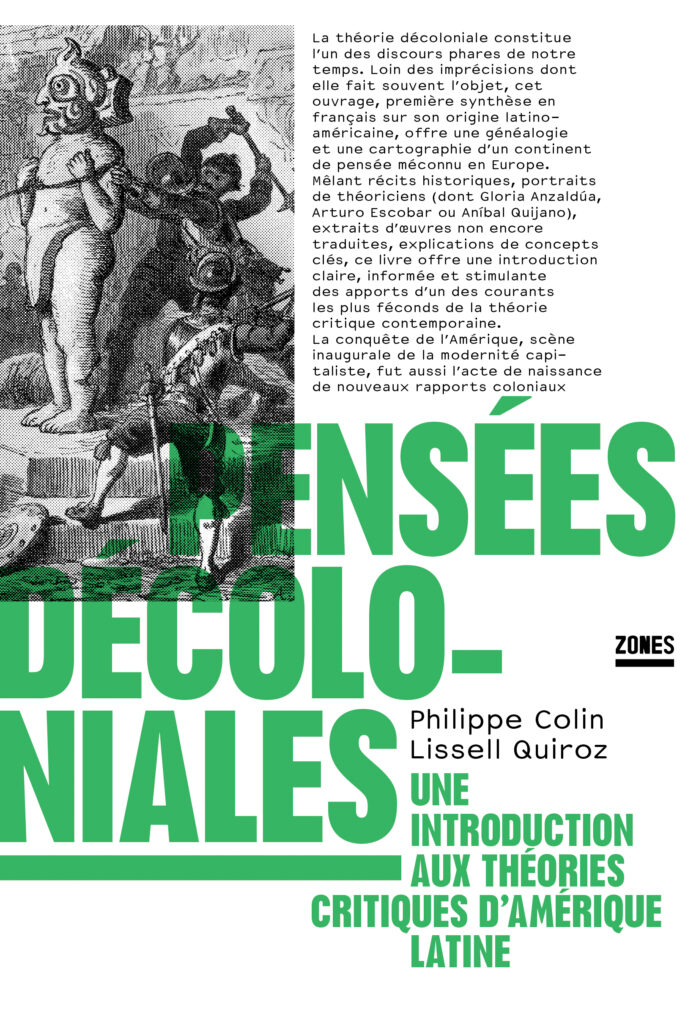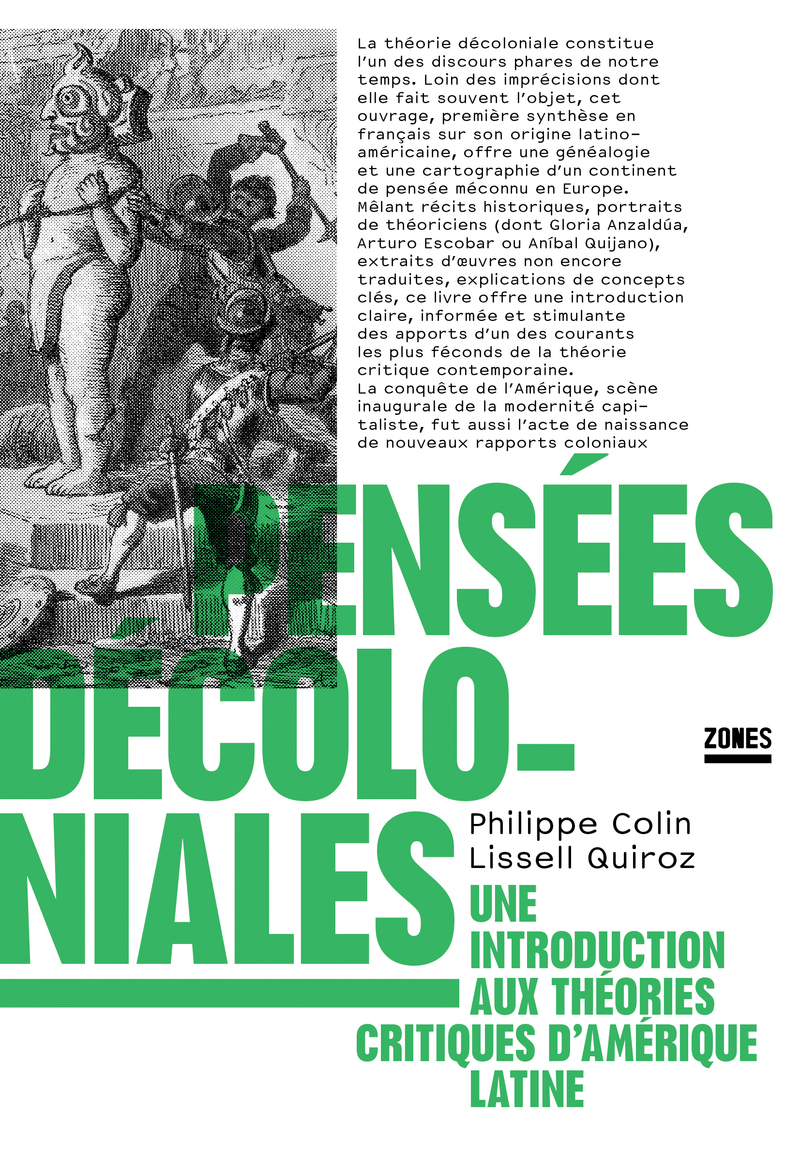Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine offre l’une des premières présentations synthétiques en français de ce courant intellectuel. Il permet de la sorte de mieux connaître et comprendre ce « collectif d’interprétation », et d’en faire une analyse critique.
La maison d’édition Zones vient de publier Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine, qui offre une présentation synthétique en français de ce courant intellectuel, dont nombre de concepts se sont diffusés en Europe et ailleurs [1]. Cet essai permet de se dégager quelque peu de la confusion, des imprécisions et des effets de mode pour appréhender cet ensemble d’analyses.
Plutôt qu’une école de pensée, les théories coloniales s’apparentent, selon les auteurs, à un « collectif d’interprétation », qui a mis en avant une série de concepts-clés, au premier rang desquels celui, forgé par le sociologue péruvien Anibal Quijano (1928-2018), de « colonialité du pouvoir ». Par-là, il entend définir des rapports coloniaux de domination qui vont au-delà de la période coloniale.
L’enjeu est d’opérer un déplacement vers ce qui a été occulté et dénié, en prenant au sérieux la richesse des expériences vécues par les « sujets qui ont résisté à la colonialité » (page 13). D’où l’intérêt pour le marronage, les communautés indigènes et l’ambition de renouer avec des traditions, des savoirs, des imaginaires que la raison occidentale a tenté de détruire.
L’un des principaux mérites de ce livre est de retracer la généalogie – et, à travers elle, la cartographie – des théories décoloniales. Les 500 ans de la « découverte » de l’Amérique en 1992 constituent un marqueur du développement de ce courant de pensées, qui se structurera quelques années plus tard autour du « programme de rechercher sur la modernité/colonialité » (page 107). Plus globalement, ces théories s’inscrivent dans le contexte de l’effondrement de l’URSS, de la défaite des processus révolutionnaires en Amérique centrale et de l’effacement du marxisme et de la question sociale dans le champ académique et intellectuel.
Au niveau universitaire, les théories décoloniales s’ancrent dans le prolongement des Cultural et Subaltern studies, dans la critique post-coloniale et, plus spécifiquement, dans le débat entre Anibal Quijano et Immanuel Wallerstein autour de l’analyse du système-monde à la lumière du concept de colonialité. Mais ce « collectif d’interprétation » plonge également ses racines dans certains courants intellectuels latino-américains.
Ainsi en va-t-il de l’œuvre de José Carlos Mariategui (1895-1930). Le marxiste hétérodoxe péruvien, en rompant avec la lecture mécanique et évolutionniste du marxisme traditionnel, affirme la coexistence et même la collusion de modes de productions et d’institutions précapitalistes – dont l’esclavage – et capitalistes. Dès lors, la violence exacerbée de l’accumulation primitive ne constitue pas la préhistoire du capitalisme, mais bien une forme moderne toujours à l’œuvre ; tout particulièrement dans les pays du Sud. Et cette violence qui a codifié et régulé les relations entre colonisés et colonisateurs, continue à « organiser la distribution inégale des ressources et des droits à toutes les échelles de la vie sociale » (page 139).
Les auteurs insistent également sur la reprise de certains aspects des théories de la dépendance, faisant du développement et du sous-développement, non « des moments distincts d’un processus évolutif », mais « les deux pôles d’un même système asymétrique et hiérarchisé de production et d’échange » (page 72). Et de montrer les liens entre les théories décoloniales et postcolonialisme, ainsi que ce qui les distingue. Plutôt que sur l’après du colonialisme, les premières sont en effet centrées sur sa permanence, sur ces continuités souterraines qui travaillent en profondeur, jusqu’à aujourd’hui, les sociétés latino-américaines ; bref sur la production et la reproduction continue des rapports coloniaux, comme forme de pouvoir.
Philippe Colin et Lissell Quiroz présentent en outre des « élargissements théoriques et militants » des pensées décoloniales : elles ont nourri la critique du tourisme et du développement, ainsi que l’écologie et le mouvement féministe latino-américain [2]. Mais cet « élargissement » semble assez lâche : les théories décoloniales prolongent – plus qu’elles innovent – l’écologie politique et l’analyse critique de la logique touristique [3]. Quant au féminisme, elles paraissent surtout renforcer et confirmer l’ancrage dans les résistances locales et continentales.
Le développement est défini par Arturo Escobar, l’un des théoriciens phares du décolonial, comme « l’une des technologies centrales de la colonialité du pouvoir » (page 217). Il est cependant étonnant que, pour illustrer sa thèse, il s’appuie sur le processus de spoliation et d’accaparement des terres dans la région du Choco en Colombie, qui ne relève guère du champ du développement. D’autant plus que la référence au processus des communautés noires (PCN) – en effet emblématique –, pour original qu’il soit, se positionne en termes d’« un choix de développement » et non de post-développement (page 225).
Dans cet ouvrage, les théories décoloniales, ce « paradigme théorique incontournable » selon les auteurs, sont présentées plus que véritablement discutées. Il est dommage que les critiques adressées à ces pensées ne soient pas évoquées, ne fusse que très sommairement [4]. Nous voudrions palier partiellement ce défaut, en nous centrant principalement sur la critique décoloniale de l’eurocentrisme et de la modernité et la proposition de « politique du lieu ».
LE FÉTICHE DE LA MODERNITÉ
Les théoricien·nes décoloniaux·ales ont avancé le concept de « lieu d’énonciation » afin de mettre en avant l’ancrage géohistorique de toute connaissance (page 163). Il est dès lors étrange que le lieu principal à partir duquel leurs théories se sont développées, à savoir les prestigieuses universités états-uniennes, centres de la modernité néolibérale, soit maintenu hors-champ. C’est d’ailleurs l’un des principaux reproches de la sociologue bolivienne Silvia Rivera Cusicanqui, qui n’hésite pas à dénoncer une captation du travail théorique du Sud, reformulé pour correspondre à une « politique économique » du savoir au Nord, sous le masque décolonial [5].
Mais, c’est surtout la critique décoloniale de la modernité eurocentrée qui pose question. Le principal apport de ce « collectif d’interprétation » tient peut-être dans la mise en évidence qu’il opère entre modernité et violence coloniale. Ce nouage est au cœur de leurs théories. Walter Mignolo affirme ainsi que « la colonialité est constitutive de la modernité » (Mignolo, cité page 141). Or, ce double phénomène serait le marqueur d’un eurocentrisme, qui « constitue, pour la critique décoloniale, la forme spécifique du savoir produite par la modernité/colonialité » (page 157).
Le « paradigme européen de la connaissance rationnelle » est pour Quijano « une composante d’une structure de pouvoir qui impliquait la domination coloniale sur le reste du monde » (Quijano, cité page 141). Au niveau philosophique, l’emprise eurocentrique des savoirs modernes/coloniaux dessinerait, selon Enrique Dussel, un rapport particulier au monde : l’ego conquiro, qui préfigure le cogito cartésien (page 133). D’où la volonté de rompre « avec les traditions de pensée eurocentrée, considérées comme complices de la domination historique de l’Occident » (page 78) et de revaloriser les « autres formes de rapport au monde » (page 41). Et Dussel de chercher à ouvrir l’« horizon culturel au-delà de la modernité ». Pour ce faire, il a avancé le concept de « transmodernité », à même d’offrir des « solutions radicalement inconcevables au sein de la seule culture moderne » (pages 187-189).
Cette tentative de dépassement de la modernité butte cependant sur la double conceptualisation de la modernité et de l’eurocentrisme. Les deux concepts tendent à se confondre au prisme décolonial, sans qu’aucun, pour autant, ne soit jamais clairement défini. Plus exactement, ils se prêtent à des définitions élastiques et contradictoires. S’agit-il de démonter l’idéologie, la « mystification historique » (Dussel), le « récit autobiographique » (Escobar) de la modernité ? L’emprise de l’eurocentrisme sur celle-ci ? Ou bien la modernité elle-même ?
Et, dans ce dernier cas, à quoi correspond la modernité ? À « toute la philosophie occidentale de Kant jusqu’à Habermas (…) inséparable d’une rhétorique de l’innocence et de la supériorité » (Dussel, page 138) ? À « la philosophie de l’histoire d’Hegel [qui] constitue l’expression idéologique la plus aboutie de ce projet de ‘totalisation totalitaire’ entrepris par la modernité occidentale depuis le XVIe siècle » (Dussel, page 93) ?
Dussel évoque les deux faces de la modernité européenne – « un visage rationnel et émancipateur (…) et, de l’autre côté de la différence coloniale, un visage irrationnel et dominateur » (page 135) –, appelant à l’incorporation « du meilleur de la Modernité » (page 189). De son côté, Mignolo écrit que la pensée décoloniale n’est pas seulement l’apanage des sujets colonisés : « les intellectuels et activistes du ‘Nord global’ qui, en abdiquant toute position de surplomb épistémologique ou normative, s’engagent dans un dialogue transfrontalier horizontal avec les groupes se situant dans la ‘zone du non-être’, peuvent eux aussi contribuer au démantèlement de l’entreprise mythique de la modernité occidentale » (page 183).
Mais ces appels sonnent faux et tombent à plat. Faute d’avoir défini la modernité – ses courants, contradictions et visages – pour s’en tenir à un rejet aussi global qu’élastique, répété au fil des pages et des livres, on voit mal ce qui constituerait le « meilleur » de la modernité, son visage « émancipateur ». Conséquence logique, la pensée moderne est condamnée en bloc ; doublement condamnée : en tant que moderne et en tant qu’eurocentrée. Il y a ici une tautologie : ces traditions de pensée seraient modernes parce que nées en Europe et eurocentrées car représentant la modernité.
Les philosophies romantiques européennes antimodernes ou critiques de la modernité, l’anti-hégélianisme d’Emmanuel Lévinas, dont Dussel s’inspire, les tentatives de dépassement de la modernité participeraient, elles aussi, de la pensée moderne eurocentrée ? Hobbes ou Foucault, Descartes ou C. L. R. James : même combat. Celui d’un moi occidental conquérant et colonisateur. La modernité serait ainsi ce bloc intact, anhistorique et monolithique, identique à elle-même au cours de ce demi-millénaire.
Par ailleurs, la temporalité de la critique de l’eurocentrisme n’est-elle pas quelque peu décalée à l’heure où s’affirme un monde multipolaire et où la superpuissance chinoise tend à « provincialiser l’Europe » [6] ? Les assises de l’eurocentrisme ne sont-elles pas autrement (et heureusement) plus déstabilisées que par le passé – et que ne le supposent les théories décoloniales ? L’Europe n’est-elle pas (largement) sous l’influence – politique, économique, culturel – des États-Unis [7] ? À titre d’exemple, depuis que ce classement existe, ce sont essentiellement des universités états-uniennes – dont celles où donnent des cours plusieurs des théoriciens décoloniaux –, qui occupent les quinze premières places du classement de Shanghai [8].
De plus, au cours de la dernière décennie, la Chine est passée devant le continent européen pour devenir le deuxième partenaire commercial de l’Amérique latine et des Caraïbes. En 2020, le continent a exporté pratiquement sept fois plus (en valeur monétaire) de minéraux vers la Chine que vers l’Europe. Il est révélateur que la présence chinoise, ainsi que les nombreuses questions qu’elle soulève, passe totalement sous les radars des théories décoloniales.
DÉCONNEXION DES LUTTES
Paradoxalement, le décolonial reproduit et redouble l’eurocentrisme qu’il prétend critiquer. Il met en effet en avant une modernité qui n’aurait pas, au cours des siècles, été impactée et reconfigurée par des pensées non-occidentales. L’Amérique latine aurait subi et résisté à la modernité/colonialité sans jamais y contribuer activement. Et les maux seraient dû uniquement à cette modernisation coloniale ; les traditions préexistantes étant essentialisées et idéalisées.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle « le patriarcat et le genre sont des inventions occidentales qui ont été transplantées en Amérique après l’invasion européenne » (page 206) ne paraît pas découler d’un travail anthropologique ou historique, mais bien d’une posture idéologique – critiquée d’ailleurs par divers courants féministes latino-américains –, se refusant de prendre acte du système patriarcal préexistant à la colonisation dans une partie des communautés indigènes [9].
Cela revient à faire peu de cas des « théories voyageuses » conceptualisées par Edward Saïd, et ignorer la manière dont le « voyage » dans un autre territoire, un autre contexte, permet une réappropriation et reconfiguration de la théorie, par lesquelles de nouvelles significations émergent. Comme si les traditions existantes et les communautés indigènes n’avaient « rien à voir avec l’histoire et le processus européens » [10]. Et réciproquement.
Le biais d’une telle analyse est particulièrement flagrant dans l’absence de référence et d’analyse consacrée à la révolution haïtienne de 1804 : première nation libre noire, issue d’un soulèvement populaire d’anciens esclaves. Ce bouleversement est un double marqueur des deux visages de la modernité, en ce que cette révolution participe des promesses d’émancipation de la pensée moderne ; une pensée qu’elle reconfigure en nouant traditions et modernité : les insurgés haïtiens se revendiquaient à la fois du vaudou et de la Révolution française. Or, cette source fondatrice du monde moderne n’a eu de cesse d’être occultée et niée dans l’alliage de la modernité, du capitalisme et de l’eurocentrisme [11].
En ne menant pas le combat au sein même du champ moderne, en passant à côté des forces non occidentales qui ont contribué à bâtir la modernité [12], la théorie décoloniale est forcée de trouver une solution du côté de sujets miraculeusement préservés des rapports modernes. Le dépassement postulé de la modernité se réduit dès lors à une fuite en avant théorique, déconnectée d’une critique du capitalisme – celui-ci étant un sous-produit de la modernité – et des luttes. Elle tend à se réduire, en dernière analyse, à une affirmation identitaire – le sujet colonisé (et peu importe finalement que celui-ci soit professeur d’université aux États-Unis, femme indigène au Chiapas ou ministre d’un gouvernement latino-américain) – et au déploiement d’une rhétorique décoloniale [13].
D’où la myopie analytique de la théorie décoloniale, incapable ou se refusant à distinguer entre la dénonciation du colonialisme par des forces autoritaires, voire réactionnaires, pour asseoir leur domination, et celle d’acteurs et actrices porteurs·euses d’un projet émancipateur. D’où aussi les multiples « errements » et « glissements », comme le soutien (retiré par la suite) de Mignolo à un théoricien indien de la droite dure, qui soutenait l’hégémonie hindoue, et appelait à se décoloniser pour se libérer des valeurs d’égalité et de liberté eurocentristes [14].
D’où, enfin, par effet miroir, la tendance à méconnaître et à dévaloriser les luttes en Occident (reproduisant par-là même vis-à-vis des pays occidentaux ce que ces théories condamnent à juste titre dans l’eurocentrisme par rapport aux expériences et à l’histoire latino-américaines). Ainsi, pour mieux distinguer le féminisme décolonial de celui des femmes « blanches », urbaines et bourgeoises, Philippe Colin et Lissell Quiroz écrivent que les luttes de ces dernières « trouvent en effet naturellement [c’est nous qui soulignons] leur place, en termes d’agenda, de grammaire militante et de périodisation (féminisme par vagues successives), au sein du grand récit intra-occidental de l’émancipation des femmes » (pages 199-200).
À l’heure où le droit à l’avortement est remis en question, où le féminicide et les violences genrées, en général, continuent de se déployer, affirmer la place « naturelle » des luttes des femmes dans le « grand récit intra-occidental » revient à confondre le mythe du progrès et la réalité. C’est plutôt le contrepied de cette affirmation qu’il faut prendre : ce n’est que par effraction que les luttes féministes (et aussi ouvrières) se sont fait une place – une place fragmentaire et toujours menacée – dans la modernité capitaliste.
Si les théories décoloniales sont déconnectées des luttes sociales en Occident, elles ne sont pas pour autant plus ou mieux connectées à celles en Amérique latine. De l’insurrection zapatiste de 1994, au Chiapas, aux récentes mobilisations féministes, en passant par les soulèvements populaires en Haïti, en Colombie, en Équateur et au Chili [15], et les mouvements anti-extractivistes, l’enjeu principal de ces combats ne relève que de loin et partiellement de la modernité eurocentrée.
Dans Les Damnés de la terre, Frantz Fanon analysait la dynamique par laquelle le peuple met en avant, « au fur et à mesure du déroulement de la lutte », le processus qui oblige les acteurs colonisés à « abandonner le simplisme » initial des slogans et à « déracialiser » leur combat pour l’inscrire dans la dynamique des rapports sociaux.
« Le peuple, qui au début de la lutte avait adopté le manichéisme primitif du colon : les Blancs et les Noirs, les Arabes et les Roumis, s’aperçoit en cours de route qu’il arrive à des Noirs d’être plus blancs que les Blancs. (…) « cette découverte [est] désagréable, pénible et révoltante (…) que le phénomène inique de l’exploitation peut présenter une apparence noire ou arabe ». Et de poursuivre : le peuple « crie à la trahison, mais il faut corriger ce cri. La trahison n’est pas nationale, c’est une trahison sociale ».
En-deçà de cette intensification de la lutte, on en reste au « manichéisme primitif du colon : les Blancs et les Noirs, les Arabes et les Roumis », « à la clarté idyllique et irréelle » du simplisme, aux « carnaval et flonflons » [16]. Reste à savoir de quel côté de la lutte se situent les théories décoloniales. Leur prétention, implicite ou explicite, de décoloniser les théoriciens et théoriciennes de l’anticolonialisme, par trop encore modernes et « blancs », témoigne aussi du déplacement du terrain de la lutte : de la conflictualité sociale aux champs culturel et académique.
DÉPASSER LA MODERNITÉ
« Chercher des alternatives à la modernité n’implique pas d’être antimoderne » écrit Edouardo Gudynas, l’un des principaux théoriciens latino-américains du postextractivisme. Il s’agit plutôt de dialoguer avec les apports de la modernité et, en fonction de ceux-ci, de les accepter, de les reformuler ou de les abandonner. Ou de leur désobéir [17]. Cette liberté sauvage s’avère autrement plus pertinente et stimulante que la fausse alternative d’une pensée moderne à prendre ou à rejeter en bloc.
Dépasser la modernité demeure une ambition légitime. Elle implique un détour plutôt qu’un retour au prémoderne. Mais, comme le disait Walter Benjamin, toutes les traditions passées ne sont pas à sauver. La révolution haïtienne, en s’appropriant et en radicalisant la promesse moderne de liberté et d’égalité, a esquissé ce dépassement. Un dépassement vite hypothéqué et retourné, et qui s’inscrit dans des luttes émancipatrices et dans le renversement du capitalisme.
NOTES
[1] Philippe Colin, Lissell Quiroz, Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine, Zones, Lonrai, 2023, https://www.editionsladecouverte.fr/pensees_decoloniales-9782355221538. Sauf mentions contraires, toutes les citations proviennent de cet ouvrage.
[2] Notamment le collectif bolivien fondé en 1992 Mujeres creando : https://mujerescreando.org/.
[3] Voir par exemple le manifeste récemment publié, « Por una Transición Energética Justa y Popular », https://pactoecosocialdelsur.com/manifiesto-de-los-pueblos-del-sur-por-una-transicion-energetica-justa-y-popular-2/. Voir également Alternatives Sud, L’urgence écologique vue du Sud, XXVII-2020, n°2, Cetri-Syllepse ; Alternatives Sud, La domination touristique, XXV-2018, n°3, Cetri-Syllepse.
[4] Pour un aperçu synthétique de ces critiques, voir Damián Pachón Soto, « Qué hacer con el legado moderno ? Las críticas a las teorías decoloniales », 2 octobre 2022, https://intervencionycoyuntura.org/que-hacer-con-el-legado-moderno-las-criticas-a-las-teorias-decoloniales/. Je reprends ici une partie de son argumentaire.
[5] Silvia Rivera Cusicanqui, « Ch’ixinakax utxiwa : A Reflection on the Practices and Discourses of Decolonization », The South Atlantic Quarterly, Winter 2012, http://www.adivasiresurgence.com/wp-content/uploads/2016/02/Silvia-Rivera-Cusicanqui-Chixinakax-Eng1.pdf.
[6] Sur cette question, lire Sivamohan Valluvan et Nisha Kapoor, « Sociology after the postcolonial : Response to Julian Go’s ‘thinking against empire’ », The British Journal of Sociology, janvier 2023, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1468-4446.12995.
[7] À moins d’inclure les États-Unis dans l’eurocentrisme, ce qui rendrait le concept plus lâche.
[8] Il ne s’agit pas de valider ce classement ni les critères, emprunts des principes néolibéraux, à la base duquel il est fait, mais de remarquer le décentrage européen par rapport aux idéaux dominants de cette modernité.
[9] Damián Pachón Soto, Ibidem.
[10] Damián Pachón Soto, Ibidem.
[11] Frédéric Thomas, « Le double défi haïtien : perspectives croisées depuis les sciences sociales sur Haïti », Cetri, 9 mai 2023.
[12] Lire à ce propos le passionnant entretien de la revue pakistanaise, Jamhoor, avec Priyamvada Gopal : « Empire and its Enemies : A Conversation with Priyamvada Gopal », Jamhoor, 8 août 2022, https://www.jamhoor.org/read/empire-and-its-enemies-a-conversation-with-priyamvada-gopal.
[13] Sivamohan Valluvan et Nisha Kapoor, Ibidem.
[14] Sivamohan Valluvan et Nisha Kapoor, Ibidem.
[15] Alternatives Sud, Soulèvements populaires, XXVII-2020, n°4, Cetri-Syllepse.
[16] Frantz Fanon, Les Damnés de la terre dans Œuvres, Paris, La Découverte, 2011, pages 536-539.
[17] Eduardo Gudynas, « Críticas y alternativas ante la Modernidad en América Latina », Palabra salvaje, 15 décembre 2022, http://palabrasalvaje.com/2022/12/criticas-y-alternativas-ante-la-modernidad-en-america-latina/.
L’expérience coloniale et décoloniale latino-américaine
Dans leur ouvrage paru récemment, Pensées décoloniales (éd. Zones), Lissell Quiroz et Philippe Colin proposent une introduction aux théories décoloniales latino-américaines et une généalogie permettant de faire découvrir tout un continent de pensées largement méconnues en France.

L’expérience coloniale et décoloniale latino-américaine
La colonialité s’enracine dans l’aventure transocéanique entreprise par les royaumes ibériques au début du xvie siècle et dans la conquête coloniale du continent américain. La conquête du Nouveau Monde par les royaumes de la péninsule Ibérique posa les fondements du plus ancien système colonial occidental. Contrairement au mouvement expansionniste européen du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, l’entreprise coloniale ibérique n’est pas le fruit d’une stratégie impériale des puissances « centrales » pour s’emparer des « restes du monde non capitaliste » et susciter de nouveaux cycles d’accumulation : elle est en réalité la conséquence imprévisible d’une politique d’exploration commerciale visant à contourner la mainmise ottomane sur les routes terrestres conduisant aux Indes et à l’or, associée à une conception absolutiste et centraliste du pouvoir politique et à un « nationalisme » catholique impérial. Succédant immédiatement à la chute du dernier royaume musulman de la péninsule Ibérique et à l’expulsion des juifs d’Espagne, la conquête du « Nouveau Monde » apparaît en réalité comme le prolongement de la Reconquista et du projet universel de dissémination de la foi chrétienne. Les politiques menées contre les musulmans et les juifs dans les territoires (re)conquis – expropriations, expulsions, conversions forcées – ont préparé le terrain de la Conquista du Nouveau Monde1. Décrits comme des idolâtres, accusés de cultes diaboliques, les Indigènes des Amériques sont expropriés de toute souveraineté originaire et leurs terres, concédées par bulle pontificale au royaume de Castille. L’opération jette les bases de la longue histoire du colonialisme européen : pour la première fois, les Européens revendiquent un « droit spécial et unilatéral sur des terres qui ne leur appartiennent pas et sur les habitants qui s’y trouvent »2. Rapidement, la « violence totale exprimée par les formes guerrières des Espagnols » se cristallise dans des formes politiques et juridiques qui vont permettre d’assurer, pendant des siècles, le contrôle des corps, des territoires et des croyances des vaincus. Si la conquête de l’Amérique trouve sa justification éthique et juridique dans le système de représentation symbolique d’un monde féodal agonisant – notamment l’idée de « guerre sainte » –, elle est à l’origine d’une gigantesque mutation épistémique et géopolitique. Avec elle, ce n’est pas seulement le Nouveau Monde mais un monde nouveau qui s’impose aux imaginaires européens. L’espace de l’Autre extra-européen, en opposition à l’espace européen soumis au « droit des gens », est défini comme une terra nullius, un espace intégralement « disponible », offert au « vouloir occidental » et exposé au déploiement de ses appareils de capture politiques et technologiques3. Avec l’hégémonie sur l’Atlantique exercée par les puissances ibériques et l’annexion coloniale de vastes pans du monde, l’Europe commence à se projeter comme le centre politique et économique du système-monde émergent, et comme le centre symbolique de l’Univers. Dans cette nouvelle configuration polarisée, les Indes occidentales deviennent l’entrepôt des marchandises tangibles et immatérielles qui alimentent, des siècles durant, les bourses et les imaginaires du Vieux Monde.
L’entreprise coloniale est essentiellement menée par des contingents d’hommes en quête de promotion sociale. La prise de terre s’accompagne dès lors systématiquement d’une appropriation prédatrice du corps des femmes des sociétés vaincues. La violence sexuelle comme arme de conquête et d’expropriation des peuples autochtones – qui est une constante des politiques coloniales – débouche sur ce qu’on appellera plus tard le métissage. Le phénomène prend une telle ampleur dès la seconde moitié du xvie siècle qu’il devient une préoccupation lancinante des autorités coloniales locales et métropolitaines, qui lui consacrent une réflexion biopolitique spécifique. Le pouvoir colonial ibérique se fonde en effet sur une distinction marquée entre Européens et « Indiens » impliquant une division du corps social en deux républiques strictement ségréguées et hiérarchisées (la República de Españoles et la República de Indios) et une stricte division du travail selon des critères ethniques. Or les « sang-mêlé » menacent de gripper cette mécanique coloniale. Le métissage des populations provoque le glissement progressif de ce qui fut à l’origine une société de castes – avec trois grands groupes, les Espagnols, les Indiens et les Noirs4 – vers une société dans laquelle la race – fondée sur le phénotype et le lignage biologique – devient un élément central du processus de classification sociale. L’intériorisation sociale de la suprématie blanche entraîne une survalorisation des logiques de différenciation raciales. Dès le XVIIe siècle, les colonies américaines deviennent, sinon légalement, du moins en pratique, des ethnocraties dans lesquelles l’ensemble des sujets sont classés et socialement hiérarchisés en fonction de leur degré d’éloignement par rapport à l’idéal de la blancheur incarné par l’Espagnol péninsulaire.
Le système administratif centralisé instauré par les couronnes ibériques rend possible lacooptation d’une grande partie des Espagnols américains – les Criollos5. Bien qu’occupant une position sociale inférieure à celles des Espagnols nés en Espagne, les Criollos ont pu, à la différence des autres groupes ethniques, intégrer l’appareil administratif et ecclésiastique espagnol. Leur position spécifique, leur participation active et prolongée au maintien d’une hégémonie blanche garante de l’ordre colonial rendent problématique jusqu’à la notion d’« indépendance », pourtant présentée comme un moment fondateur des histoires nationales latino-américaines. Alors que la domination politique et administrative directe de la métropole ibérique prit fin, dans la plus grande partie du sous-continent, au cours du premier tiers du xixe siècle, le colonialisme et son ingénierie sociale persistèrent à structurer, selon des modalités diverses et sur de nouvelles bases institutionnelles, les sociétés latino-américaines. Pour l’anthropologue argentine Rita Laura Segato, l’avènement des républiques latino-américaines, loin d’amorcer une quelconque décolonisa- tion, ne fut en réalité que la poursuite du colonialisme sous de nouveaux atours :
Les États républicains fondés par les élites criollas n’ont pas signifié une vraie rupture par rapport à la période de l’administration coloniale, comme la narration mythique-historique nous l’a fait croire, mais une continuité dans laquelle le gouvernement, désormais ancré dans l’espace géographique proche, fut instauré pour recevoir en héritage les territoires, les biens et les populations qui étaient auparavant sous la coupe de l’administration ultramarine. Les prétendues indépendances ne furent en réalité rien d’autre que le transfert de ces biens de là-bas vers ici, mais un aspect fondamental demeura : l’extériorité radicale des administrateurs vis-à-vis du monde qu’ils devaient administrer6.
L’émergence des figures de l’État-nation et de son corollaire, la citoyenneté, adossées à l’idéologie de l’Ordre, de la Loi et du Progrès, ne font que renforcer la domination des élites blanches créoles sur les populations indiennes, noires et métisses dont l’intégration à la sphère publique reste, dans le meilleur des cas, purement formelle. La reconnaissance rhétorique de l’égalité raciale sert le plus souvent de paravent à un processus de recolonisation agressive et de privatisation des territoires collectifs des peuples indigènes. Du Mexique à l’Argentine, la « mission civilisatrice » menée sous la bannière de la nation par les élites politiques et intellectuelles blanches prend la forme de vastes politiques volontaristes de désindianisation et de désafricanisation des sociétés nationales. Dans les pays d’Amérique latine où se trouvaient encore des communautés autochtones ou noires numériquement importantes (comme au Mexique, au Pérou, en Bolivie ou au Brésil), cette volonté d’homogénéisation s’appuie sur une biopolitique de métissage visant in fine à blanchir, dans un sens tant culturel que biologique, les populations. Ce projet eugéniste possède deux versants apparemment contradictoires mais en réalité parfaitement complémentaires : d’un côté, une politique institutionnelle visant à rédimer les sujets issus de « races dégénérées » en les incorporant à la société blanche-créole ; de l’autre, une politique tacite de l’abandon visant à « laisser mourir » ces vies et ces formes d’existence « archaïques ». Dans de nombreux pays du sous-continent, la gestion biopolitique des populations perçues comme inassimilables prend une tournure ouvertement purgative. C’est notamment le cas dans la Patagonie argentine, où elle débouche, à la fin du XIXe siècle, au nom de l’incorporation du « désert » à l’ordre national et à la civilisation, sur le génocide des dernières « sociétés sans État ».
La célébration simultanément biologiste et culturaliste du métissage – comme synthèse harmonieuse des races – qui se répand dans une bonne partie du sous-continent après la révolution mexicaine (1910-1920)7 ne signifie nullement la fin du vieux motif de la « guerre des races » : transformée en mythe fondateur des nations latino-américaines, elle permet de naturaliser les privilèges des élites, dorénavant redéfinies comme métisses, tout en éludant le problème fondamental de l’accès aux ressources de l’ordre social, produit d’une domination coloniale multiséculaire8. Le discours du métissage a constitué et constitue encore un dispositif biopolitique d’une grande efficacité symbolique : occultant ses liens organiques avec le pouvoir colonial et ses effets d’exclusion concrets, il se présente comme le mouvement naturel et imparable de l’histoire collective latino-américaine. Le mythe tenace de la democracia racial brésilienne en est un très bon exemple : formulé à la fin du XIXe siècle et conceptualisé dans sa forme la plus aboutie par l’historien Gilberto Freyre (1900-1987) dans son ouvrage Casa-Grande & Senzala (1933)9, il a durablement consacré l’idée d’une nation brésilienne sans discrimination raciale, dans laquelle le métissage (miscigenação) et le syncrétisme des cultures constitueraient le socle de la démocratie.
Depuis les années 1990, la montée en puissance des mouvements autochtones et afro-descendants a largement contribué à affaiblir le discours assimilationniste du métissage, contraignant les États latino-américains à réformer substantiellement les modes de gestion de l’altérité : le mot d’ordre n’est plus celui de l’assimilation à la culture dominante créole, mais celui de la reconnaissance de dans un contexte de fortes contraintes économiques et sociales qui a conditionné son application : en Amérique latine, la reconnaissance de la diversité culturelle s’est en effet trouvée presque systématiquement articulée à des politiques de désengagement étatique – à travers notamment la promotion de formes d’autogestion des communautés « autochtones » dans le cadre de l’application stricte des réformes néolibérales. Ces politiques de reconnaissance de la diversité à travers, tout particulièrement, l’incorporation de références à l’ethnicité dans les textes constitutionnels ont par ailleurs bien souvent permis, à des gouvernements en mal de légitimité, de coopter à moindre coût les secteurs sociaux les plus sensibles aux questions de discrimination culturelle tout en radicalisant les logiques de dépossession néocoloniales. Comme l’a souligné l’anthropologue mexicain Luis Vasquéz, en Amérique latine, la reconnaissance des droits culturels a souvent fonctionné, de facto, comme une monnaie d’échange contre des droits sociaux largement liquidés pendant le tournant néolibéral des années 199010.
La logique coloniale du pouvoir n’a pas seulement persisté sous la forme d’un colonialisme interne : elle prit aussi, immédiatement après la dissolution de l’Empire hispano-américain, la forme de « pactes néocoloniaux » entre les jeunes États-nations et les nouvelles puissances hégémoniques (l’Angleterre et les États-Unis) qui ont façonné durablement la nature de l’insertion économique et politique de la région dans le système-monde capitaliste. Abandonnant le « fardeau » d’une administration coloniale directe, les puissances industrielles émergentes du nord de l’Atlantique optèrent pour des formes indirectes – essentiellement financières et commerciales – de contrôle des nations nouvellement indépendantes. Jusqu’au début du xxe siècle, l’Angleterre, principale source mondiale de capital, imposa sa puissance navale, industrielle, financière et culturelle à l’ensemble du sous-continent, n’hésitant pas, lorsque la Pax britannica se trouvait contestée par des peuples ou des gouvernements « irresponsables », à recourir à une « diplomatie de la canonnière ». Dans cette configuration renouvelée de l’économie atlantique, les nations latino-américaines ont été assignées à la position périphérique de pourvoyeuses de matières premières pour les puissances du centre. Mais c’est surtout au niveau des relations sociales de production qu’apparaissent le plus clairement les limites des décolonisations latino-américaines. L’intégration des régions rurales au sein du nouvel ordre capitaliste mondial a pris la forme, pour la majorité des populations paysannes, noires et indiennes, d’une seconde féodalisation (néo)coloniale. Le système de péonage – ou servitude pour dette – fut non seulement maintenu dans une grande partie de l’Amérique rurale, mais encore étendu, sous des formes particulièrement féroces et dévastatrices, dans les territoires soumis à l’économie extractiviste. Ce fut notamment le cas dans les zones de collecte du caoutchouc dans le nord-est de l’Amazonie, où se répandit à la fin du XIXe siècle ce que l’anthropologue Michael Taussig appelle une « économie de la terreur » qui décima en quelques décennies les populations autochtones11. Le déclin des prétentions impériales britanniques en Amérique ne signifia pas, tant s’en faut, la fin des politiques néocoloniales dans la région. Au tournant du siècle, la nouvelle puissance globale, les États-Unis, possédait les moyens matériels de concrétiser ses velléités conquérantes, formulées dès 1823 dans la fameuse doctrine Monroe – « l’Amérique aux Américains »12. La guerre contre l’Espagne en 1898, en précipitant l’occupation de Cuba et l’annexion de Puerto Rico, consacra le début de la mainmise nord-américaine sur la région et de la soumission durable des pays d’Amérique latine aux intérêts impériaux des États-Unis.
Outre la mise en place d’une « politique du dollar » visant à faire peser la suprématie financière et économique dans la région, la première moitié du xxe siècle fut aussi marquée par la multiplication – sans déclaration de guerre formelle – des interventions militaires en Amérique centrale et dans les Caraïbes13. Les décennies suivantes entérinèrent l’influence des États-Unis dans la conduite des politiques internes des États latino-américains. Au nom du concept de « défense hémisphérique » contre l’impérialisme soviétique, puis de « guerre contre la drogue », Washington a déployé un large répertoire d’actions politico-militaires pour perpétuer la gouvernance impériale de la région : soutien logistique et politique à la « guerre sale » contre l’« ennemi intérieur » menée par les dictatures de sécurité nationale du Cône Sud des années 1970, appui militaire massif aux gouvernements répressifs et aux insurrections contre-révolutionnaires en Amérique centrale au cours des années 1980, interventions militaires directes, transnationalisation de questions relevant de la sécurité intérieure, exportation de politiques répressives, etc. Les modalités coercitives de cet interventionnisme sont indissociables d’un projet géopolitique plus vaste visant à la construction d’une hégémonie néolibérale à travers l’« exportation de la démocratie » et des bonnes pratiques de gouvernance économique telles que définies par le « consensus de Washington » de la fin des années 198014. Articulé à des stratégies politiques internes aux groupes dominants, ce projet a débouché sur une profonde refondation des économies et des sociétés latino-américaines, renforçant partout et jusque dans les territoires les plus reculés, non seulement le fardeau imposé du capital transnational et le modèle d’accumulation fondé sur l’exportation des matières premières, mais aussi le pouvoir néocolonial des élites eurocentriques. Comme le signale l’écrivain militant Raúl Zibechi, la logique spatiale du capitalisme extractiviste, qui s’est imposé et renforcé partout en Amérique latine depuis deux décennies, remet en vigueur les schémas coloniaux les plus féroces15 : occupation des territoires (méga-mines à ciel ouvert, agro-industrie de mono- plantation, monocultures, tourisme extractiviste, etc.) ; expulsion ou désintégration organisée des communautés paysannes ; mise en place d’économies d’enclave qui consacrent l’extraterritorialité juridique des acteurs économiques ; militarisation des territoires, souvent laissés aux mains de milices para-étatiques. Dans ces zones de sacrifice, le principal instrument d’« accumulation par dépossession » – selon l’expression de David Harvey16 – n’est pas la privatisation, mais l’expropriation violente des territoires, des lieux du déploiement de la vie, et la destruction des conditions mêmes de possibilité de la vie. En ce sens, comme l’a soutenu le sociologue mexicain Pablo González Casanova, la conquête de l’Amérique n’est pas un événement qui appartient au passé : elle est le nom d’un mécanisme récurrent qui, sous des formes plus ou moins explicites et à des échelles multiples, produit et reproduit sans cesse des rapports coloniaux17.
Une relecture critique de l’histoire de l’Amérique latine ne peut pas se contenter d’énumérer les multiples formes de colonialisme qui ont émaillé l’histoire du continent. Elle se doit aussi de prêter attention aux « grondements sourds de la bataille », autrement dit, aux luttes, aux tensions et aux ruptures qui leur sont coextensives. Car les discours et les pratiques coloniales ont aussi, comme le souligne l’historienne bolivienne-aymara Silvia Rivera Cusicanqui, contribué à l’émergence, dans les marges subalternes des nations, d’une multitude de pratiques et de stratégies de réinvention sociales et politiques :
Bien que la modernité historique ait impliqué l’esclavage des peuples indiens, elle constitua en même temps une arène de résistances et de conflits, une scène propice au déploiement de stratégies contournantes et contre-hégémoniques, ainsi que de nouveaux langages et projets indiens de la modernité18.
Dès le XVIe siècle, les communautés indiennes et afro-caribéennes, premières victimes historiques du processus de conquête moderne/colonial, inventèrent des formes collectives de résistance et de réinvention politique visant non seulement à desserrer le carcan des structures sociales de domination, mais parfois aussi à renverser l’ordre social moderne/colonial. Des territoires autonomes administrés par les esclaves fugitifs, comme le Quilombo dos Palmares (1605-1694)19, aux communautés zapatistes autonomes en lutte, en passant par le grand cycle des révoltes panandines à la fin du XVIIIe siècle20, la révolution haïtienne, l’insurrection messianique et populaire des Canudos au Brésil (1893-1897) ou la « guerre de l’eau » menée en 2000 par les communautés aymaras à Santa Cruz en Bolivie, l’histoire moderne et contemporaine de l’Amérique latine est aussi l’histoire des multiples et inlassables formes de résistance systémiques et non systémiques organisées par les sujets subalternes contre les effets durables de la colonialité du pouvoir.
Reste que ces irruptions radicales des « absents de l’histoire » ne sont que les formes les plus explicites d’un vaste répertoire de pratiques subversives, souvent silencieuses, inscrites dans la trame même de la vie quotidienne des groupes subalternes. Ces pratiques n’ont été possibles que parce qu’elles s’enracinent dans un solide socle épistémique : face à l’expropriation matérielle et immatérielle systématique, face à la transformation de leur monde de la vie en « monde de la mort »21, face aux stratégies d’accumulation par dépossession, les habitants de la « zone du non-être » se sont dotés de manières d’être, de connaître et de s’organiser à même de contrecarrer les effets dévastateurs de la colonialité du pouvoir. Depuis la conquête commencée en 1492, l’histoire de l’Amérique latine a été marquée à la fois par la continuité de structures coloniales et par la persistance des luttes décoloniales. Aujourd’hui encore, dans un contexte global de « mondialisation » néolibérale, il est difficile de comprendre les rapports de pouvoir et les tensions qui traversent les sociétés latino-américaines sans prendre en compte le colonialisme structurel qui a marqué leur histoire. À bien des égards, comme l’observe le sociologue portoricain Ramón Grosfoguel, la décolonisation y reste un programme largement inachevé :
Si l’on conçoit le colonialisme comme un rapport politique, économique, sexuel, spirituel, épistémologique, pédagogique, linguistique de domination métropolitaine dans le système monde, et comme un rapport culturel/structurel de domination ethno- raciale, les mal nommées républiques indépendantes d’Amérique latine et des Caraïbes restent des territoires à décoloniser22.
La bifurcation spatiale et chronologique que propose l’approche décoloniale dégage de nouveaux points de vue, non seulement sur la temporalité mais aussi sur la nature des relations de pouvoir colonial. Ce déplacement entraîne tout d’abord une mutation cruciale de l’objet d’étude : le point focal de la perspective décoloniale n’est plus tant le colonialisme, ni même d’ailleurs les traces qu’il aurait laissées dans les sociétés contemporaines, que la forme du pouvoir qu’inaugure l’arraisonnement violent de l’Amérique au monde occidental, et qui survit au démantèlement des structures politiques et juridiques du colonialisme historique – à savoir, la colonialité. Pour les théoriciens décoloniaux, le colonialisme n’est que l’une des manifestations historiques d’un régime de colonialité, hétérogène et dynamique, qui se déploie sur la longue durée23. Ce constat en appelle un autre : les décolonisations ayant laissé intactes les multiples relations raciales, ethniques, de genre, épistémiques et économiques qui fondent l’asymétrie Nord/Sud, il devient nécessaire de mettre en œuvre une deuxième décolonisation ou, plus exactement, une opération de décolonialité. Cette redéfinition du champ analytique implique un renversement de l’ordre des phénomènes. La colonialité n’est pas le résidu ou la séquelle d’une tache originelle ; elle est une structure profonde, enracinée dans les institutions, les pratiques sociales, les schèmes collectifs de pensée, qui conditionne et légitime la répartition des ressources à toutes les échelles de la vie sociale. La colonialité, c’est, pour reprendre l’expression du philosophe marxiste équatorien Bolívar Echevarría, une « conquête ininterrompue »24 qui, depuis l’événement singulier de 1492, et selon des modalités variables, opère une appropriation violente du réel, produit sa propre réalité et lui impose, ce faisant, ses conditions de visibilité et d’intelligibilité.
*
Illustration : Wilfredo Lam.
| ⇧1 | Ella Shohat, Colonialité et ruptures. Écrits sur les figures juives arabes, Lux Éditeur, Montréal, 2021, p. 78-84. |
|---|---|
| ⇧2 | Luis Mora-Rodríguez, Bartolomé de las Casas. Conquête, domination, souveraineté, PUF, Paris, 2012, p. 59. |
| ⇧3 | Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, Paris, 1975, p. 9-10. |
| ⇧4 | Dans le contexte latino-américain, les catégories indio et indígena ont toutes deux été construites et imposées par les institutions étatiques et les élites blanches. La catégorie indio est une construction juridique coloniale, visant à garantir la ségrégation entre les colons et les « vaincus », soumis au tribut. Après les indépendances et l’abolition de l’ordre juridique colonial, le terme est remplacé dans les discours institutionnels par le vocable indígena (du latin indígena, « originaire du pays »), censé refléter l’accession – largement rhétorique – des Autochtones au régime de la citoyenneté. Contrairement à la catégorie rattachée au code de l’indigénat français, le terme indígena n’a jamais été lié à un statut juridique spécifique. Désormais intégré au lexique juridique des grandes organisations internationales (convention 169 « relative aux peuples indigènes et tribaux » de l’Organisation internationale du travail) et des organisations non gouvernementales (ONG), il est devenu un outil d’auto-identification stratégique dans les luttes des peuples autochtones. Afin d’éviter des confusions, nous utiliserons généralement le terme « Autochtone ». Les termes « Indien » et « Indigène » seront réservés à des contextes historiques spécifiques. |
| ⇧5 | Le terme criollo vient du portugais crioulo, qui fut utilisé dès le XVIe siècle pour distinguer les esclaves noirs nés en Amérique des esclaves nés en Afrique. Dans les colonies espagnoles d’Amérique, il fut adopté pour désigner les descendants d’Espagnols nés en Amérique, en opposition aux Peninsulares, les Espagnols nésdans la Péninsule. Au sein du système colonial des castes, les Criollos étaient considérés comme des sujets socialement inférieurs aux Espagnols péninsulaires, mais supérieurs à l’ensemble des sujets non blancs. Bien que constituant l’élite économique au sein des colonies, les Criollos furent systématiquement écartés des plus hautes fonctions administratives du système de gouvernance coloniale. |
| ⇧6 | Rita Laura Segato, La Guerra contra las mujeres, Traficantes de sueños, Madrid, 2016, p. 24. Nous traduisons. |
| ⇧7 | La première occurrence latino-américaine du terme « métissage » (mestizaje) apparaît en 1925 dans le très influent essai du Mexicain José Vasconcelos (1882-1959), La Raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. L’intellectuel et homme politique mexicain, qui fut secrétaire de l’Éducation et de la Culture du gouvernement post- révolutionnaire d’Alvaro Obregón, y interprète l’Amérique latine comme l’espace historique où s’opère, depuis la conquête, la fusion des races européennes, indiennes et africaines. Selon Vasconcelos, ce processus de fusion biologique – dans lequel domine l’apport hispanique – doit aboutir à l’avènement d’une cinquième race, la « race cosmique », censée parachever le mouvement historique d’unification de l’humanité. Le métissage tel que le conçoit Vasconcelos est une théodicée : la violence coloniale y apparaît comme la condition de possibilité du processus historique menant à la réconciliation de l’humanité autour d’un ordre symbolique et social eurocentré. |
| ⇧8 | Laura Catteli, Arqueología del mestizaje. Colonialismo y racialización, Ediciones Universidad de la Frontera, CLACSO, Temuco, 2020, p. 54. |
| ⇧9 | Pour la traduction française : Gilberto Freyre, Maîtres et esclaves, Gallimard, Paris, 1978. |
| ⇧10 | Luis Vasquez, Multitud y distopía. Ensayos sobre la nueva condición étnica en Michoacán, UNAM, Mexico, 2010, p.11. |
| ⇧11 | Michael Taussig, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man. A Study in Terror and Healing, The University of Chicago Press, Chicago, 1978. Nous traduisons. |
| ⇧12 | La « doctrine Monroe » est formulée en 1823 devant le Congrès par le président James Monroe. Souvent réduite à la formule « l’Amérique aux Américains », elle constitue avant tout un avertissement à destination de l’Espagne et des puissances de la Sainte-Alliance contre toute tentative de reconquête des anciennes colonies de l’Amérique luso-hispanique. L’application de cette doctrine dépendait alors très largement de la bonne volonté de la Grande-Bretagne, seule puissance navale capable d’assurer une présence stratégique permanente dans l’ensemble de la région. |
| ⇧13 | On peut mentionner, entre autres, l’occupation de Cuba (1898-1902), du Nicaragua (1912-1933), de la République dominicaine (1915-1924) et de Haïti (1915-1933). |
| ⇧14 | Le mal nommé « consensus de Washington » fait référence à l’ensemble des mesures d’ajustement structurel qui furent imposées aux pays du Sud à la fin des années 1980 par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en échange de la mise en place de « plans de sauvetage » visant à « aider » les pays hyper-endettés à honorer leurs dettes auprès des banques commerciales du Nord. Le « décalogue » de mesures néolibérales – discipline fiscale, déréglementation des marchés financiers, désétatisation de l’économie, réduction et réorientation des dépenses publiques, etc. – fut d’autant plus facilement imposé aux pays latino-américains que ceux-ci étaient plongés, depuis le début des années 1980, dans une violente récession économique. |
| ⇧15 | Raúl Zibechi, Latiendo resistencia. Mundos nuevos y guerra de despojo, Zambra, Balandres, Malaga, 2016, p. 39-41. |
| ⇧16 | David Harvey, Le Nouvel Impérialisme, Les Prairies ordinaires, Paris, 2010 |
| ⇧17 | Pablo gonzález Casanova, « La conquista de América Latina », Tareas, n° 83, 1993 |
| ⇧18 | Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, 2010, p. 53. Nous traduisons. |
| ⇧19 | Situé dans la région sucrière du Nordeste, le Quilombo dos Palmares constitua la plus importante des communautés marronnes libres du Brésil colonial. Les expéditions menées par les grands propriétaires et les autorités coloniales pour l’anéantir s’étendirent du début du XVIIe siècle au début du XVIIIe. Très nombreuses dans l’ensemble des régions esclavagistes de l’Amérique, ces républiques marronnes auto-organisées ont été appelées de différentes façons dans le sous-continent : Cumbes au Venezuela ou Palenques en Colombie |
| ⇧20 | Au cours de la même période que la séquence révolutionnaire atlantique, un grand mouvement révolutionnaire anticolonial se propagea à travers les hauts plateaux de l’ancien Empire inca en 1780-1781. Initialement menée par un descendant des souverains incas, José Gabriel Tupac Amaru, dans la région de Cuzco, l’insurrection se poursuivit dans la région de La Paz (dans l’actuelle Bolivie) sous le commandement du paysan aymara Tupac Katari. L’insurrection, qui accumula initialement les succès militaires, fut presque en mesure de renverser le pouvoir colonial. Si elle fut finalement défaite et impitoyablement écrasée par les autorités coloniales, elle ébranla durablement les structures de l’ordre colonial. Décrite comme une « guerre des races » par la propagande de l’État espagnol, la grande insurrection andine fut pourtant un vaste mouvement interethnique dirigé contre les institutions de l’oppression coloniale. |
| ⇧21 | Nelson Maldonado-Torres, « Sobre la colonialidad del ser : contribuciones al desarrollo de un concepto », in Santiago Castro-Gómez et Ramón Grosfoguel (dir.), El Giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre Editores, Bogota, 2007, p. 127-167, citation p. 159. Nous traduisons. |
| ⇧22 | Ramón Grosfoguel, « Izquierdas e izquierdas otras : entre el proyecto de la izquierda eurocéntrica y el proyecto transmoderno de las nuevas izquierdas descoloniales », Tabula Rasa, n° 11, p. 9-29, citation p. 16. Nous traduisons. |
| ⇧23 | Aníbal Quijano, « Colonialidad del poder y clasificación social », in Santiago Castro-Gómez et Ramón Grosfoguel (dir.), El Giro decolonial, op. cit., p. 93-126, citation p. 93. |
| ⇧24 | Bolívar Echevarría, Vuelta de siglo, Era, Mexico, 2010, p. 242. |