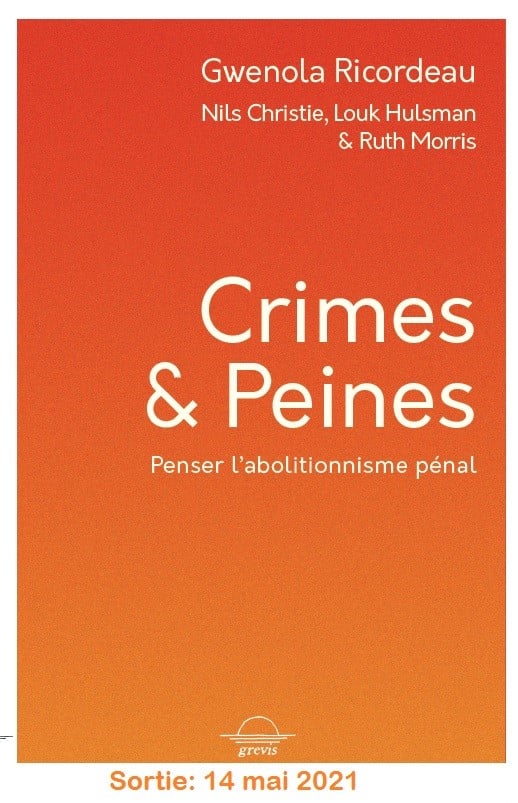Qui le système pénal protège-t-il ? Et de qui ? Qui appelle la police ? Qui en a peur ? Qui va en prison ? Qui n’y va pas ? Et qui sont ceux que l’on désigne volontiers comme criminels, et comme victimes ? Ces questions, tristement rhétoriques, méritent qu’on s’y attarde pour aller au-delà du constat. Car si les luttes des populations issues de l’immigration et des quartiers populaires se sont principalement menées contre les violences policières ces dernières années, peut-on vraiment espérer affaiblir le bras armé, sans s’attaquer au cerveau qui l’agite ?
Loin d’être nouvelles, c’est à nos propres héritages politiques que les réflexions autour de l’abolitionnisme pénal font écho. De fait, l’idée de mettre fin aux violences d’État n’a pas été l’apanage de ceux qui l’ont théorisé à partir des années 70 : des militants anti-esclavagistes noirs aux luttes de libération africaines-américaines en passant par les luttes pour l’abolition du système colonial, c’est à un retour aux sources que ces questions invitent à penser. Car si l’ambition d’une société sans police, ni prison, ni système pénal peut paraitre un peu utopique, voire dangereuse, celle de subir la violence d’un système tout entier dirigé contre nos existences, est-elle plus acceptable ?
Entretien avec Gwenola Ricordeau, militante abolitionniste et professeure associée en justice criminelle à l’université d’État de Californie, Chico, auteure de Pour elles toutes. Femmes contre la prison (2019, Lux) et qui vient de publier Crimes et Peines : penser l’abolitionnisme du système pénal aux éditions Grévis.
Avant de penser à pourquoi et comment l’abolir, on va peut-être le définir : de quoi parle-t-on exactement quand on évoque « le système pénal » ?
Concrètement, on parle de l’ensemble des institutions d’État qui prennent en charge ce qui est défini, par le droit pénal, comme des contraventions, des délits, des crimes. Autrement dit : la police, les tribunaux (correctionnels et cours d’assises) et les prisons. Le projet de l’abolitionnisme pénal est donc non seulement d’abolir les prisons, mais aussi la police et les formes de jugements tels qu’on les connaît aujourd’hui dans les tribunaux.
Un des points de départ de l’abolitionnisme, c’est de rappeler un fait que l’on a tendance à oublier, à savoir que le crime n’est pas une réalité en soi, mais une construction sociale…
C’est une réflexion qui est importante pour comprendre le projet abolitionniste. En général, celui-ci suscite des réactions d’effroi. Les gens se disent « mais comment on va faire »; « ça a toujours existé » etc. Il est bon de rappeler que les crimes, les délits, et en gros tout ce que l’État appelle « la criminalité », n’existe pas en soi, mais est l’objet d’une histoire, de luttes politiques (certaines pour criminaliser des faits, d’autres pour en décriminaliser), et d’un rapport de force. Sinon, comment expliquer que certains faits soient criminalisés dans certains pays et pas dans d’autres ? Idem pour l’évolution dans le temps : des faits criminalisés hier, ne le sont plus aujourd’hui, et inversement.
Donc effectivement, le crime n’a pas d’existence propre, c’est une catégorie de l’État. D’ailleurs, Louk Hulsman, l’un des auteurs mis en avant dans Crimes et Peines, a été l’un des grands penseurs de la critique de la catégorie de crime. Et il nous invite à l’abandonner pour ne pas tomber dans une logique de responsabilité individuelle, de culpabilité, et de punition.
Les trois textes reproduits dans Crimes et Peines ont été écrits par des penseurs qui appartiennent à ce que vous appelez « la première vague » de l’abolitionnisme pénal des années 1970-90, et ce sont quasiment tous des hommes blancs. Or durant la décennie antérieure, le monde a été secoué par les luttes de libération anticolonialistes, les mouvements de libération africaine-américaine qui remettaient déjà radicalement en cause l’état et ses institutions. Considérez-vous que ces luttes et mouvements étaient abolitionnistes de fait, pour avoir été précisément ciblés par le système ? Quelles sont les relations entre ces mouvements de libération et les théoricien-ne-s de l’abolitionnisme pénal ?
Oui, des abolitionnistes de fait… C’est une remarque importante à faire. Effectivement à partir du milieu des années 1970, il y a des théoricien-nes, des militant-e-s sur le terrain des luttes politiques qui se pensent et se revendiquent abolitionnistes, mais ça ne veut pas dire que le projet d’abolir le système pénal est née avec les théories de ces personnes ou leurs luttes.
Les Black Panthers, les luttes de libération africaine-américaine, et aussi auparavant les mouvements anarchistes ont bien sûr porté cette critique radicale du système pénal, et des institutions policière et carcérale.
L’abolitionnisme n’appartient pas à ceux qui s’en revendiquent. D’ailleurs, aujourd’hui en France, il existe des organisations, des luttes qui défendent une ligne abolitionniste sans même le revendiquer, je pense par exemple au Genepi (qui se réclame du féminisme et de l’anticarcéralisme); ou au collectif afroféministe Mwasi et bien d’autres.
D’ailleurs, si on remonte encore plus loin dans l’histoire, le terme « abolition » fait penser aux luttes anti-esclavagistes. A-t-il été pensé pour faire le lien avec celles-ci ?
C’est difficile pour moi de répondre à cette question parce que l’histoire des mouvements abolitionnistes reste encore très peu écrite. Je ne suis pas une spécialiste de la question de l’esclavage, mais ayant fouillé un peu les archives abolitionnistes de la première vague, je sais qu’il y a peu de références à l’esclavage.
Aux États-Unis, la question de la continuité avec les luttes abolitionnistes esclavagistes a émergé dans les années 2000. C’est aussi pour cela que j’emploie l’expression de « première vague » de l’abolitionnisme, pour ces penseurs des années 1970 qui sont pour beaucoup des hommes blancs. La deuxième vague a été marquée par des théoriciennes et des militantes africaines-américaines, qui ont eu le mérite de mettre au centre des réflexions, la question du racisme et de la continuité du système pénal avec le système esclavagiste.
Dans Pour elles toutes. Femmes contre la prison, votre précédent livre, vous interrogez (et démontez) la pertinence de mener le combat féministe sur le terrain du droit, notamment parce que le système pénal échoue à protéger les femmes, et ne prend pas en compte les besoins des victimes. En quoi la réflexion sur les victimes est au cœur de la pensée abolitionniste, et particulièrement de Ruth Morris ?
C’est parce que Ruth Morris s’est beaucoup intéressée à la question des victimes, qu’il était important pour moi que l’un de ses textes figure dans Crimes et Peines. En fait, c’est un aspect assez méconnu de l’abolitionnisme pénal, auquel on reproche de ne penser qu’aux condamnés, alors même que l’approche des victimes est centrale dans nos réflexions. D’ailleurs beaucoup d’abolitionnistes le sont devenus précisément à cause du sort que le système pénal réserve aux victimes et de son incapacité à répondre à leurs besoins fondamentaux.
Ce que démontre Ruth Morris, c’est que le système pénal reconnaît exclusivement les victimes de violences interpersonnelles, qui existent évidemment, mais il existe un autre type de victimes : les victimes « d’injustices systémiques ». Elle parle bien sûr des victimes systémiques du sexisme, du racisme, qui ne sont jamais reconnues et prises en charge par le système pénal. On ne peut pas porter plainte contre le racisme, on porte plainte contre des discriminations raciales, ce qui ne revient pas à la même chose. Et la ruse du système judiciaire, c’est qu’il détourne notre attention de ces violences systémiques et donc de ces nombreuses victimes.
S’il échoue à protéger les victimes, vous écrivez « le système pénal semble au contraire très bien fonctionner du point de vue du capitalisme et du suprématisme blanc ». Au regard des contextes historiques et géographiques dans lesquels la police ou la prison ont été crées et généralisés, estimez-vous que le contrôle social fait partie de la fonction même des institutions pénales ?
Le colonialisme et l’histoire coloniale ne sont pas des champs dans lesquels j’ai une expertise, mais il me semble important, quand on pense la critique du système pénal, de ne pas faire l’impasse sur ces dimensions. Il existe un vaste champ de recherche sur la manière dont la prison s’est imposée dans certains pays grâce à la colonisation. Beaucoup de travaux sont également revenus sur l’origine de la police, ses racines au sein des « slave patrols », ces milices coloniales qui se chargeaient de discipliner les personnes esclavagisées. Il y a des débats historiographiques sur les liens, l’articulation entre esclavage, colonisation et système pénal. Et ce dernier ne peut bien sûr être détaché du système capitaliste et du suprématisme blanc.
Vous démontrez aussi comment la question féministe peut servir de prétexte pour justifier des politiques qui ciblent les personnes racisées, musulmanes, à l’intérieur, comme à l’extérieur au travers de l’impérialisme. Estimez-vous que la récente loi sur le harcèlement de rue ou dans un autre registre la loi séparatisme en font partie ?
C’est très clair et ce qui me parait incroyable, c’est que certaines personnes puissent le nier. Ces lois sont précisément faites pour cibler une catégorie de personnes, ce sont des lois racistes et sexistes. La loi sur le harcèlement de rue vise explicitement des hommes jeunes, issus de l’immigration ou de l’histoire coloniale qui vivent dans les quartiers populaires. Le but étant de désigner ces hommes comme culturellement sexistes. Même chose pour la loi sur le séparatisme. On observe une avalanche de lois de ce genre, visant explicitement les hommes et les femmes musulmanes ou les personnes pensées comme musulmanes.
Finalement, si les crimes/délits sont des constructions, peut-on dire que l’État a finalement construit son ennemi ?
Ce que nous donne à voir les politiques pénales et notamment du populisme pénal, c’est qu’il y a des figures de la dangerosité que l’on agite régulièrement pour justifier l’expansion du pénal : la figure du pédophile, ou celle du terroriste islamiste, à laquelle on relie volontiers les jeunes hommes issus de l’immigration ou de l’histoire coloniale vivant dans les quartiers populaires. À l’inverse, il y a des populations désignées comme devant être protégées (parfois même contre leur gré) comme les femmes, les enfants. Et d’autres, dont on accepte qu’elles soient vulnérables et non protégées.
Aux États-Unis, les Black Panthers et de nombreux africains-américains comme Angela Davis, ou Michelle Alexander dans « The new Jim Crow », ont démontré la continuité entre le système esclavagiste et la prison contemporaine grâce notamment au 13ème amendement. Quel est l’héritage de ces luttes de libération noire sur les luttes d’aujourd’hui comme au sein de Black Lives Matter par exemple ?
Il est vrai que depuis le tournant des années 2000, il y a cette rhétorique autour de la continuité du système pénal avec le système esclavagiste au sein des mouvements abolitionnistes nord-américains et particulièrement états-uniens. Ce qui n’est pas sans susciter de débats à la fois politiques, historiographiques et académiques. Mais pour résumer, on a des personnes esclavagisées qui une fois le 13ème amendement actée, se sont retrouvées prisonnières, condamnées à du travail forcé, et parfois de manière caricaturale. La prison d’Angola par exemple, qui était une plantation dans laquelle on envoyait des personnes esclavagisées originaires d’Angola, est aujourd’hui une prison où les noirs sont surreprésentés, et qui pratique le travail forcé.
Donc on peut facilement observer ces formes de continuités historiques, aussi bien au niveau des institutions que des parcours individuels. Les anciens propriétaires d’esclaves se reconvertissent si l’on peut dire dans le travail forcé. Et puis il y a la réalité actuelle de la surreprésentation des noirs dans les prisons. Un jeune noir aux États-Unis a plus de chance de se retrouver en prison qu’à l’université.
Mais ce n’est pas sans créer de débats sur les raisons qui expliquent la surreprésentation des minorités dans le système carcéral. Car les noirs et les africains-américains ne sont pas les seuls à être surreprésentés en prison, on trouve évidemment les latinos, les amérindiens, mais aussi des blancs pauvres et cela crée des débats au sein des mouvements antiracistes, et des mouvements abolitionnistes et pèse sur les enjeux d’unification que l’on pourrait espérer d’un front politique contre les violences pénales.
Comment expliquer le peu de travaux et même de traductions sur la question en France?
C’est vrai qu’en France, il y a des textes qui existent mais qui sont essentiellement académiques, et donc réservés à un public universitaire. Il y a quand même des textes politiques, mais qui sont relativement anciens, comme Catherine Baker « Pourquoi faudrait-il punir ? » ; Jacques de la Haye a pas mal écrit sur la prison, mais pour l’essentiel les textes existent surtout en anglais, et dans d’autres langues. Il ne faut pas oublier que l’abolitionnisme ce n’est pas un mouvement que nord-américain et anglophone. Il y a des choses qui s’écrivent en espagnol, en allemand, en italien. Mais en France, c’est vrai qu’il y a un retard dans la traduction et la circulation des idées.
Une fois dit cela, il ne faudrait pas croire que les abolitionnistes et les réflexions abolitionnistes n’existent pas en France. Dans les années 1970, il y a eu des mouvements comme le Groupe d’Information Prison (GIP), le Comité d’Action des Prisonniers (CAP), la figure intellectuelle de Michel Foucault et d’autres personnes qui portaient un discours radical sur le système pénal.
Il y a donc des formes de circulation historiques mais ce qui est nouveau ces derniers mois avec notamment la visibilité de Black Lives Matter, et de fait des mouvements pour l’abolition de la police aux États-Unis, c’est qu’il y a u intérêt renforcé en France pour ces idées-là. Et de mon point de vue, on assiste à une relative sortie des marges politiques des mouvements qui prônent l’abolition du système pénal, tant aux États-Unis qu’en France.
Justement on parle beaucoup en ce moment de BLM aux États-Unis, mais il y a des différents courants aux sein des mouvements qui luttent contre les violences policières, et donc différentes stratégies. Vous qui vivez là-bas et êtes une observatrice privilégiée, quels sont ces différents courants ? Qu’est ce qui les divise ?
Je vis aux États-Unis, mais je n’ai pas une expertise sur tous les mouvements existants et mon analyse porte évidemment des formes de subjectivité. Ce que je peux en dire, c’est qu’effectivement il y a une diversité de stratégies, de ligne politique, et que cette diversité n’est pas représentée dans les médias ou dans ce qui est dit en France. On parle peu, par exemple, des mouvements réformistes qui luttent dans le sens d’une réduction des violences policières, et donc qui n’ont pas les mêmes objectifs politiques que ceux qui veulent l’abolition. Pour autant, ils sont beaucoup plus importants que ces derniers.
« Defund the police », donc l’idée de « définancer la police », de réduire les financements de la police en réduisant les budgets de l’armement, le recrutement des policiers (une stratégie qui peut également être appliquée au niveau du carcéral), cette stratégie-là a bénéficié d’une certaine visibilité en France, sûrement pour le caractère qui semble nouveau, voire exotique, mais c’est loin d’être le courant majoritaire dans les mouvements critiques autour de la police aux États-Unis.
Aux États-Unis, les mouvements antiracistes se sont donc majoritairement concentrés sur les luttes contre les violences policières. On peut faire le même constat en France. Comment expliquer qu’au sein des milieux antiracistes, bien qu’on ait conscience du caractère structurel du racisme de nos institutions, on continue à réclamer une justice dont on est quasiment systématiquement privé ?
Cela mérite des discussions plus approfondies, mais on peut voir cette question à différents niveaux. On peut d’abord comprendre que l’impunité est forcément choquante quand on parle de crimes d’État. Je préfère d’ailleurs l’expression « crime d’État » à celle de « violences policières » parce que je pense qu’il est important et plus englobant, de mettre la focale sur l’État. Cela permet aussi de penser ensemble les crimes policiers et les crimes pénitentiaires.
Ceci étant dit, l’impunité fait violence, à la fois aux victimes, aux proches des victimes et au-delà à des communautés entières. Et je pense que l’on peut être d’accord que la condamnation de Derek Chauvin, le meurtrier de Georges Floyd, s’est accompagnée d’une forme de soulagement car quelle insulte cela aurait été, d’avoir un cas supplémentaire d’impunité.
Ce sur quoi on peut s’interroger, ce sont les raisons pour lesquelles on porte plainte. Quelles sont les raisons pour lesquelles on fait appel à la justice ? Et là je crois qu’il faut comprendre plusieurs choses : Le désir de reconnaissance des faits, de l’injustice, donc de son statut de victime, du préjudice et du tort commis, et puis aussi un besoin de vérité. Et à ce niveau, de nombreuses affaires nous enseignent que la vérité judiciaire est très loin de la vérité des faits, et de nos expériences collectives, de ce qu’est le racisme, de ce qu’est l’activité policière, pénitentiaire. Donc l’utilisation de la justice peut répondre à ces besoins de reconnaissance, et cela peut aussi être une façon de politiser et de mobiliser autour d’une violence.
Pour moi la question n’est pas « est-ce qu’il faut porter plainte ? » qui est davantage une question tactique, mais de s’interroger collectivement : est ce qu’il y a un avantage à avoir recours à la justice ?
Et que répondez-vous au procès de l’irrationalité fait au projet abolitionniste. Après tout, plutôt que de l’abolir, pourquoi ne pas moderniser les prisons, les rendre plus humaines, et réformer la police ?
On peut répondre que l’État et les forces réformistes travaillent sans cesse à humaniser, moderniser la police et la prison. Ils sont une gigantesque boîte à idées, dont sortent peu de véritables réformes, mais qui a sans cesse des réformes à nous proposer. Finalement, il y a peu de gens qui estiment que ces institutions ne doivent pas être réformées. Au contraire, il y a une sorte d’accord général sur les imperfections, les dysfonctionnements. Et c’est bien sur ce point que réformistes et abolitionnistes s’opposent : ces derniers disent qu’en fait le système Penal n’est pas réformable, il ne fait que se réformer mais sa nature profonde, ses fondations, ne lui permettent pas d’être réformé.
Finalement, ne luttons-nous pas contre nous-mêmes, contre nos besoins et intérêts en appelant à rendre plus humaines et plus acceptables des institutions qui sont profondément racistes, sexistes, classistes ?
Pour moi, le discours de réforme de la prison ou de la police fait partie d’un discours de légitimation de ces institutions. C’est vraiment la rhétorique de ceux que j’appelle « les légitimistes », ceux qui appellent à défendre la légitimité des institutions pénales. Ce que l’on voit en ce moment aux États-Unis, c’est une fièvre réformiste que ce soit au niveau de l’État fédéral, des états, des municipalités, etc. Là-bas les forces de police sont extrêmement morcelées, on a plus de 15 000 forces de police et chacun y va de sa réforme, notamment sur l’encadrement du recours à la force, sur la standardisation du type d’armement, l’interdiction des clefs d’étranglement etc. Il y a énormément de réformes en ce sens qui risquent de participer à la légitimation de l’institution. Et puis il y a aussi les effets sur le terrain de ces réformes : en quoi cela change la vie des personnes racisées, des pauvres, et de toutes les personnes qui sont les cibles du système pénal ? Le fait est qu’à ce jour, on ne voit pas de changements, et il y a même des raisons de s’inquiéter d’un regain et d’une augmentation du nombre de personnes tuées par la police dans le sillage de la condamnation de Derek Chauvin.
La poétesse africaine américaine Audre Lorde disait : « Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître ». Quels outils, quelles pistes l’abolitionnisme pénal offre-t-il pour construire des formes de justice autonomes ?
L’abolitionnisme pénal n’est pas un bloc, il y a des courants différents, des débats, différentes propositions stratégiques qui peuvent et doivent être discutées. Certains abolitionnistes penchent davantage pour une proposition d’élargir des formes d’autonomisation du système pénal, donc en développant des formes de justice dite « transformative » ou « communautaires ». Cela revient en gros à créer des espaces dans lesquels on se passe du système pénal.
D’autres, et c’est mon cas, respectent ces initiatives et en suivent le développement avec intérêt mais sont davantage sur une ligne révolutionnaire et estiment donc que l’on n’abolira pas le système pénal sans un processus révolutionnaire et que ces formes d’espaces d’émancipation ne permettent pas d’abolir totalement le système pénal.
Avant la justice transformative, il y avait aussi la piste de la justice restaurative dont on a d’ailleurs pu voir des éléments cooptés par le système judiciaire, notamment en France avec la réforme Taubira…
Le mouvement autour de la justice restaurative qui date des années 1990 a suscité un certain enthousiasme chez certains abolitionnistes, mais aussi rapidement des critiques comme chez Ruth Morris qui a formalisé l’idée de justice transformative en réponse aux limites de la justice restaurative.
Pourquoi ? Parce que la justice restaurative a été développée par l’État et donc son développement participe à celui de la sphère pénale et de l’activité de l’État. Ce qu’on voit avec la loi Taubira (mais il faut rappeler quand même que la France a eu un certain retard par rapport à d’autres pays comme le Canada, les États-Unis, l’Australie), c’est que lorsque l’on met en place la justice restaurative, il y a parallèlement la mise en place de tout un système économique, on observe le développement de formations, d’intervenant-e-s.
Sur le terrain, on voit que cela se traduit parfois des formes d’injonction à se plier à certaines mesures pour des prisonniers condamnés à de longues peines, et donc une peine qui s’ajoute à la peine. C’est l’ajout d’un processus pour des personnes déjà criminalisées, cela n’épouse pas l’idéal abolitionniste qui est de supprimer la sphère pénale.
L’abolition, c’est bien tentant. Mais n’est-ce pas illusoire dans une société capitaliste occidentale ? Existe-t-il des exemples, des expériences qui s’en rapprochent et qui pourrait nous aider à mieux concevoir les formes cela pourrait prendre ?
Alors d’abord il faut rappeler que la justice transformative est née au sein de communautés qui, pour l’essentiel, ne pouvaient pas faire appel au système pénal. En gros : des travailleurs et travailleuses du sexe, des personnes LGBT, des personnes étrangères en situation d’irrégularité donc des personnes qui bien qu’elles soient victimes d’un crime ou d’un délit ne peuvent se rendre au commissariat sous peine de se retrouver elles-mêmes ou leurs proches criminalisés. Donc la justice transformative est certes un espace d’expérimentation et d’autonomisation, mais elle répond aussi à des besoins de justice de communautés qui sont victimes, mais qui n’ont pas accès à la justice pénale. Parce que recourir à la justice pénale, c’est un privilège de classe, de race etc.
D’ailleurs la reconnaissance même de son statut de victime en est un ?
Bien sûr, selon qui on est, selon aussi le récit de victimation, on est ou pas reconnu. Il faut être une « bonne victime » face à un « bon auteur », comme le montrent les analyses de Nils Christie – et donc correspondre à l’ensemble des préjugés que peut accompagner l’imaginaire de l’agresseur. La justice transformative naît donc des besoins des victimes qui ne sont pas pris en charge par le système penal.
Mais une autre chose que je voudrais rappeler, c’est que dans notre vie quotidienne il y a plein de moments où on est dans des situations préjudiciables, où un tort a été commis et où l’on ne fait pas appel à la justice. Et en général, les situations dans lesquelles on ne fait pas appel, sont celles qui impliquent des personnes proches.
Tout ça pour dire que l’on demande souvent des exemples, et ce que l’on peut répondre à ça c’est : regardez ce que vous faites dans vos vies quotidiennes, dans votre vie intime ou professionnelle. Et c’est cela aussi ce qu’apporte Louk Hulsman en nous encourageant à renoncer à la catégorie de « crime » – qui entretient l’idée qu’il y a des situations à part dans nos vies, alors qu’au contraire, on gagnerait à penser cela ensemble diverses formes de préjudice.
C’est aussi sur ce point qu’insiste Nils Christie, le troisième auteur que vous mettez à l’honneur dans le livre avec son texte « A qui appartiennent les conflits ? ». Il estime que les conflits disent quelque chose de nous, de ce que nous sommes, et ils les voient comme une « richesse » dont l’État nous dépossède…
Ce qu’il dit et ce qui peut paraître contre-intuitif, c’est que les conflits sont une richesse mais qu’on est habitué à les penser sous l’angle du manque, de la perte. Quand on dit cela, on ne nie évidemment pas la gravité des préjudices et des torts qui peuvent être subis, mais c’est un encouragement à les voir comme des opportunités collectives pour se rappeler les valeurs sur lesquelles on fonde la vie sociale, pour prendre le temps de discuter de nos conflits. Ce qu’il critique, c’est la professionnalisation de la gestion de nos conflits. Mais là encore, cela fait écho aussi au mode de vie capitaliste qui ne permet pas cette prise de temps, et qui nous force à déléguer.
Dans le dernier chapitre du livre, vous évoquez les nombreux enjeux auxquels se confronte aujourd’hui l’abolitionnisme pénal, que pouvez-vous nous en dire ?
En effet, ce livre donne beaucoup de place à trois auteurs importants mais il s’arrête aussi sur les enjeux auxquels se confrontent aujourd’hui les différents mouvements abolitionnistes. Ma vision est influencée par le fait que je regarde ces évolutions depuis les États-Unis, et plus généralement l’Amérique du nord, mais selon moi il y a plusieurs types d’enjeux :
1- L’articulation entre luttes féministes et abolitionnistes, mais aussi avec la question du racisme et la manière dont on peut penser les luttes abolitionnistes actuelles comme un prolongement de celles pour l’abolition de l’esclavage ;
- – Il y a aussi de nombreuses réflexions autour de la question de l’écologie, à la fois une critique des formes de criminalisation des atteintes à l’environnement. Je pense en particulier à la création du crime d’écocide qui revient pas mal dans les débats. Personnellement, je crois qu’on peut très bien être sur des positions radicales au sujet de l’environnement et critiquer la criminalisation qui accompagne parfois les politiques En parlant d’environnement, se pose aussi la question de l’impact écologique du système pénal, que ce soit en termes d’implantations des prisons. Et là, on peut faire un lien avec le racisme environnemental bien connu aux États-Unis
: les quartiers populaires sont impactés par la pollution, le manque d’accès à certaines ressources comme l’eau. Pareil pour l’implantation des prisons sur des sites pollués, on voit comment la prison crée de la pollution et comment les politiques pénales s’appuient sur du greenwashing, c’est-à-dire sur l’instrumentalisation d’un discours écologique.
- – Un front plus marginal mais pas moins important qui s’ouvre de plus en plus, c’est la question du validisme, de la désinstitutionnalisation des personnes en situation de C’est une question essentielle qui mérite d’être davantage réfléchie, et on voit de plus en plus émerger des alliances entre des luttes politiques de personnes handicapées et des luttes abolitionnistes.
Au-delà du front des luttes, se posent aussi des questions stratégiques. Pour moi, il y a un enjeu important sur lequel je revenais déjà dans Pour Elles toutes : la question de « l’ONGisation » des luttes. Le fait que de plus en plus de luttes s’institutionnalisent et on l’observe de manière presque caricaturale aux États-Unis avec des mouvements qui reposent sur des subventions et sur la philanthropie. Certains analystes critiques parlent de « complexe caritativo-industriels ». L’enjeu des financements, de la recherche de subventions et par conséquent de parts de marché, en viennent à façonner les revendications, mais aussi les moyens de se mobiliser (community organizing) : c’est donc un déplacement, une cooptation des luttes autonomes, originellement portées par les personnes concernées. Et on y perd non seulement du point de vue de l’autonomie des luttes, mais quand le secteur associatif vit de nos existences, il a tendance à nous pathologiser, à nous montrer comme étant des populations qui ont besoin d’être aidées.
Pour terminer, est-ce que vous auriez des livres, des références à conseiller qui vous ont particulièrement marqué ou qui permettent de débroussailler tranquillement ce vaste sujet ?
Il y a Georges Jackson, Les frères de Soledad, qui m’a personnellement beaucoup marqué. Sa correspondance aussi a été très formatrice pour moi. Angela Davis, La prison est-elle obsolète ?; Jackie Wang, Capitalisme carcéral, sont aussi des livres que je recommande. Et j’aimerais terminer sur le livre de Saïd Bouamama, L’affaire Georges Ibrahim Abdallah, pour saluer le militant et le combattant qu’est Georges Abdallah et rappeler qu’il vit sa 37ème année dans les prisons françaises.
Elodie Descamps