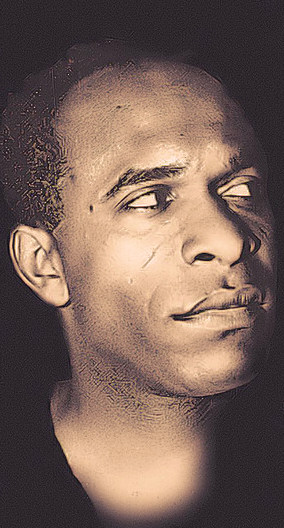La doctrine de la hiérarchie culturelle n’est donc qu’une modalité de la hiérarchisation systématisée poursuivie de façon implacable.
La théorie moderne de l’absence d’intégration corticale des peuples coloniaux en est le versant anatomo-physiologique. L’apparition du racisme n’est pas fondamentalement déterminante. Le racisme n’est pas un tout mais l’élément le plus visible, le plus quotidien, pour tout dire, à certains moments, le plus grossier d’une structure donnée.
Étudier les rapports du racisme et de la culture c’est se poser la question de leur action réciproque. Si la culture est l’ensemble des comportements moteurs et mentaux né de la rencontre de l’homme avec la nature et avec son semblable on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme.
Cet élément culturel précis ne s’est cependant pas enkysté. Le racisme n’a pas pu se scléroser. Il lui a fallu se renouveler, se nuancer, changer de physionomie. Il lui a fallu subir le sort de l’ensemble culturel qui l’informait. Le racisme vulgaire, primitif, simpliste prétendait trouver dans le biologique, les Ecritures s’étant révélées insuffisantes la base matérielle de la doctrine. Il serait fastidieux de rappeler les efforts entrepris alors : forme comparée du crâne, quantité et configuration des sillons de l’encéphale, caractéristiques des couches cellulaires de l’écorce, dimensions des vertèbres, aspect microscopique de l’épiderme, etc…Le primitivisme intellectuel et émotionnel apparaissait comme une conséquence banale, une reconnaissance d’existence.
De telles affirmations, brutales et massives, cèdent la place à une argumentation plus fine. Ça et là toutefois se font jour quelques résurgences. C’est ainsi que la « labilité émotionnelle du Noir », « l’intégration sous-corticale de l’Arabe » « la culpabilité quasi générique du Juif » sont des données que l’on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de J. Carothers, par exemple, patronnée par l’O.M.S. fait état à partir d’« arguments scientifiques » d’une lobotomie physiologique du Noir d’Afrique.
Ces positions séquellaires tendent en tous cas à disparaître. Ce racisme qui se veut rationnel, individuel, déterminé génotypique et phénotypique se transforme en racisme culturel. L’objet du racisme n’est plus l’homme particulier mais une certaine forme d’exister. A l’extrême on parle de message, de style culturel. Les « valeurs occidentales » rejoignent singulièrement le déjà célèbre appel à la lutte de la « croix contre le croissant ».
Certes l’équation morphologique n’a pas disparu totalement, mais les événements des trente dernières années ont ébranlé les convictions les plus encapsulées, bouleversé l’échiquier, restructuré un grand nombre de rapports. Le souvenir de nazisme, la commune misère d’hommes différents, le commun asservissement de groupes sociaux importants, l’apparition de « colonies européennes » c’est-à-dire l’institution d’un régime colonial en pleine terre d’Europe, la prise de conscience des travailleurs des pays colonisateurs et racistes, l’évolution des techniques, tout cela a modifié profondément l’aspect du problème. Il nous faut chercher, au niveau de la culture, les conséquences de ce racisme.
Le racisme, nous l’avons vu, n’est qu’un élément d’un plus vaste ensemble : celui de l’oppression systématisée d’un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici des constantes sont retrouvées. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d’existence. Le langage, l’habillement, les techniques sont dévalorisées. Comment rendre compte de cette constante ? Les psychologues qui ont tendance à tout expliquer par des mouvements de l’âme, prétendent retrouver ce comportement au niveau des contacts entre particuliers : critique d’un chapeau original, d’une façon de parler, de marcher…
De pareilles tentatives ignorent volontairement le caractère incomparable de la situation coloniale. En réalité les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter des cultures. La guerre est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée.
L’asservissement, au sens le plus rigoureux, de la population autochtone est la première nécessité. Pour cela il faut briser ses systèmes de référence. L’expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d’une mise à sac des schèmes culturels ou du moins conditionnent cette mise à sac. Le panorama social est destructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées.
Les lignes de forces, écroulées, n’ordonnent plus. En face un nouvel ensemble, imposé, non pas proposé mais affirmé, pesant de tout son poids de canons et de sabres. La mise en place du régime colonial n’entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l’observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu’une disparition totale de la culture pré-existante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l’avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l’oppression. A la fois présente et momifiée elle atteste contre ses membres. Elle les définit en effet sans appel. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L’apathie si universellement signalée des peuples coloniaux n’est que la conséquence logique de cette opération. Le reproche de l’inertie constamment adressé à « l’indigène » est le comble de la mauvaise foi. Comme s’il était possible à un homme d’évoluer autrement que dans le cadre d’une culture qui le reconnaît et qu’il décide d’assumer.
C’est ainsi que l’on assiste à la mise en place d’organismes archaïques, inertes, fonctionnant sous la surveillance de l’oppresseur et calqués caricaturalement sur des institutions autrefois fécondes… Ces organismes traduisent apparemment le respect de la tradition, des spécificités culturelles, de la personnalité du peuple asservi. Ce pseudo respect s’identifie en fait au mépris le plus conséquent, au sadisme le plus élaboré. La caractéristique d’une culture est d’être ouverte, parcourue de lignes de force spontanées, généreuses, fécondes. L’installation « d’hommes sûrs » chargés d’exécuter certains gestes est une mystification qui ne trompe personne. C’est ainsi que les djemaas Kabyles nommées par l’autorité française ne sont pas reconnues par les autochtones. Elles sont doublées d’une autre djemaa élue démocratiquement. Et naturellement la deuxième dicte la plupart du temps sa conduite à la première.
Le souci constamment affirmé de « respecter la culture des populations autochtones » ne signifie donc pas la prise en considération des valeurs portées par la culture, incarnées par les hommes. Bien plutôt on devine dans cette démarche une volonté d’objectiver, d’encapsuler, d’emprisonner, d’enkyster. Des phrases telles que : « je les connais », « ils sont comme cela » traduisent cette objectivation maximum réussie. Ainsi je connais les gestes, les pensées qui définissent ces hommes.
L’exotisme est une des formes de cette simplification. Dès lors, aucune confrontation culturelle ne peut exister. Il y a d’une part une culture à qui l’on reconnaît des qualités de dynamisme, d’épanouissement, de profondeur. Une culture en mouvement, en perpétuel renouvellement. En face on trouve des caractéristiques, des curiosités, des choses, jamais une structure.
Ainsi dans une première phase l’occupant installe sa domination, affirme massivement sa supériorité. Le groupe social, asservi militairement et économiquement est déshumanisé selon une méthode polydimensionnelle.
Exploitation, tortures, razzias, racisme, liquidations collectives, oppression rationnelle se relayent à des niveaux différents pour littéralement faire de l’autochtone un objet entre les mains de la nation occupante. Cet homme objet, sans moyens d’exister, sans raison d’être, est brisé, au plus profond de sa substance. Le désir de vivre, de continuer, se fait de plus en plus indécis, de plus en plus fantomatique. C’est à ce stade qu’apparaît le fameux complexe de culpabilité. Wright dans ses premiers romans en donne une description très détaillée.
Progressivement cependant, l’évolution des techniques de production, l’industrialisation, d’ailleurs limitée, des pays asservis, l’existence de plus en plus nécessaire de collaborateurs, imposent à l’occupant une nouvelle attitude. La complexité des moyens de production, l’évolution des rapports économiques entraînant bon gré mal gré celle des idéologies, déséquilibrent le système. Le racisme vulgaire dans sa forme biologique correspond à la période d’exploitation brutale des bras et des jambes de l’homme. La perfection des moyens de production provoque fatalement le camouflage des techniques d’exploitation de l’homme, donc des formes du racisme.
Ce n’est donc pas à la suite d’une évolution des esprits que le racisme perd de sa virulence. Nulle révolution intérieure n’explique cette obligation pour le racisme de se nuancer, d’évoluer. De partout des hommes se libèrent bousculant la léthargie à laquelle oppression et racisme les avaient condamnés.
En plein cœur des « nations civilisatrices » les travailleurs découvrent enfin que l’exploitation de l’homme, base d’un système, emprunte des visages divers. À ce stade le racisme n’ose plus sortir sans fards. Il se conteste. Le raciste dans un nombre de plus en plus grand de circonstances se cache. Celui qui prétendait les « sentir », les « deviner » se découvre visé, regardé, jugé. Le projet du raciste est alors un projet hanté par la mauvaise conscience. Le salut ne peut lui venir que d’un engagement passionnel tel qu’on en rencontre dans certaines psychoses. Et ce n’est pas l’un des moindres mérites du Professeur Baruk que d’avoir précisé la sémiologie de ces délires passionnels.
Le racisme n’est jamais un élément surajouté découvert au hasard d’une recherche au sein des données culturelles d’un groupe. La constellation sociale, l’ensemble culturel sont profondément remaniés par l’existence du racisme.
On dit couramment que le racisme est une plaie de l’humanité. Mais il ne faut se satisfaire d’une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité. L’importance du problème raciste dans la littérature américaine contemporaine est significative. Le nègre au cinéma, le nègre et le folklore, le juif et les histoires pour enfants, le juif au bistrot, sont des thèmes inépuisables.
Le racisme, pour revenir à l’Amérique, haute et vicie la culture américaine. Et cette gangrène dialectique est exacerbée par la prise de conscience et la volonté de lutte de millions de noirs et de juifs visés par ce racisme. Cette phase passionnelle, irrationnelle, sans justification, présente à l’examen un visage effrayant. La circulation des groupes, la libération, dans certaines parties du monde d’hommes antérieurement infériorisés, rendent de plus en plus précaire l’équilibre. Assez inattendûment le groupe raciste dénonce l’apparition d’un racisme chez les hommes opprimés. Le « primitivisme intellectuel » de la période d’exploitation fait place au « fanatisme moyen-âgeux, voire préhistorique » de la période de libération.
À un certain moment on avait pu croire à la disparition du racisme. Cette impression euphorisante, déréelle, était simplement la conséquence de l’évolution des formes d’exploitation. Les psychologues parlent alors d’un préjugé devenu inconscient. La vérité est que la rigueur du système rend superflue l’affirmation quotidienne d’une supériorité. La nécessité de faire appel à des degrés divers à l’adhésion, à la collaboration de l’autochtone modifie les rapports dans un sens moins brutal, plus nuancé, plus « cultivé ». Il n’est d’ailleurs pas rare de voir apparaître à ce stade une idéologie « démocratique et humaine ». L’entreprise commerciale d’asservissement, de destruction culturelle cède le pas progressivement à une mystification verbale. L’intérêt de cette évolution c’est que le racisme est pris comme thème de méditation, quelquefois même comme technique publicitaire.
C’est ainsi que le blues « plainte des esclaves noirs » est présenté à l’admiration des oppresseurs. C’est un peu d’oppression stylisée qui revient à l’exploitant et au raciste. Sans oppression et sans racisme pas de blues. La fin du racisme sonnerait le glas de la grande musique noire…
Comme dirait le trop célèbre Toynbee, le blues est une réponse de l’esclave au défi de l’oppression.
Actuellement encore, pour beaucoup d’hommes, même de couleur, la musique d’Armstrong n’a de véritable sens que dans cette perspective.
Le racisme boursouffle et défigure le visage de la culture qui le pratique. La littérature, les arts plastiques, les chansons pour midinettes, les proverbes, les habitudes, les patterns, soit qu’ils se proposent d’en faire le procès ou de le banaliser, restituent le racisme. C’est dire qu’un groupe social, un pays, une civilisation, ne peuvent être racistes inconsciemment.
Nous le disons encore une fois, le racisme n’est pas une découverte accidentelle. Ce n’est pas un élément caché, dissimulé. Il n’est pas exigé d’efforts surhumains pour le mettre en évidence.
Le racisme crève les yeux car précisément il entre dans un ensemble caractérisé : celui de l’exploitation éhonté d’un groupe d’hommes par un autre parvenu à un stade de développement technique supérieur. C’est pourquoi l’oppression militaire et économique précède la plupart du temps, rend possible, légitime le racisme. L’habitude de considérer le racisme comme une disposition de l’esprit, comme une tare psychologique doit être abandonnée.
Mais l’homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialité, comment se comportent-ils ? Quels sont leurs mécanismes de défense ? Quelles attitudes découvrons-nous ici ?
Dans une première phase on a vu l’occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques, la « race inférieure » se nier en tant que race. Parce que nulle autre solution ne lui est laissée, le groupe social racialisé essaie d’imiter l’oppresseur et par là de se déracialiser. La « race inférieure » se nie en tant que race différente. Elle partage avec la « race supérieure » les convictions, doctrines, et autres attendus la concernant. Ayant assisté à la liquidation de ses systèmes de référence à l’écroulement de ses schèmes culturels il ne reste plus à l’autochtone qu’à reconnaître avec l’occupant que « Dieu n’est pas de son côté ». L’oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité en arrive à imposer à l’autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l’égard de ses formes originales d’exister.
Cet événement désigné communément aliénation est naturellement très important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d’assimilation.
Or cette aliénation n’est jamais totalement réussie. Soit parce que l’oppresseur quantitativement et qualitativement limite l’évolution, des phénomènes imprévus, hétéroclites, font leur apparition. Le groupe infériorisé avait admis, la force de raisonnement étant implacable, que ses malheurs procédaient directement de ses caractéristiques raciales et culturelles.
Culpabilité et infériorité sont les conséquences habituelles de cette dialectique. L’opprimé tente alors d’y échapper d’une part en proclamant son adhésion totale et inconditionnelle aux nouveaux modèles culturels, d’autre part en prononçant une condamnation irréversible de son style culturel propre.
Pourtant la nécessité pour l’oppresseur, à un moment donné, de dissimuler les formes d’exploitation, n’entraîne pas la disparition de cette dernière. Les rapports économiques plus élaborés, moins grossiers, exigent un revêtement quotidien mais l’aliénation à ce niveau demeure épouvantable.
Ayant jugé, condamné, abandonné ses formes culturelles, son langage, son alimentation, ses démarches sexuelles, sa façon de s’asseoir, de se reposer, de rire, de se divertir, l’opprimé, avec l’énergie et la ténacité du naufragé se rue sur la culture imposée.
Développant ses connaissances techniques au contact de machines de plus en plus perfectionnées, entrant dans le circuit dynamique de la production industrielle, rencontrant des hommes de régions éloignées dans le cadre de la concentration des capitaux donc des lieux de travail, découvrant la chaîne, l’équipe, le « temps » de production, c’est-à-dire le rendement à l’heure, l’opprimé constate comme un scandale, le maintien à son égard, du racisme et du mépris.
C’est à ce niveau que l’on fait du racisme une histoire de personnes. « Il existe quelques racistes indécrottables mais avouez que dans l’ensemble la population aime… » Avec le temps tout cela disparaîtra.Ce pays est le moins raciste… Il existe à l’O.N.U. une commission chargée de lutter contre le racisme. Des films sur le racisme, des poèmes sur le racisme, des messages sur le racisme…
Les condamnations spectaculaires et inutiles du racisme. La réalité est qu’un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre, en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l’ensemble du pays, ont raison. Il n’est pas possible d’asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n’est que l’explication émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle de cette infériorisation.
Le raciste dans une culture avec racisme est donc normal. L’adéquation des rapports économiques et de l’idéologie est chez lui parfaite. Certes l’idée que l’on se fait de l’homme n’est jamais totalement dépendante des rapports économiques c’est-à-dire, ne l’oublions pas, des rapports existant historiquement et géographiquement entre les hommes et les groupes. Des membres de plus en plus nombreux appartenant à des sociétés racistes prennent position. Ils mettent leur vie au service d’un monde où le racisme serait impossible. Mais ce recul, cette abstraction cet engagement solennel ne sont pas à la portée de tous. On ne peut exiger sans dommage qu’un homme soit contre les « préjugés de son groupe ». Or, redisons-le, tout groupe colonialiste est raciste.
À la fois « acculturé » et déculturé l’opprimé continue à buter contre le racisme. Il trouve illogique cette séquelle. Inexplicable ce qu’il a dépassé, sans motif, inexact. Ses connaissances, l’appropriation de techniques précises et compliquées, quelquefois sa supériorité intellectuelle eu égard à un grand nombre de racistes, l’amènent à qualifier le monde raciste de passionnel. Il s’aperçoit que l’atmosphère raciste imprègne tous les éléments de la vie sociale. Le sentiment d’une injustice accablante est alors très vif. Oubliant le racisme-conséquence on s’acharne sur le racisme-cause. Des campagnes de désintoxication sont entreprises. On fait appel au sens de l’humain, à l’amour, au respect des valeurs suprêmes…
En fait le racisme obéit à une logique sans faille. Un pays qui vit, tire sa substance de l’exploitation de peuples différents, infériorise ces peuples. Le racisme appliqué à ces peuples est normal. Le racisme n’est donc pas une constante de l’esprit humain.
Il est, nous l’avons vu, une disposition inscrite dans un système déterminé. Et le racisme juif n’est pas différent du racisme noir. Une société est raciste ou ne l’est pas. Il n’existe pas de degrés du racisme. Il ne faut pas dire que tel pays est raciste mais qu’on n’y trouve pas de lynchages ou de camps d’extermination. La vérité est que tout cela et autre chose existe en horizon. Ces virtualités, ces latences circulent dynamiques, prises dans la vie des relations psycho-affectives, économiques…
Découvrant l’inutilité de son aliénation, l’approfondissement de son dépouillement, l’infériorisé, après cette phase de déculturation, d’extranéisation, retrouve ses positions originales. Cette culture, abandonnée, quittée, rejetée, méprisée, l’infériorisé s’y engage avec passion. Il existe une surenchère très nette s’apparentant psychologiquement au désir de se faire pardonner.
Mais derrière cette analyse simplifiante il y a bel et bien l’intuition par l’infériorisé d’une vérité spontanée apparue. Cette histoire psychologique débouche sur l’Histoire et sur la Vérité.Parce que l’infériorisé retrouve un style autrefois dévalorisé on assiste à une culture de la culture. Une telle caricature de l’existence culturelle signifierait s’il en était besoin que la culture se vit mais ne se morcelle pas. Elle ne se met pas entre lame et lamelle.
Cependant l’opprimé s’extasie à chaque redécouverte. L’émerveillement est permanent. Autrefois émigré de sa culture, l’autochtone l’explore aujourd’hui avec fougue. Il s’agit alors d’épousailles continuées. L’ancien infériorisé est en état de grâce.
Or, on ne subit pas impunément une domination. La culture du peuple asservi est sclérosée, agonisante. Aucune vie n’y circule. Plus précisément la seule vie existante est dissimulée. La population qui normalement assume çà et là quelques morceaux de vie, qui maintient des significatives dynamiques aux institutions est une population anonyme. En régime colonial ce sont les traditionalistes.
L’ancien émigré, par l’ambigüité soudaine de son comportement introduit le scandale. À l’anonymat du traditionaliste il oppose un exhibitionnisme véhément et agressif.
État de grâce et agressivité sont deux constantes retrouvées à ce stade. L’agressivité étant le mécanisme passionnel permettant d’échapper à la morsure du paradoxe.
Parce que l’ancien émigré possède des techniques précises, parce que son niveau d’action se situe dans le cadre de rapports déjà complexes, ces retrouvailles revêtent un aspect irrationnel. Il existe un fossé, un écart entre le développement intellectuel, l’appropriation technique, les modalités de pensée et de logique hautement différenciées et une base émotionnelle « simple, pure », etc…
Retrouvant la tradition, la vivant comme mécanisme de défense, comme symbole de pureté, comme salut, le déculturé laisse l’impression que la médiation se venge en se substantialisant. Ce reflux sur des positions archaïques sans rapport avec le développement technique est paradoxal. Les institutions ainsi valorisées ne correspondent plus aux méthodes élaborées d’action déjà acquises.
La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère est revalorisée. Elle n’est pas repensée, reprise, dynamisée de l’intérieur. Elle est clamée. Et cette revalorisation d’emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes paradoxales.
C’est à ce moment qu’il est fait mention du caractère indécrottable des infériorisés. Les médecins arabes dorment par terre, crachent n’importe où, etc…
Les intellectuels noirs consultent le sorcier avant de prendre une décision, etc…
Les intellectuels « collaborateurs » cherchent à justifier leur nouvelle attitude. Les coutumes, traditions, croyances. autrefois niées et passées sous silence sont violemment valorisées et affirmées. La tradition n’est plus ironisée par le groupe. Le groupe ne se fuit plus. On retrouve le sens du passé, le culte des ancêtres…
Le passé, désormais constellation de valeurs, s’identifie à la Vérité.
Cette redécouverte, cette valorisation absolue d’allure quasi déréelle, objectivement indéfendable, revêt une importance subjective incomparable. Au sortir de ces épousailles passionnées, l’autochtone aura décidé, en « connaissance de cause », de lutter contre toutes les formes d’exploitation et d’aliénation de l’homme. Par contre l’occupant à cette époque multiplie les appels à l’assimilation, puis à l’intégration, à la communauté. Le corps à corps de l’indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte, pour tolérer une quelconque faille. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence : la plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté.
La fin logique de cette volonté de lutte est la libération totale du territoire national. Afin de réaliser cette libération l’infériorisé met en jeu toutes ses ressources, toutes ses acquisitions, les anciennes et les nouvelles, les siennes et celles de l’occupant.
La lutte est d’emblée totale, absolue. Mais alors, on ne voit guère apparaître de racisme. Au moment d’imposer sa domination, pour justifier l’esclavage, l’oppresseur avait fait appel à des argumentations scientifiques. Ici rien de pareil.
Un peuple qui entreprend une lutte de libération, légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée insurrectionnelle on n’assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l’infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C’est l’opposition désormais classique des luttes de conquête et de libération. En cours de lutte la nation dominatrice essaie de rééditer des arguments racistes mais l’élaboration du racisme se révèle de plus en plus inefficace. On parle de fanatisme, d’attitudes primitives en face de la mort mais encore une fois, le mécanisme désormais effondré, ne répond plus. Les anciens immobiles, les lâches constitutionnels, les peureux, les infériorises de toujours s’arc-boutent et émergent hérissés.
L’occupant ne comprends plus.
La fin du racisme commence avec une soudaine incompréhension. La culture spasmée et rigide de l’occupant, libérée s’ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. Les deux cultures peuvent s’affronter, s’enrichir.
En conclusion, l’universalité réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes une fois exclu irréversiblement le statut colonial.
(Frantz Fanon, 1er Congrès des Ecrivains et Artistes Noirs à Paris, septembre 1956.)