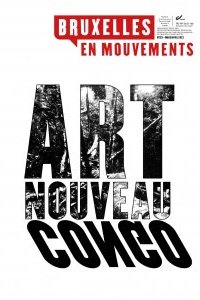par Véronique Clette-Gakuba
En mobilisant Debora Silverman et d’autres travaux de la littérature anglo-saxonne, cet article nous aide à comprendre comment nous sommes profondément affectés par une « esthétique de la Noirceur » produisant un amalgame fantasmagorique entre les corps noirs et les régions supposées sauvages du monde. Une esthétique qui influença profondément l’Art nouveau, mais également le rapport racialisé aux populations noires.
Contrairement aux milieux anglosaxons, les sciences sociales francophones, en Europe, n’ont pas ou très peu traité les liens entre race et esthétique. Le plus courant est de s’en remettre aux siècles de formalisation de la race par les sciences modernes que sont la biologie et l’anthropologie physique (craniométrie, anthropométrie, etc.) comme véritable tournant ayant mené aux doctrines raciales génocidaires. Or, la théorisation de la race se fonde préalablement et surtout se constitue d’abord à partir des catégories de l’esthétique moderne (fin XVIIIe siècle) [1]. Prendre en compte ce lien constitutif entre esthétique et race amène à considérer le fait que les affects raciaux, notamment anti-Noir·es, sont intimement liés aux jugements sur le beau et le laid et à toutes sortes de dispositions sensorielles. Ainsi en est-il de la Noirceur ou de la Darkness.
La noirceur comme esthétique au cœur de l’Europe
Traduit en anglais, le terme « Noirceur » (Blackness) renvoie fortement à la culture afro-américaine et aux gestes de réappropriation positive d’une identité noire par les Afro-Américains et par les personnes noires de manière générale. Si ce geste de réappropriation correspond bien à la « Blackness » ou à la « Négritude », il nous faut aussi regarder le versant négatif de ce terme, chose que le monde francophone n’a pas l’habitude de faire. Ce dernier préfère conserver un rapport sémantique minimaliste à ce terme, faisant comme si, sans amalgame, la Noirceur renvoyait tantôt à un état physiologique (la pénombre), tantôt à un état psychologique (la frayeur), tantôt encore à certains phénotypes (des corps noirs), une couleur en somme. Ce qu’il nous faut penser, comme geste préalable à ces réappropriations positives, c’est la production occidentale de la Noirceur, laquelle ne se réduit pas à une idéologie (racisme anti-Noir·e) mais prend la forme plus substantielle d’une esthétique. Par esthétique de la Noirceur, il faut entendre cet amalgame fantasmagorique (entre les corps noirs et les régions supposées sauvages du monde) représentant l’envers des valeurs vertueuses de la modernité ; un envers racialisé que cette modernité tente continûment de dompter.
Cet amalgame fantasmagorique représentant l’envers des valeurs vertueuses de la modernité ; un envers racialisé que cette modernité tente continûment de dompter.
Art nouveau, darkness et culture impériale belge
L’historienne de l’art Debora Silverman, spécialiste de l’Art nouveau, a qualifié celui-ci de la manière suivante : the Art of the Darkness [2]. Comme d’autres auteurs [3], Debora Silverman postule que la Blackness ou la Darkness existe sur le mode d’une esthétique et que cette esthétique imprègne nos villes, en tout cas Bruxelles, certainement. Pour cette raison, il me semble très intéressant de rendre compte d’une partie de son travail. Contre une « culture du beau » universelle et innocente, son travail nous montre comment les signes raciaux, anti-Noir·es, sont inscrits au cœur de l’art et de la culture modernes belges. Les identifier, réussir à les lire, est une manière de saisir comment une métaphysique de la Noirceur se perpétue malgré nous.
Le travail de Debora Silverman analyse le déploiement de l’Art nouveau à Bruxelles à la fin du XIXe dans ses liens avec la violence du système colonial. Bien sûr, Debora Silverman commence par en établir le lien avec les formes d’accumulation primitive qu’a représentées le régime de Léopold II. En termes de gouvernance, Debora Silverman souligne qu’avec l’État Indépendant du Congo (EIC), il s’agit d’une structure impériale tout à fait inhabituelle : « une colonie anormale sans métropole ». Elle ajoute : « C’est une structure, l’EIC, qui, méticuleusement, évite le terme “colonie” ». Compte tenu de cette gouvernance inhabituelle, la « périphérie », dans le système léopoldien, n’est pas à comprendre au sens de marginalité ou minorité – ce qui signifierait qu’une existence « autre » soit reconnue. La périphérie de l’empire belge naissant, telle qu’elle s’oppose au centre, ce sont, tout entier, les Ténèbres, le lieu de l’extraction illimitée (entre autres d’ivoire, de bois et de caoutchouc). Les matériaux qui permettent à l’Art nouveau de se distinguer proviennent en majeure partie de ce système d’extraction. Debora Silverman décrit les extractions et les déplacements de ces matériaux de nature végétale et animale qui vont se retrouver stockés en abondance dans des hangars à Anvers et à Bruxelles.
Debora Silverman rend compte des accointances entre des gestes architecturaux précis de l’Art nouveau – notamment le style du coup de fouet – et les politiques d’asservissement de la population congolaise par le lynchage (les coups de chicotte).
Parallèlement à cette profusion de matériaux, Debora Silverman soulève de manière plus originale que ces déplacements sont accompagnés des « récits de voyages » des coloniaux, des récits exaltés faisant état d’une nature africaine hors norme et totalement sauvage. Ces récits vont profondément inspirer le travail des architectes tels que Victor Horta et Henry Van de Velde. Le contenu de ces « récits » oriente le geste architectural de l’Art nouveau, notamment à travers la réalisation de lignes esthétiques nouvelles renvoyant à l’image des lianes de caoutchouc entremêlées. Néanmoins l’intérêt de l’analyse de Debora Silverman réside ailleurs. Bien sûr, son travail montre que les créations de ces architectes reposent sur un idéal esthétique représenté par les formes structurelles d’une nature luxuriante (notamment la tige épaisse de la plante de caoutchouc). Mais, plus important, ce que Debora Silverman souligne avant tout, c’est combien l’Art nouveau, dans ses formes expressives, traduit un modernisme impérial, combien il reflète un idéal et un désir d’empire.
Les analyses de Debora Silverman indiquent que ce qui inspire ces artistes, ce n’est pas uniquement « un paysage » qui impressionne, loin de là. Avec un regard très fin qui analyse la manipulation des matériaux, Debora Silverman montre que ces artistes composent avec des « objets blessés », des entités matérielles qui portent la trace de la violence originelle (notamment des morceaux d’ivoire portant des marques de dents d’éléphant témoignant que ceux-ci, violemment agressés, ont dû se défendre). Les formes de l’Art nouveau et ses objets incarnent la posture combattante, la violence et son déguisement. En outre, Debora Silverman rend compte des accointances entre des gestes architecturaux précis de l’Art nouveau – notamment le style du coup de fouet – et les politiques d’asservissement de la population congolaise par le lynchage (les coups de chicotte), des pratiques préconisées aussi bien par le roi Léopold II que par le secrétaire d’État de l’EIC Edmond Van Eetvelde, tous deux commanditaires auprès des artistes de l’Art nouveau.
Depuis ces agencements entre monde de l’art, esthétique et colonialisme, tout le travail de Debora Silverman consiste à analyser le langage visuel de l’Art nouveau. Lignes, courbes, cavités, crochets caractéristiques de l’Art nouveau traduisent sur un plan esthétique le geste colonial principal de la conquête territoriale, celui du domptage d’un environnement supposé sauvage (les Ténèbres). Le geste innovant de l’Art nouveau, qui confère à Bruxelles le titre de « capitale de l’Art nouveau », est directement en prise avec la métaphysique de la Noirceur. À l’aide de Debora Silverman, ce geste de domptage, nous pourrions le qualifier ainsi : un geste qui pénètre le cœur des Ténèbres, le monde obscur, insondable et insoumis de l’environnement congolais, pour en ressortir une architecture moderne aux formes et aux courbes victorieuses.
Parmi les illustrations mobilisées par Debora Silverman, dont le style « coup de fouet », citons en une autre qui fait particulièrement ressortir le lien entre Art nouveau et désir d’empire. Il s’agit d’un projet conçu par Victor Horta pour le pavillon du Congo prévu dans le cadre de l’exposition universelle à Paris en 1900 (projet qui ne sera jamais concrétisé). Les plans montrent que la pièce principale de ce pavillon correspond à la cavité intérieure d’un éléphant. Selon Silverman, cette pièce forme à elle seule la réplique de l’État Indépendant du Congo. Ainsi, l’auteure souligne : « The elephant here was not in the room ; it was the room, and it gave a fitting spatial form to the fictional state and empire at a distance that swelled Belgium and sustained its Art nouveau. » L’éléphant en tant que thème qui, par de multiples variantes, inspire les créations d’Art nouveau est ici le pivot de cette architecture. L’éléphant n’est pas dans la pièce, il est la pièce, souligne Debora Silverman.
L’imaginaire racialisé qui imprègne l’Art nouveau, en tant que production belge, peut continuer à produire ses effets d’éclat esthétique tout en demeurant dans un état de conscience refoulée.
Penser le rôle de l’art dans la production de la négrophobie qui sévit en belgique : partir de l’art nouveau
L’art de la Darkness ou de la Blackness, comme on le voit, ne correspond pas à des images directement négrophobes comme pourraient l’être, par exemple, les représentations de « sauvages » via le Blackface dans le folklore belge. L’art de Darkness ou de la Blackness ne donne pas directement à voir cette Darkness ou cette Blackness. Il s’agit d’une esthétique refoulée, une esthétique qui fixe sur un plan architectural des affects blancs d’opposition existentielle à une nature sauvage (les Ténèbres). C’est une architecture qui signe la victoire sur les Ténèbres. Autrement dit, il nous faut conclure que l’Art nouveau, tout autant que la pratique du Blackface, véhicule une esthétique empreinte du geste colonial de domptage et de domestication des Africains et de leur environnement.
Un imaginaire racialisé imprègne donc l’Art nouveau. Tout comme l’analyse Paul Gilroy pour la culture moderne britannique [4], confondu dans l’idée d’une nature sauvage (les lianes de caoutchouc, l’éléphant, etc.), cet imaginaire racial, en tant que production belge, peut continuer à produire ses effets d’éclat esthétique tout en demeurant dans un état de conscience refoulée. De fait, les critiques d’art sur l’Art nouveau honorent le plus souvent une tradition artistique et culturelle sur un mode ethnocentré niant toute référence à la domination raciale de même que niant toute influence venant de la culture congolaise [5]. Ainsi en guise de proposition décoloniale, l’on pourrait suggérer que cette année 2023 dédiée à l’Art nouveau serve à amorcerune réflexion sur la négrophobie au départ du colonialisme belge comme lieu fort de la production de cette idéologie moderne de la noirceur. Ceci consisterait à prendre au sérieux la responsabilité de l’Art nouveau, ainsi que d’autres productions culturelles, dans la production et la perpétuation d’une négrophobie bien belge.
[1] Voir entre autres les travaux des auteurs anglo-saxons tels que David Bindman, Paul Gilroy, Simon Gikandy et Sander Gilman. Côté francophone, voir les travaux d´Anne Lafont.
[2] Cet article se réfère aux analyses de D. SILVERMAN au départ de son article « Art Nouveau, Art of Darkness : African Lineages of Belgian modernism, Part I » in West 86th, vol. 18, no 2, pp. 139-181.
[3] Voir entre autres, P. GILROY, 1998, « Art of Darkness : Black Art and the problem of belonging to England » In N. Mirzoeff (dir.), Visual Culture Reader, Londres, Routledge, pp. 331-337.
[4] Ibid.
[5] Debora Silverman évoque notamment l’influence des architectures congolaises promues par le roi Munza (fin du XIXe) sur l’Art nouveau.