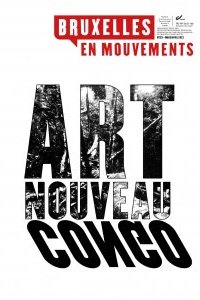par Toma Muteba Luntumbue
Existe-t-il des réalisations architecturales de l’époque coloniale qui ne soient pas imprégnées de l’idéologie coloniale ? L’intérêt récent porté sur les vestiges architecturaux du Congo des Belges nous pousse à questionner le processus de leur « patrimonialisation », entendu comme construction d’un rapport aux objets du passé. Quels sont les enjeux symboliques de la qualification de « patrimoine » attribué aux reliquats de la présence belge pour ceux qui y sont confrontés quotidiennement ? Ces vestiges peuvent-ils ouvrir aux Congolais les portes d’une compréhension de leur passé ?
À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la réplique de la statue équestre du roi Léopold II a été déboulonnée dès 1966, dans une perspective de décolonisation de l’espace public, sans que cette purification ne s’étende massivement à tous les reliquats de l’architecture coloniale, à l’image des processus de désoviétisation dans l’ancien bloc de l’Est ou de la dénazification en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, les bâtiments représentatifs du pouvoir colonial ont été réaffectés directement, à l’instar de l’imposante résidence du gouverneur général, achevée en 1961, après l’accession du pays à l’indépendance, convertie en palais de la Nation. Contrairement aux monuments qui symbolisaient l’oppression coloniale, les Congolais se sentaient les dépositaires légitimes des bâtiments régaliens construits avec l’argent tiré du pillage des ressources naturelles de leur pays.
L’urbanisme colonial respirait l’ambiance d’un état de siège permanent.
La zaïrianisation : le pouvoir sémantique de l’espace
Le « recours à l’authenticité », une révolution culturelle lancée par le président Mobutu, en 1971, voulait en finir avec l’aliénation mentale intériorisée durant l’époque coloniale. La doctrine du parti unique, le MPR, Mouvement populaire de la révolution, imposait à tous les citoyens de vivre désormais au Zaïre selon des standards culturels, politiques, économiques, sociaux authentiquement locaux. Diriger le pays selon un modèle politique « conçu et pensé par nous-mêmes », situé « ni à gauche ni à droite ni même au centre » : les slogans du MPR voulaient modifier la perception que les Congolais, devenus Zaïrois, avaient d’eux-mêmes.
Sous l’égide du MPR, le régime mobutiste va édifier de nombreux bâtiments ambitieux dans leur taille et leur style, débaptiser les noms des rues et des places à consonance coloniale, dans un geste d’affirmation nationaliste et de purification symbolique de l’espace public urbain. Le verticalisme des nouvelles constructions, sur le boulevard du 30 Juin, artère principale du centreville, donnera à la capitale les allures d’un grand centre moderne des affaires au cœur de l’Afrique. Cette volonté de réécriture de l’espace public se heurtera malgré tout à la prégnance du plan d’urbanisme qui matérialise la brutalité du système colonial et sa capacité à utiliser le pouvoir sémantique de l’aménagement urbain comme un espace d’action et de propagande.
Très centralisée, l’administration coloniale avait, par sa structure et son esprit, conservé un aspect militaire. Les gouverneurs et les fonctionnaires étaient souvent des soldats ou d’anciens soldats. Assurée par la Force publique, postée aux points stratégiques, à proximité des infrastructures vitales, aérodromes, zones commerciales, industrielles, TSF, la sécurisation de la ville était une priorité absolue. L’urbanisme colonial respirait l’ambiance d’un état de siège permanent. Il était résolument conçu et pensé en fonction des intérêts coloniaux au mépris de ceux des Congolais.
Modalités de la domination du territoire congolais
Les modalités de la domination du territoire congolais sont déterminées par le décret d’État belge de 1885, par lequel presque toutes les terres congolaises étaient confisquées pour être utilisées ou vendues par l’administration coloniale ou données en concessions à des sociétés commerciales. En toute logique, la toute première réalisation des colonisateurs fut de construire une ligne de chemin de fer dont la vocation était exclusivement exportatrice, c’est-à-dire servait à l’évacuation vers l’Europe des ressources fournies par le sol et le sous-sol. La structure du système ferroviaire contribuera à la destruction des infrastructures socio-économiques locales, à la dévastation des systèmes agricoles, de distribution et de commerce préexistants, au déboisement des forêts et, en définitive, à l’asservissement du territoire entier par le capitalisme colonial.
L’histoire de l’établissement européen est aussi déterminée par l’adaptation d’un environnement réputé hostile à l’homme blanc et à sa transformation pour le conformer à ses mœurs, modes de vie et goûts esthétiques. La perception de l’espace colonial est prédéterminée par les fantasmes et les peurs d’ordre sanitaire des occupants.
À partir des années 1920, les nécessités de contrôle des populations vont inspirer une ségrégation raciale, spatiale et hygiéniste reléguant les colonisés dans des « cités indigènes », tandis que les Blancs occupaient de vastes zones les mettant à l’abri de toute promiscuité dérangeante, qu’elle soit naturelle ou humaine. La même logique prévaudra lorsque les grandes entreprises coloniales, voulant stabiliser la main-d’œuvre, prétexteront une politique sociale en construisant des quartiers planifiés à destination de leurs travailleurs noirs. La doctrine des entreprises adoptera un caractère exclusivement paternaliste autoritaire et qui profitera d’ailleurs, d’abord et essentiellement, à l’entreprise plus qu’au travailleur local. Plus tard, un plan décennal sera élaboré, pour la période 1950-1959, dans le but de soutenir l’expansion économique et démographique de la colonie. Dans ce cadre, l’Office des cités africaines (OCA) créera, sur le modèle des cités-jardins en Europe, des logements dotés d’équipements (écoles, foyers, dispensaires, terrains de sport), qui constitueront autant de moyens de régenter et contrôler la vie des familles congolaises.
La ville, un champ de forces imprévisibles
Il est actuellement hasardeux de caractériser, nommer ou interpréter les mutations de la ville de Kinshasa, constamment débordée par sa propre expansion. Un regard classique pourrait déceler, depuis la période coloniale et l’indépendance, la coexistence de deux grands modèles dans la production de l’espace urbain. Le premier serait composé d’un ensemble de quartiers planifiés, correspondant au territoire de l’ancienne ville européenne, portant un habitat résidentiel, de qualité. Cette schématisation néglige de prendre en compte la précarité de la gestion des infrastructures urbaines, les caniveaux et égouts bouchés, les embarras de circulation qui affectent l’ensemble de la ville. Le deuxième, informel, serait constitué de quartiers populaires de construction spontanée, à forte densité de population, autogérés par les habitants, avec des logements exigus. Privés d’équipements de santé, d’éducation et de services urbains élémentaires, les populations y subsistent en éprouvant les inconvénients de la dégradation du cadre de vie : insalubrité, amoncellement d’ordures, inondations fréquentes, érosion des sols…
Mais la réalité contraste cependant avec cette représentation binaire, car ces deux systèmes urbains entretiennent des liens de dépendance réciproque. Kinshasa reste un champ de forces imprévisibles en constante recomposition. Les quartiers populaires de la périphérie, considérés comme en voie de « villagisation », constituent un réservoir de main-d’œuvre pour les quartiers du centre-ville et ils les approvisionnent en produits vivriers tirés d’une activité intense de maraîchage semi-urbain. La conception qui consiste à penser qu’une ville ne peut être comprise que dans l’extériorité de ses formes architecturales ou sa morphologie est inopérante.
Lubumbashi, vision d’un état du monde
La ville de Lubumbashi, seconde agglomération du pays, doit sa création et son développement à la découverte d’importants gisements de cuivre et à leur mise en exploitation par l’Union minière du Haut-Katanga. Bâtie, en 1910, sur un plan quadrillé à l’américaine, tout y a été conçu et construit en fonction de l’industrie minière : les routes, les usines, les cités modernes faciliteront le développement des entreprises coloniales (UMHK, CSK, Géomines, etc.). Les concessions accordées à l’Union minière du Haut-Katanga s’étendent sur 34 000 kilomètres carrés, soit plus que la superficie de la Belgique et du Luxembourg réunis. Depuis l’indépendance du pays en 1960, la ville va connaître des transformations profondes. En réalité, des décennies de marasme économique, de violences politiques et sociales. De juillet 1960 à janvier 1963, la sécession katangaise, fomentée par l’Union minière, en fera l’éphémère capitale de la république fantoche dirigée par Moïse Tshombé. Lubumbashi gardera les séquelles d’un des épisodes les plus sinistres de l’histoire du pays et, dans la mémoire collective, le souvenir tenace de la malheureuse intervention des troupes de l’ONU.
En novembre 1973, l’échec d’une vaste opération de nationalisations et de confiscations des entreprises détenues par les étrangers, la zaïrianisation, inaugure un début d’effondrement de l’économie de la ville. D’avril 1990 à avril 1997 suit une longue période de transition politique avec son cortège de violences, à savoir les incidents meurtriers sur le campus de l’université de Lubumbashi en mai 1990, les pillages de la ville de Lubumbashi en octobre 1991, les violences communautaires entre Katangais et ressortissants de la province du Kasaï en 1991-1994, la guerre de libération et l’avènement de l’AFDL de Laurent Désiré Kabila en 1996-1997, la guerre d’agression des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises à partir de 1998. En 2003, après une décennie dans la tourmente, le licenciement de 1 000 agents de la société minière Gécamines, gigantesque entreprise étatique, dans le cadre du projet de libéralisation du secteur minier conçu par la Banque mondiale, provoque un véritable séisme social. Si Lubumbashi a beaucoup perdu de son ancienne identité, son urbanisme offre la vision d’un état du monde et de la dégradation des infrastructures et de l’économie du pays, conséquence de facteurs internes et externes.
Défiguration d’un vestige
Situé en plein centre-ville, l’ancien hôtel de poste de Lubumbashi est un bâtiment emblématique, un repère visuel, construit dans le style Art déco. Au-delà de son intérêt architectural, il caractérise la condition urbaine et illustre les antagonismes et divergences d’intérêts des acteurs en lutte pour asseoir leur hégémonie sur la ville. Nous nous attardons sur ce bâtiment en raison des travaux de rénovation qui ont totalement détruit son identité architecturale et l’ont littéralement fait disparaître du paysage de la ville, dissimulé sous d’hideuses plaques métalliques, comme emprisonné dans un sarcophage. Depuis la disparition des services postaux, les réaffections du bâtiment ont été nombreuses. Il a notamment servi comme marché couvert pour les vendeurs de téléphones mobiles.
Comme c’est souvent le cas, les réaffectations motivées par des raisons essentiellement économiques restent aveugles à l’esthétique originelle des bâtiments. Il n’est jamais question de leur restituer le lustre d’antan, bien au contraire. Les interventions sont des véritables attentats esthétiques qui utilisent l’ouvrage dans sa plus simple expression. Tout se passe comme si, par une action concertée, il s’agissait de faire porter un masque drolatique aux vestiges de l’ancienne ville coloniale. Bien souvent, ils sont ripolinés aux couleurs du drapeau national quand il s’agit d’un bâtiment officiel. Ils peuvent, simplement, le plus souvent, être recouverts entièrement de gigantesques bâches publicitaires qui aveuglent totalement leur façade. Les bâtiments nouveaux, que ce soit ceux qui s’élèvent anarchiquement au mépris des normes urbanistiques ou ceux édifiés à l’initiative de l’autorité publique, engendrent les plus vives critiques. D’aucuns s’indignent de la laideur et du manque de caractère des nouvelles constructions qui font perdre en cohérence le paysage architectural du centre-ville.
Enrayer les effets du récit colonialiste
Que peut recouvrir la notion de « patrimoine », sachant que le processus de « patrimonialisation », c’est-à-dire la reconnaissance par un groupe social à un monument, un objet ou un site ayant perdu sa « valeur d’usage » d’une valeur patrimoniale ou en tant que lieu de mémoire. Les pratiques, les expressions, les savoir-faire, les espaces qui leur sont associés constituent ce que les communautés, les groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur héritage culturel. Une telle reconnaissance ne renvoie pas aux mêmes cadres, aux mêmes ressentis, aux mêmes valeurs pour les uns et pour les autres. Ce patrimoine est transmissible aux futures générations, mais il peut en permanence être fabriqué ou réinventé par les communautés elles-mêmes selon leurs besoins, leur contexte, leur histoire et leur procurer un sentiment d’identité et de continuité. Avec le recours à l’authenticité, l’architecture au Congo fut chargée du rôle de reformuler de façon matérielle un nouveau paradigme spatial susceptible de supplanter le récit colonial.
Le patrimoine ne peut être le fruit d’une lecture sélective des faits historiques, qui n’en mettrait en lumière qu’une partie pour en occulter d’autres. L’inventaire des vestiges architecturaux de l’époque coloniale ne saurait rester innocent par rapportà la situation de domination qui a été celle de leur construction. Les noms d’architectes connus ou plus confidentiels ayant exercé leurs talents sous les auspices des pouvoirs coloniaux (gouvernement, sociétés et églises confondus) sont insignifiants pour les usagers de l’espace public d’aujourd’hui. Quelle compréhension avaient-ils du monde ? Quels que soient leurs intérêts sur le plan artistique et technique, l’exploitation patrimoniale des bâtiments coloniaux qui ignore qui sont les commanditaires, bâtisseurs et bénéficiaires initiaux, équivaut à une légitimation de l’idéologie coloniale. L’absence de mesures de protection et de sauvegarde, l’imminence de la dégradation des bâtiments et sites qui constituent l’héritage urbain de la colonisation, ne saurait justifier le regard historiciste, chargé de nostalgie ou de remords. C’est se rendre otage du modèle de la ville coloniale historique et des systèmes de jugements à partir desquels l’Europe a pensé ses propres villes.
L’exploitation patrimoniale des bâtiments coloniaux qui ignore qui sont les commanditaires, bâtisseurs et bénéficiaires initiaux, équivaut à une légitimation de l’idéologie coloniale.
Art nouveau – Art Congo
- « De l’art nouveau au modernisme tropical : problématiser la notion de patrimoine architectural colonial », par Toma Muteba Luntumbue – 12.04.23
CONGO & EXTRACTIVISME
par Martin Rosenfeld, Toma Muteba Luntumbue
Alors que plusieurs articles de ce numéro se sont attachés à décrire les liens entre la volonté de promouvoir l’entreprise coloniale et l’émergence de l’Art nouveau tel qu’il s’est épanoui en Belgique, il est nécessaire de revenir sur les conditions matérielles dans lesquelles étaient – et continuent à être – exploitées les richesses du Congo.
Une interview de Toma Muteba Luntumbue par Martin Rosenfeld (IEB).
Le véritable pillage organisé des richesses était doublé d’une exploitation extraordinairement violente des populations à l’époque coloniale. Mais le regard aiguisé de Toma Muteba Luntumbue montre que les choses n’ont pas fondamentalement changé aujourd’hui. Revenons sur les différentes modalités de cet extractivisme d’alors et d’aujourd’hui dans une interview entrecoupée d’encarts thématiques où Lucas Catherine décrit les grands produits phares d’exportation du Congo colonial utilisés par les artistes de l’Art nouveau.
Le régime criminel de Léopold II décimera de façon violente beaucoup plus d’habitants qu’il n’en aura soustrait à l’esclavagisme des Arabes.
Aujourd’hui, comme il y a plus d’un siècle déjà, pendant la période de domination coloniale de la Belgique sur le Congo, nous semblons avoir une idée très imprécise de la valeur des matériaux que nous utilisons. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les conditions dans lesquelles étaient exploités les produits phares de l’exportation à l’époque coloniale – caoutchouc, mais aussi ivoire, bois et métaux précieux – ainsi que de nos jours ?
Toma Muteba Luntumbue : À la suite d’un décret déposé par Léopold II, en 1891, la plus grande partie du territoire du Congo fut déclarée soit « domaine privé de l’État », soit « domaine de la Couronne ». Ce décret rendait le roi des Belges dépositaire de toutes « terres vacantes », grossièrement tout espace non-cultivé, non revendiqué et situé en dehors des zones habitées de façon permanente par les populations. Les conséquences de ces mesures seront terribles étant donné que les populations utilisaient ces terres accaparées arbitrairement pour tout ce qui était nécessaire à leur subsistance. Avant l’occupation européenne, les techniques agricoles locales consistaient à laisser la terre au repos après quelques années de culture et à se déplacer pour éviter l’épuisement du sol. Des opérations militaires seront menées pour réprimer dans le sang les soulèvements des régions réfractaires à la pénétration coloniale. Les populations seront forcées de s’établir définitivement dans des espaces de plus en plus étroits, soumises à toutes sortes de réquisitions, dont un impôt obligatoire en nature. Dans beaucoup de régions, les cultures vivrières seront négligées, la chasse et la pêche abandonnées, et l’alimentation des populations s’en trouvera considérablement réduite.
Le régime léopoldien instaure une économie de pillage intensif des matières premières ou des produits agricoles. À ce titre, Léopold II est une sorte de précurseur : des arrangements juridico-mafieux lui assuraient le monopole absolu de l’ivoire, du caoutchouc, etc. Cette politique d’exploitation recourait à la terreur, en imposant le travail forcé et des corvées aux habitants. Une milice armée menait des expéditions punitives, des enlèvements d’enfants et de femmes, sans parler des mutilations atroces dont les images ont fait le tour du monde. Les produits récoltés dans ces conditions représentaient jusqu’à 98 % des exportations.
Il n’est pas exagéré d’affirmer que Léopold II avait organisé à son profit, mais sur une plus grande échelle et de façon plus méthodique, les conditions d’esclavage des Congolais. Son régime criminel décimera de façon violente beaucoup plus d’habitants qu’il n’en aura soustrait à l’esclavagisme des Arabes.
À partir des années 1915-16, l’exportation des produits minéraux va constituer l’axe et le pivot d’une économie prédative. Pendant plusieurs décennies les grandes sociétés minières et d’autres sociétés capitalistes mettront en coupe réglée le territoire congolais, en se concentrant sur les ressources susceptibles de procurer le plus de profits. Les bénéfices tirés dépassaient largement ceux que ces sociétés pouvaient obtenir en Belgique. Les conséquences directes du système d’exploitation coloniale sont la décomposition de l’économie traditionnelle, les destructions d’ordre écologique et l’épuisement des forces de travail. En fait, les communautés locales ont été projetées artificiellement dans un système économique qui leur restait totalement étranger. Aujourd’hui, les anciens territoires colonisés sont étranglés par une économie d’exportation de matières premières assujettie aux fluctuations de prix des marchés mondiaux fixés de manière abusive.
Les conséquences directes du système d’exploitation coloniale sont la décomposition de l’économie traditionnelle, les destructions d’ordres écologiques et l’épuisement des forces de travail.
Il est aujourd’hui de plus en plus admis que le projet colonial mis en place par Léopold II au Congo était avant tout une entreprise capitaliste : l’investissement massif dans une série d’infrastructures de transport en vue de l’exploitation de ressources naturelles. Alors que c’est bien toute la force de l’État qui était mis au service d’un tel projet, l’objectif premier était le retour sur investissement, et ce quel qu’en soit le coût social et humain.
Si l’indignation liée au projet colonial, et aux souffrances qui l’ont accompagné, est de nos jours largement partagée, ne retrouve-t-on pas aujourd’hui le même genre de pratiques dans les formes d’extractivismes liées, par exemple, à l’exploitation des métaux rares au Congo ?
T. M. L. : Alors qu’elle se trouvait pratiquement en faillite au début des années 2000, la RDC a été forcée par la Banque mondiale et le FMI de libéraliser son secteur minier dans l’espoir d’attirer les investissements étrangers. Ces mesures avaient pour but d’éviter d’augmenter la dette de l’État et d’apporter les capitaux nécessaires au financement des infrastructures dans l’ensemble du pays. N’ayant plus les moyens de maintenir et développer ses actifs miniers, l’État congolais consent à les céder à des partenaires techniques et financiers internationaux ayant les moyens et les compétences pour les développer à sa place. On considère aujourd’hui que ce fut une erreur fatale. Car d’importants gisements de minerais ont été mis à disposition de sociétés privées dans des conditions opaques, accompagnées d’exonérations fiscales, douanières et autres facilités administratives. C’est en réalité cinq ou six entreprises étrangères (telles que TFM, KCC, Rwashi, Sicomines) qui vont exporter à elles seules plus d’un million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt.
Les contrats de coentreprises passés entre ces sociétés étrangères et les entreprises d’État, à la faveur du code minier de 2002, se sont révélés désavantageux pour le Congo. L’entreprise de l’État, la Gécamines, qui a la charge de la gestion des ressources minières du pays, n’étant dans les faits qu’un partenaire minoritaire qui n’a pratiquement rien à dire.
La mégestion du portefeuille minier par les entreprises d’État congolaises et la corruption à différents échelons, les royalties non versées au trésor public, le soupçon de surfacturation des travaux et l’absence de tout contrôle parlementaire témoignent de la défaillance endémique de la gouvernance de tout ce qui touche au secteur minier. Nous sommes toujours dans un système de mines hérité de la colonisation qui ne bénéficie pas à la population congolaise. Jadis, l’économie coloniale était aux mains de quatre sociétés qui se subdivisaient en succursales pour échapper à l’impôt en Belgique et maximiser leurs profits. Aujourd’hui, cette économie prédatrices profite de la faiblesse de l’État et de l’absence de transparence dans l’octroi des licences, dans la mise en œuvre de mesures fiscales, et dans la lutte contre la corruption.
Le bilan est accablant après quinze-vingt ans, car les dividendes promis par la Gécamines, les impôts devant permettre à l’État de se reconstruire, n’ont jamais été versés. La vérité est que ces entreprises ont utilisé les gisements pour les donner en garantie à des banques étrangères afin d’emprunter au lieu d’apporter des capitaux. Ce sont des prêts qu’elles ont apportés à la place des capitaux promis. Comme à l’époque coloniale, ce sont des entreprises étrangères et leurs filiales – si pas occidentales, aussi désormais chinoises – qui détiennent les richesses du Congo. Richesses qui ne profitent pas aux Congolais dont l’immense majorité vit avec moins de 2,15 dollars par jour. On s’est par exemple aperçu que la Sicomines, coentreprise, entre la Gécamines et plusieurs sociétés chinoises, vendait les minerais congolais à moitié prix aux entreprises chinoises.
Lorsque l’État congolais était le seul actionnaire, il produisait 500 000 tonnes de cuivre par an, la Gécamines survenait alors à près de 70 % des besoins budgétaires de l’État. Aujourd’hui, avec plus d’un million de tonnes exportées, les entreprises ne contribuent même pas à 17 % des revenus de l’État. Victime de décennies de conflits, de fragilité et de développement contrarié, la RDC est devenue l’un des cinq pays les plus pauvres du monde.
Du fait des contrats léonins signés avec les opérateurs étrangers, l’État congolais est obligé de se rabattre sur le maigre secteur des mines artisanales qu’il peut encore contrôler.
Alors que la Belgique et le reste de l’Europe découvraient, dès la fin du xix e siècle, la richesse des produits du Congo à l’occasion des expositions coloniales, très peu était connu des conditions de production imposées aux populations locales. N’y a-t-il pas aujourd’hui le même genre de cécité, au moins partiellement volontaire, vis-à-vis des conditions actuelles d’exploitation des ressources du Congo, notamment en ce qui concerne les métaux rares ?
T. M. L. : La RDC produit 60 % du cobalt mondial, intrant principal dans la fabrication des batteries de véhicules électriques et des systèmes de stockage dont la demande croissante suit la progression des marchés de l’énergie. Mais on estime également à un quart la production de cobalt passant par le marché noir. La société australienne AVZ Minerals a mis au jour un gisement de lithium d’excellente qualité estimée à 400 millions de tonnes, soit la plus importante ressource non exploitée au monde. Le lithium est indispensable pour les batteries électriques. La Chine étant le seul pays ayant actuellement la capacité industrielle de transformer ce lithium en batteries, 90 % y sont exportés ou alors il est acheté/commercialisé de façon opaque sur place.
Depuis la libéralisation du secteur minier, les mines artisanales à ciel ouvert pullulent dans le Sud et l’Est du Congo. Des femmes et des hommes travaillent à mains nues ou creusent avec de simples pieux pour trouver les minerais de coltan, de cobalt ou de cassitérite, un minerai contenant de l’étain. Les creuseurs artisanaux, qui peuvent être structurés en coopératives, sont contraints de vendre sur place à des sociétés qui leur achètent au rabais, car l’État leur interdit désormais d’acheminer la marchandise en ville. Du fait des contrats léonins signés avec les opérateurs étrangers, l’État congolais est obligé de se rabattre sur le maigre secteur des mines artisanales qu’il peut encore contrôler.
Les conditions d’exploitation des métaux rares portent les stigmates du système colonial qui les a fait naître. Le modèle de coopération apporté par la Chine en Afrique, même s’il connaît des ratés, a la vertu d’être en rupture avec ces pratiques brutalistes d’antan en s’appuyant sur l’extraction des matières premières en échange d’infrastructures : construction de routes, ports, barrages, hôpitaux, stades, écoles. Même si ces travaux sont intégralement pris en charge par des entreprises chinoises et réalisés par des ouvriers chinois.
Qu’entend-on lorsque l’on parle d’extractivisme à propos du Congo, que ce soit à l’époque coloniale ou aujourd’hui ?
T. M. L. : Lorsqu’on évoque le régime colonial, on se rend effectivement compte qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, que l’extractivisme n’est pas une pratique récente. Nous sommes dans la continuité d’un système aux contours mafieux, dont le principe consiste à exploiter des ressources naturelles, d’en tirer profit par une commercialisation, en général sur le marché global, au mépris de la réalité locale, des droits humains et environnementaux. Ce qui diffère toutefois de l’époque coloniale, c’est l’ampleur et l’intensité avec lesquelles la surexploitation des ressources naturelles s’effectue aujourd’hui et, surtout, l’exacerbation de notre sensibilité face aux conséquences brutales et incontrôlables sur le plan environnemental, telles que le changement climatique et la disparition en temps réel des espèces. Les effets de l’extractivisme pour le Congo, c’est principalement la guerre, la violence inouïe, les dommages causés par l’exploitation minière, la déforestation, l’extrême pauvreté de la population d’un pays considéré comme potentiellement le plus riche d’Afrique ou, du point de vue de ses ressources naturelles, comme un des plus riches du monde. L’extractivisme, c’est aussi la trop longue cécité ou l’indifférence internationale devant le nombre de victimes directes et indirectes de ce système.
La question qui se pose lorsqu’on en a pris la mesure, ou qu’on en subit directement les effets, c’est comment attirer l’attention du monde sur les limites et l’épuisement de nos écosystèmes ? Faire appel à une autre vision du monde, résolument anticapitaliste qui bannit l’extractivisme comme système productif et modèle de développement. L’amélioration des conditions de vie des Congolais passe par le retour aux fondamentaux d’une gouvernance responsable et transparente. Une transition sociale-écologique qui privilégie une démarche holistique qui profite davantage à la population.
— –
L’histoire cachée des bois préférés de l’art nouveau
Dès la fin du XIXe siècle, le bois tropical devient un produit d’exportation très rentable pour l’État libre du Congo. Il provient principalement de la région du Mayumbe, dans le Sud-Ouest. La première concession pour l’exploitation de bois tropicaux a été cédée par Léopold II à la maison des Frères Fichefet. Une première cargaison arrive à Anvers le 27 avril 1894, à temps pour que ce bois puisse être exposé durant l’Exposition universelle d’Anvers qui ouvre ses portes à la fin de cette année-là.
Les frères Fichefet vont créer un véritable empire avec quatre entreprises, mais aussi la construction d’une scierie et d’un entrepôt près de Grand-Tilleul, juste à côté du palais royal de Laeken. Le traité conclu avec l’État congolais de Léopold II prévoit de leur fournir au minimum 1 000 mètres cube de bois par an, payé au prix minimum de 80 francs par mètre cube. Ce bois provient d’une concession située le long de la rivière Shiloango. Dans un premier temps, le bois est transporté en le laissant dériver vers le sud le long de la rivière, mais de nombreux troncs sont perdus de cette façon. C’est pourquoi est lancé, dès 1898, le projet des Chemins de fer vicinaux du Mayumbe auquel participe Eugène Fichefet via sa société La Luki qui faisait, en plus du bois, le commerce du cacao et du caoutchouc. Suite à une série de difficultés et à un scandale financier, le chemin de fer ne sera finalement entièrement achevé qu’à l’aube de la Première Guerre mondiale.
À l’approche de l’exposition coloniale de Tervuren, le bois tropical du Congo commercialisé par les Fichefet est encore abondant et est gratuitement mis à disposition des artistes d’un Art nouveau naissant. On le retrouve dans toutes les salles de l’exposition – du Salon d’honneur à la Salle des exportations – ainsi que dans les voitures du tramway conduisant les visiteurs les plus fortunés à Tervuren. Le bois congolais commercialisé par les Fichefet est utilisé dans des bâtiments aussi prestigieux que le Palais royal, le château d’Andenne, la villa royale de Ciergnon ou encore le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Pour ce dernier, c’est Henry Le Bœuf, alors directeur de quatre compagnies coloniales, qui prend l’initiative de commander le bâtiment à Victor Horta.
C’est donc avec l’exposition de Tervuren que débute la gloire de certains parmi les plus recherchés des bois du Congo. Le plus connu, aux débuts de l’Art nouveau, est le ngulu maza : l’acajou jaune du Congo. Omniprésent dans le Salon des cultures de l’exposition de Tervuren, ce bois jaune flamboyant provient d’un arbre qui pouvait atteindre 60 mètres de haut pour un diamètre de 2 mètres. Le nom ngulu maza signifie cochon d’eau en référence à la texture de son écorce qui rappelle celle de l’animal. Les Congolais l’utilisaient principalement pour construire des canoës.
Le senia mazi, utilisé entre autres dans les voitures de tramway exposées par la société Fichefet à Tervuren, est également une forme d’acajou.
Le limba, utilisé à Tervuren pour décorer le Salon des importations, est un bois rose provenant d’un arbre pouvant atteindre 50 mètres de haut.
Enfin, le sekegna, une autre variété d’acajou, est d’un rouge intense qui explique son utilisation, par les Congolais, pour teindre leurs pagaies, paniers et tissus. Son fruit, appelé mugoria, est également un mets très convoité.
Et puis il y a l’ébène : bota ou mbota mazi, rendu très populaire pour la sculpture de petits objets tels que des piédestaux dont le noir intense tranche avec la blancheur des pièces d’ivoire amenés à y prendre place.
Après l’arrêt quasi total de l’approvisionnement en bois tropical congolais, des stratégies de remplacement sont mises en place. Notamment en utilisant du « faux bois », c’est-à-dire des peintures en trompe-l’œil, mais aussi des carrelages décoratifs aux motifs Art nouveau. Ceux-ci proviennent d’Allemagne, de France, ainsi que de Belgique, notamment via la célèbre société Boch de La Louvière.
Lucas Catherine
— –
L’art (nouveau) et l’ivoire
C’est à nouveau à l’occasion de l’exposition coloniale de Tervuren que l’ivoire fait son apparition dans l’Art nouveau. Notamment via Philippe Wolfers, le bijoutier bruxellois, qui remet à l’honneur la sculpture chryséléphantine. Il s’agit d’œuvres combinant l’ivoire (l’éléphantine) avec des métaux précieux tels que l’argent. Le catalogue de l’exposition de Tervuren consacre un chapitre entier à cette sculpture chryséléphantine et fait remonter ses origines aux Gaulois, aux Grecs et aux Romains de l’Antiquité.
L’ivoire, avec les bois tropicaux, était alors le produit d’exportation le plus important du Congo. Tout l’ivoire congolais était commercialisé à Anvers, qui a ainsi détrôné Londres pour devenir le plus grand marché mondial de l’ivoire. L’ingénieur Van Wincxtenhoven, fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, écrit dans son rapport pour l’exposition de 1894 à Anvers : « L’ivoire a permis des entreprises hardies, telles que des voyages de reconnaissance, l’occupation de territoires les plus éloignés […] et la création de grandes routes de transports, entreprises qui sans l’existence au Congo de cet article précieux n’auraient pas été possibles. »
Alors que l’ivoire rencontre un succès grandissant en Europe, notamment pour sa facilité de sculpture, les défenses d’éléphant n’étaient pas particulièrement recherchées par les Congolais. Pour eux, un éléphant était avant tout de la viande, beaucoup de viande. Au cours de la première grande révolte contre la colonisation, la révolte des Batetela, le chef Mulamba déclare d’ailleurs à un missionnaire pris en otage : « Nous ne tuons les éléphants que pour la viande, pas pour l’ivoire. » Il libère ensuite le prêtre et lui remet une grande défense d’éléphant en commentant : « comme ça, vous ne pourrez pas dire en Europe que nous vous avons volé ». Parmi la chair d’éléphant, le morceau le plus apprécié par les Congolais est la trompe. En swahili, celle-ci se dit tembo, un terme souvent utilisé pour désigner l’éléphant en entier. L’une des plus célèbres bières coloniales, brassées au Katanga, s’appelle d’ailleurs la Tembo. Au cours du voyage d’inauguration du premier chemin de fer au Congo, en 1898, le journaliste Camille Verhé, envoyé par Het Laatste Nieuws, écrit : « Entre autres choses, nous avons mangé de la trompe d’éléphant dont, non informé, on aurait dit que c’était de la langue de bœuf. »
La défense d’éléphant est commercialisée en trois parties. La partie la plus précieuse est la pointe, car elle est pleine. C’est ce qui permet d’en faire, entre autres, des boules de billard. Les deux autres morceaux étant creux, leur valorisation est plus difficile. Pour les Congolais, la pointe de la défense est le seul morceau utile. Notamment pour la construction de marteaux utilisés dans la transformation de l’écorce d’arbres tropicaux en fibres textiles. L’écorce est d’abord trempée dans l’eau pendant plusieurs jours, avant que les fibres ne soient détachées au marteau. Celles-ci sont ensuite tissées. Ce processus a très largement disparu avec l’importation massive de textiles européens.
Le commerce de l’ivoire en provenance du Congo va atteindre des proportions gigantesques. Durant la période 1897-1907, il a par exemple été vendu 2 333 tonnes d’ivoire congolais à Anvers. Avec un poids moyen de près de 8 kg par défense, et en comptant deux défenses par éléphant, on arrive au chiffre énorme de 13 255 bêtes tuées en moyenne chaque année sur la période ! Ce n’est que depuis 1989 que le commerce de l’ivoire est interdit dans le monde entier. En 1979, on comptait encore près de 1,2 million d’éléphants en Afrique. Dix ans plus tard, ce chiffre avait diminué de moitié. Aujourd’hui, l’éléphant est d’ailleurs menacé d’extinction au Congo et si un Congolais veut voir un éléphant, il a sans doute plus de chances de le voir au zoo d’Anvers qu’au zoo de Kinshasa, qui ne possède plus aucun spécimen…
Lucas Catherine
Art nouveau – Art Congo
- « Congo & extractivisme », par Martin Rosenfeld, Toma Muteba Luntumbue – 12.04.23