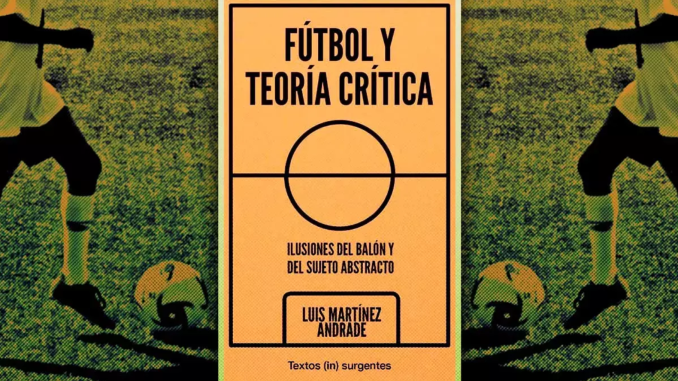Extrait de Fútbol y Teoría crítica de Luis Martínez Andrade. En mobilisant sciences sociales et références littéraires, il regarde l’assassinat d’Andrés Escobar à travers la figure religieuse du “bouc émissaire” dans un football à l’image de la société spectaculaire marchande.

Le rapport entre les intellectuels et le football n’a jamais été une lune de miel. Même si Eduardo Galeano et Manuel Vázquez Montalbán se sont efforcés à démonter les préjugés (de classe?) de ceux qui s’évertuent à répandre de l’encre contre le football, la défiance envers le ballon rond demeurant présente chez la majorité des écrivains. Qui n’a pas entendu la célèbre légende de la conférence que Jorge Luis Borges a décidé de tenir le même jour et à la même heure que le match de l’Albiceleste face à la Hongrie lors du Mondial 78? Qui peut rester imperturbable devant la déclaration d’Aleksander Rański, personnage principal d’Un homme dans l’ombre (Człowiek w cieniu) de l’écrivain polonais Eustachy Rylski, quand il soutient que les journaux de football aident à nous familiariser avec l’espèce la plus répugnante de la vulgarité?
Heureusement, il a existé quelques écrivains qui ont utilisé le football comme une ressource littéraire légitime, allant même jusqu’à en faire le sujet central de certaines de leurs œuvres. Je pense par exemple, sans faire une liste exhaustive, à l’écrivain russe Iouri Olecha, au Serbe Svetislav Basara, aux Croates Ivica Đikić et Miljenko Jergović, à l’Italien Pino Cacucci, au Français Laurent Mauvignier, au Belge originaire de Namur Olivier El Khoury, à l’Espagnol Carlos Marzal, aux poètes brésiliens Olavo Bilac et Carlos Drummond de Andrade, à l’Uruguayen Mario Benedetti, aux Argentins Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Soriano et Eduardo Sacheri, au Chilien Roberto Bolaño ou au Colombien Ricardo Silva Romero.
A propos de ce dernier, j’aimerais me concentrer sur son roman Autogol (traduire “But contre son camp”) qui raconte l’assassinat de sang-froid du footballeur colombien Andrés Escobar Saldarriaga en juillet 1994. A travers l’histoire de Pepe Calderón Tovar, un chroniqueur sportif abandonné par son épouse, ruiné pour avoir parié (l’aléa du jeu) toutes ses économies sur la sélection dirigée par Francisco Maturana au Mondial 94, on revit non seulement les exploits les plus incroyables de l’équipe nationale colombienne (par exemple, la raclée 5-0 infligée à l’Argentine au stade Monumental), mais aussi certains événements qui ont dessiné la tessiture socio-politique du pays du vallenato et de la cumbia: le rôle de la violence politique (répression des guerrillas liberales, assassinat de ministres et de personnalités par les différents acteurs armés), le poids du trafic de drogue (qui s’exprime dans le lien entre les cartels et la classe politique) et, bien sûr, la décomposition du tissu social d’un peuple marqué par l’ignominie de ses élites.

L’histoire commence quand Pepe Calderón reste sans voix alors qu’il observe avec stupéfaction le ballon aller au fond des filets après une déviation malencontreuse d’Escobar, lors de ce match tristement célèbre du 22 juin 1994 contre les États-Unis. Pepe Calderón, “le poète”, n’en croit pas ses yeux. Comme beaucoup de ses compatriotes, il a été de l’écœurante propagande médiatique qui a fait croire que la Colombie pouvait ramener la Coupe du Monde à la maison. Ses économies, comme sa voix, sont parties en fumée à la 36e minute. Toutefois, Autogol nous permet de comprendre, d’un côté, l’aphasie comme une “apoplexie d’émotions”, caractéristique de la “structure du sentiment” des sociétés où le narcotrafic est devenu un acteur central (phénomène très bien étudié par l’essayiste mexicain Carlos Ramírez Vuelvas) et, de l’autre, le meurtre sacrificiel (analysé par l’anthropologue René Girard avec la figure du bouc émissaire).
Dans Refractions of Violence, Martin Jay, historien et spécialiste de l’École de Francfort, fait une remarque très évocatrice sur les paradoxes de la violence religieuse. Pour Jay, la relation entre sacré et violence, déjà présente dans le paganisme grec, est une caractéristique du phénomène religieux. Se référant aux postulats de Walter Burkert, René Girard et Georges Bataille, Martin Jay souligne que “le meurtre sacrificiel est l’expérience commune du sacré” et arrive à la conclusion que tout acte de grâce est couvert de sang. Pour notre part, nous pensons que l’assassinat d’Andrés Escobar doit être lu, en terme social et culturel, comme la banalisation de l’impunité d’une société pervertie par l’appât du gain et l’odeur des balles. Et il doit être interprété, en terme théologique, comme le sacrifice inutile d’une religion idolâtrique promue par les princes de la FIFA, les patrons des multinationales, les maîtres des médias et, évidemment, par les fidèles et passifs croyants (sujets abstraits) du spectacle sportif. Andrés Escobar a malheureusement été un bouc émissaire d’une société plus malade de la consommation débridée des élites que de la misère d’une large frange sociale pervertie par l’argent et le pouvoir, mutilée par une guerre qui n’en finit plus et abimée par l’absence de protection sociale et individuelle.
La littérature et le football peuvent parfois faire jaillir la misère humaine que la méprisable société du spectacle tente de camoufler. En somme, Autogol de Ricardo Silva Romero n’évoque pas seulement le toque bien élevé du “Pibe” Valderrama, les problèmes de “Barrabas” Gómez ou les aventures du “Tino” Asprilla mais, surtout, les mystères de la condition humaine.

“Le football est un miroir du système et, sans aucun doute, il est aussi un champ de bataille au-delà de l’aspect purement sportif.” Cet essai en langue espagnole, propose une analyse marxiste influencée autant par Walter Benjamin que par Eduardo Galeano.
Avec cet ouvrage sorti en juin dernier aux éditions barcelonaises La Vorágine, à quelques mois d’une des Coupes du Monde les plus contestées de l’Histoire, Luis Martínez Andrade – originaire de Puebla au Mexique – apporte sa pierre à l’étude et à la compréhension du football et des enjeux qui l’entourent. Il livre, selon les mots de son éditeur, “une cartographie de la pensée critique contemporaine et de l’étude des formes perverses et eurocentrées du capitalisme et de la modernité“.
Prenant le contre-pied de la déconnexion d’une grande partie des intellectuels de gauche et leur mépris du ballon rond, l’auteur revisite certaines pages tragiques de l’Histoire du 20e siècle par le prisme du football: guerre de “Cent heures”, Tchernobyl, génocide au Rwanda, guerre des Balkans, etc. Luis Martínez Andrade s’attache à étudier les contradictions d’un football qui n’a cessé d’épouser les mutations du capitalisme occidental et d’être instrumentalisé par les régimes dictatoriaux, ainsi que par les nationalismes de tout bord, tout au long du 20e siècle.
Quand Diego Maradona rencontre Walter Benjamin
A travers de courts textes formant une trentaine de chapitres, Fútbol y Teoría crítica consacre plusieurs pages aux ravages du thatcherisme sur le football, conséquence directe de la mise au pas de la classe ouvrière britannique; il revient aussi sur des expériences utopiques comme celle de la légendaire Démocratie Corinthienne durant la dictature brésilienne au début des années 80, ou encore sur le “Match de la mort” du FC Start ukrainien face à l’occupant nazi en 1943.
L’essai de 200 pages réussit le pari de la rencontre inattendue entre des personnages comme Diego Maradona, Rino Della Negra ou Juan Román Riquelme, et les figures de l’École de Francfort, principalement Walter Benjamin à qui l’auteur emprunte son approche dialectique de l’Histoire. Un exemple parmi d’autres, “Le dernier mohican” analyse la disparition du numéro 10 classique, sacrifié par le football moderne, comme un dommage collatéral de l’accélération générale de la société, théorisée par Hartmut Rosa.
La lecture de Fútbol y Teoría crítica nous conforte dans l’idée que le football n’est pas le territoire perdu de la critique auquel une partie de l’intelligentsia de gauche semble vouloir le réduire. Au contraire, s’il est un miroir de la société capitaliste, alors il en reflète aussi les antagonismes et les résistances. On ne peut que partager la conclusion du prologue du livre de Luis Martínez Andrade: “Nous ne devons plus permettre aux puissants de s’enrichir avec le football. De la même manière que nous les exproprierons des moyens de production, nous leur arracherons le ballon des pieds.” À bon entendeur.
Football et théorie critique
Jean-Louis Laville
21/11/2022
Merci Luis : ces mots beaucoup les ont pensés ou prononcés après le France-Brésil de 1986, l’un des plus beaux matchs de l’histoire que la fabuleuse équipe brésilienne méritait de gagner mais Luis Fernandez en marquant son tir au but a fait pencher du côté français. Je voudrais adresser aujourd’hui un autre « merci Luis » à Luis Martinez Andrade pour son formidable livre « Futbol y Teoria critica »[1] paru en espagnol mais qui, je l’espère, fera bientôt l’objet d’une traduction française.
Sa lecture est plus que recommandée au moment où commence la Coupe du monde la plus meurtrière (avec six mille cinq cents ouvriers morts au Qatar sur les chantiers, soit le bilan le plus honteux d’une compétition qui a pourtant connu les précédents de l’Argentine pendant la dictature ou de la Russie poutinienne). Le livre nous rappelle comment le football est gouverné par une organisation « maffieuse », la Fédération internationale de football association (FIFA). Ses dirigeants poussent au paroxysme la commercialisation et l’intégration à la société du spectacle, quant à leurs œuvres humanitaires elles évoquent à l’auteur les dons « des cartels de la drogue qui se présentent comme les protecteurs des populations » alors qu’ils en sont les « vrais bourreaux » (p. 202).
Première originalité : l’ouvrage montre que le football illustre certaines des thèses défendues par les écrivains de la théorie critique, comme si Theodor Adorno descendait de la chambre confortable de l’hôtel où il cultivait son pessimisme[2] pour venir s’encanailler dans la rue, jouer et dribbler les défenseurs d’un football aseptisé et robotisé. C’est sûr, le jeu est devenu un instrument de domination culturelle. Ainsi, en 1994, les médias ont consacré plus de place « aux rencontres des sélections du Cameroun et du Nigéria qu’à l’extermination de la population Tutsi » (p. 128), se détournant par ailleurs des responsabilités belges, dans « l’invention des nomenclatures ethniques de Hutu et Tutsi » et françaises, dans l’évacuation par l’armée « des principaux coupables du génocide » lors de l’Opération Turquoise (p. 129). Le football peut masquer la violence sur les écrans mais aussi la déclencher dans les stades comme l’ont fait en Serbie les « supporters-guerriers » : « produit de l’Etat et expression du syndrome de décadence, Arkan et ses tigres ne devaient pas être vus comme le résultat accidentel d’une dérive ou d’un déraillement de la rationalité instrumentale moderne mais plutôt comme son destin inévitable » (p. 151) si l’on suit Erich Fromm[3]. Oui, Dracula « vit encore » non seulement « dans les décombres de la cave », comme le souligne Carl Amery[4], mais aussi souvent « dans les gradins » (p. 163-165).
Pourtant, Lilian Thuram le souligne « dans la vie comme dans le football le déterminisme n’est pas absolu »[5]. C’est pourquoi, recevant une passe du joueur engagé dans la lutte anti-raciste, Andrade se démarque de Jean-Marie Brohm, fondateur d’une théorie critique du sport et réclamant son abolition puisqu’il est devenu un vecteur privilégié du renforcement de l’aliénation. C’est la seconde originalité du texte : recevant une autre passe, cette fois-ci d’Eduardo Galenao, Andrade qui a rencontré en Europe le mépris des intellectuels pour le sport populaire, ne s’y résout pas. Dans le stade où la haine menace souvent peut, néanmoins, s’immiscer l’expérience de la civilité, je l’ai vécu à Bordeaux quand nous allions voir jouer les Girondins avec mon père et mon frère et que nous engagions des discussions impromptues avec les voisins dans lesquelles les désaccords ne fournissaient pas matière à affrontements mais plutôt à plaisanteries.
Je n’oublie pas non plus les bancs du stade Bauer à Saint-Ouen quand le « beau jeu » enflammait la tribune Rino Delle Negra, ainsi nommée en hommage à l’ailier droit du Red Star fusillé par les nazis en 1943. « Une étoile ne meurt jamais ! » (p. 85-90). L’illumination, c’est aussi celle, cette fois avec mes enfants, quand nous admirions au Parc des Princes ce que l’on ne voit jamais à la télévision, c’est-à-dire la justesse et l’intelligence de cette transmission de quarante mètres effectuées en aveugle par Raï, surprenant ses co-équipiers et désarçonnant ses adversaires. Raï est par ailleurs le frère cadet de Socrates, l’un des animateurs de la « Démocratie corinthienne », l’équipe auto-gérée par ses membres devenue symbole, au tournant des années 1980, de la résistance aux militaires (p. 101-105), en 2022 il sauve encore l’honneur des footballeurs brésiliens en s’opposant fermement à Jaïr Bolsonaro dans la campagne électorale alors que nombreux sont ceux qui servent sa propagande abjecte.
Et puis, nul ne peut effacer de sa mémoire « la réalisation de ce que nous pourrions appeler une splendeur ». Dans ces moments magiques, surgissent « la transe et la délectation » venues de « la dramatique expressivité du jeu, un mouvement de libre association entre les joueurs » (p. 16). Même si cette fulgurance disparaît vite, si « nous reprenons haleine » et si « l’horreur reprend son cours « (p. 16), reste le souvenir qui entretient notre autre relation au football, réactivée par des remémorations au sens de Walter Benjamin.
Dans le sport comme ailleurs, si le désastre s’installe, perdurent des utopies concrètes selon les termes d’Ernst Bloch qui sont des « préfigurations d’autres formations sociales (moins destructives) » (p. 101).
La Théorie critique dont nous avons besoin ne peut entretenir la désespérance, elle est à nourrir par ces contrepieds qui déséquilibrent les autorités les plus établies. Terminons donc par un dernier contrepied, décolonial celui-là : si la migration européenne a été un déclencheur de la naissance et du développement du football argentin, l’Argentine a été fondamentale pour l’origine et l’essor de la Théorie critique en Europe. En effet, Felix José Weil, dont la famille avait fait fortune dans le commerce de grains, en plus d’un militant du mouvement ouvrier a été le mécène de l’école de Francfort. Les ressources naturelles du sol argentin et le travail des ouvriers agricoles de la pampa furent donc les premières sources de financement pour les tenants de la pensée critique européenne (p. 37-43). « De même que les racines anarchistes, anarcho-syndicalistes et socialistes du football argentin ont été occultées par l’histoire officielle l’importance géopolitique de Weill pour les spécialistes de l’école de Francfort ». Comme le dit Walter Benjamin « le défilé triomphal des élites »[6] n’est concevable que grâce à l’amnésie collective.
[1] Luis Martinez Andrade, 2020, Futbol y Theoria critica. Ilusiones del balon y del sujeto abstracto, Santander, Editorial LaVoragine
[2] Voir Stuart Jeffries, 2017, Grand Hotel Abyss. The Lives of the Frankfurt School, Londres, Verso
[3] Erich Fromm, 2002, Le Cœur de l’homme – Sa propension au bien et au mal, Paris, Payot
[4] Carl Amery, 2002, Auschwitz : comienza el siglo XXI ? Hitler como precursor, Madrir, Turner
[5] Lilian Thuram, « Le beau jeu, c’est avant tout le collectif », Le Monde, 12 juin 2014. L’ancien international français est président de la Fondation éducation contre le racisme.
[6] Walter Benjamin, 2017, Sur le concept d’histoire, Paris, Payot