Traduit depuis l’anglais, avec l’aimable autorisation de Monthly Review. Vous pouvez retrouver la version originale ici.
À propos de : Ali Kadri, Arab Development Denied (Londres : Anthem, 2014).
Dans le monde arabe sans doute plus que partout ailleurs, la violence fait disparaître l’horizon. Les guerres impérialistes ont démoli l’État libyen et réduit la Syrie à l’état de charnier. Le Yémen, le pays le plus pauvre de la région, a servi de stand de tir aux drones étatsuniens avant que l’Arabie Saoudite, le satrape régional en chef des États-Unis, ne l’attaque, le faisant ainsi sombrer dans la famine. L’Irak frémit sous les voitures piégées de l’État islamique après des décennies de guerres et de sanctions. Quant à la Palestine, elle continue de saigner et de résister sous le poids du colonialisme israélien.
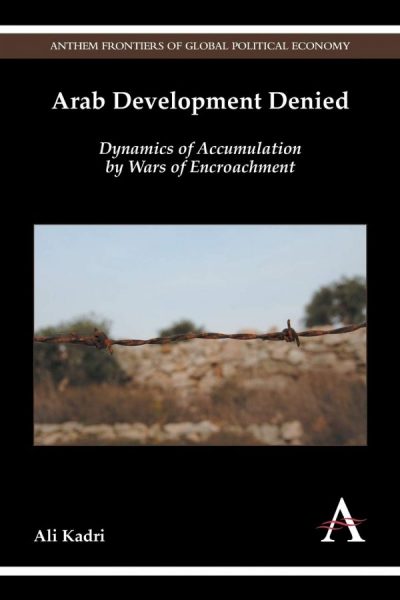
Dans ce climat de violence impériale – en réalité, une guerre contre le développement – peu ont tenu bon. La bande de Gaza souffre de ce que l’économiste Sara Roy nomme le « dé-développement » causé par Israël[1]. La Syrie a été retardée de plus d’un demi-siècle, avec une espérance de vie en chute spectaculaire et une génération perdue de jeunes hommes[2]. Pourquoi tant de violence ? Les mercenaires universitaires des études contre-insurrectionnelles se concentrent sur le terrorisme en tant que réponse aux griefs matériels, et sur la guerre occidentale comme solution à celui-ci[3]. D’autres imputent le sous-développement de la région à un mélange d’inadéquation institutionnelle et de déficits démocratiques, auquel la sollicitation du pouvoir étatsunien permettrait de remédier.
À l’encontre de cette image, le livre d’Ali Kadri Arab Development Denied offre un récit brillamment intelligent de la manière dont les États-Unis ont refusé le développement arabe. Par les guerres, le colonialisme et les sanctions, ils ont cherché, pendant des décennies, à empêcher la souveraineté de la classe ouvrière dans la région. Kadri adopte par moments un ton polémique, mais cela ne doit pas nous induire en erreur. La thèse principale du livre se fonde sur une connaissance encyclopédique des mécanismes de la politique macroéconomique, de l’interaction entre les échanges monétaires, les comptes de capitaux ouverts et fermés et le rôle des investissements publics et privés dans la mise en mouvement de ce que Gunnar Myrdal a nommé les « cercles vertueux » du développement. Tout cela s’intègre dans une lecture plus vaste de l’histoire de la région, à laquelle Kadri fait référence avec une aisance presque trop fluide.
Le plus important est sans doute l’utilisation que fait Kadri du concept de souveraineté et la substance avec laquelle il l’imprègne. Il entend la souveraineté comme « le droit des ouvriers à déterminer les conditions de leur existence », explicitant immédiatement la base de classe de cette souveraineté (p. 3). La guerre est le principal solvant de la souveraineté : avec chaque ingérence impériale, chaque État enveloppé sous l’ombrelle sécuritaire étatsunienne, la souveraineté devient progressivement une carapace desséchée. De plus, chaque appareil politique remettant en question le contrôle étatsunien, « chaque plateforme sociale à partir de laquelle la classe ouvrière pourrait », même potentiellement, « remettre en question la mainmise de l’impérialisme mené par les États-Unis » se trouve démantelé (p. 7). En témoignent la destruction de la Libye, les ruines de la Syrie et les attaques constantes contre l’Iran. Comme l’écrit Kadri, « les guerres déplacent les ouvriers et paysans et empêchent ne serait-ce qu’un contrôle politique potentiel des ressources naturelles par les classes ouvrières nationales » (p. 7). Il montre clairement le fait que la destruction de l’État et de ses institutions verrouille la possibilité même de développement. Les chapitres qui suivent approfondissent cette problématique initiale.
La prémisse est une dialectique dévastatrice et dévolutionnaire entre impérialisme et classes dirigeantes locales. Après les expériences populistes des années 1960 et 1970, soutient Kadri, la région a été témoin du « désengagement graduel par le capital industriel national du capital marchand », ce dernier devenant lentement « le mode dominant » (p. 16). Le capital, entrant et sortant rapidement des agrégats statistiques que l’on nomme économies nationales, décompose les liens productifs, conduisant la classe « capitaliste-marchande », liée à l’investissement à court terme, à fusionner pleinement avec « le capital financier international » au milieu de cet alliage ardant d’interactions (p. 16).
Le problème n’est donc pas tant que le développement arabe échappe aux décideurs politiques, sérieux, mais désarçonnés. En fait, « ils refaçonnent le développement comme un objectif élusif » (p. 16.). De plus, les actifs s’échappent des failles institutionnelles et structurelles enfichables et le capital s’écoule des comptes nationaux. Pendant ce temps, « le spectre de la guerre » « justifie [constamment] la montée de la classe au pouvoir et de l’appareil sécuritaire qui soutient les régimes arabes », menant à diverses formes d’endiguement social et de stabilisation au lieu d’investissements productifs à long terme (p. 30).
Cela n’est pas dû à l’absence de connaissances quant aux recours politiques nécessaires. Kadri nous rappelle que les « régimes populistes [nationalistes arabes] contrôlaient les comptes de capitaux et adaptaient les taux d’intérêt et d’échange afin d’équilibrer l’épargne et l’investissement tout en protégeant la consommation de base, qui faisait partie de la sécurité nationale » (p. 45). Les prix étaient fixés afin de maintenir l’accumulation au niveau local et de prévenir la fuite des connaissances. Le résultat fut que, jusqu’en 1977, le véritable revenu par tête équivalait à celui des économies d’Asie de l’Est, modèles du développement capitaliste.
Depuis lors, avec la souveraineté s’échappant de la région et les ressources sociales progressivement détournées pour revêtir les pays en guerre avec Israël ou les uns avec les autres, la politique pro-cyclique – le néolibéralisme – a mis la région sur la voie qu’elle suit actuellement. D’un côté, les revenus pétroliers ont partiellement masqué ce processus. De l’autre, le pétrole a été la cause principale des guerres incessantes qui ont miné la région, avec le « cycle commercial du [monde arabe] exemplifiant un cas de ‘’cycle déterminé par une logique impériale’’ ou un cycle principalement guidé par des pressions extérieures » (p. 47). Parmi les effets destructeurs et de démontage de la guerre – et il faudrait ajouter de la propagande sectaire impitoyable du Conseil de Coopération du Golfe – les classes ouvrières arabes ont commencé à se diviser en suivant les lignes des sectes. De plus, comme le soutient Kadri, ce ne sont pas les politiques elles-mêmes qui ont échoué. « Les transgressions de la période socialiste arabe », écrit-il, n’ont pas du tout été « les macro-politiques de gauche », mais étaient, en réalité, celles de la « classe en charge du développement », puisque les « classes dirigeantes arabes ont utilisé l’État comme médium de l’accumulation privée ». Par conséquent, « le partage de la richesse totale par la bourgeoisie d’État a augmenté » (p. 175). Finalement, cela a mené au vol, que l’on nomme privatisation.
La guerre a également apporté un autre mécanisme participant du retrait graduel du capital du développement de la capacité productive nationale. Le résultat en a été une dimension croissante d’inconnaissable : tandis que le capital privé pouvait suivre avec fiabilité les investissements de l’État pendant la période des économies planifiées, la guerre compromet désormais l’horizon planifié : « Il n’y a pas vraiment d’avenir dans lequel se projeter quand l’État risque de s’effondrer subitement », écrit Kadri, modifiant les calculs des investisseurs et rendant les investissements commerciaux, ou dans le domaine des services sur le court terme, plus attrayants (p. 65-66).
Kadri dresse ensuite un excellent exposé, s’inscrivant dans son examen de la période de planification, de la manière dont l’industrialisation par substitution aux importations (ISI) s’essouffle. La politique de l’ISI inclut de multiples taux d’intérêts et d’échanges afin d’assurer des économies et des investissements adéquats, et leur corollaire, le contrôle de la fuite de capitaux, avec une émission d’obligations afin d’étendre la réserve monétaire et l’investissement financier. Sous le néolibéralisme, ces comptes de capitaux ont été ouverts et la myriade de taux d’échange et d’intérêt n’ont plus fait qu’un. La monnaie était introduite internationalement. Les États pauvres en pétrole faisaient souvent face à des problèmes dans la balance des paiements à mesure que leurs comptes se vidaient, alors que les taux d’intérêt devaient monter afin de prévenir la fuite des capitaux. Circulairement, ce processus a engendré des délais dans les investissements et les États ne pouvaient pas émettre de la monnaie, car leurs recettes des opérations de change s’amenuisaient, ou étaient conservées en réserve afin de protéger le taux d’échange. Finalement, dans « les États à faible capacité pétrolière, l’espace monétaire s’est ouvert du fait de la diminution monétaire comblée par le dollar, et la dollarisation implicite ou explicite a progressivement supplanté les marchés monétaires » (p. 54).
Il semble toutefois y avoir une tension entre l’idée selon laquelle le cycle commercial interne a été subordonné au contrôle impérial et la dernière affirmation de Kadri selon laquelle les politiques internes ont produit leurs propres blocages et contradictions. Cela est sans doute davantage un effet de l’exposé de Kadri que de son analyse. Bien que son unité analytique soit implicitement le système-monde, le « monde arabe » étant imbriqué dans la géopolitique impériale, il ne représente par moments que vaguement son analyse. Il faut connaître la présence de ce cadre d’analyse pour être en mesure de le percevoir. Il note qu’en son cœur même, la guerre militaire extérieure était également une guerre de classe intérieure, la militarisation de l’industrie étatsunienne menant au « partage de la valeur en faveur du capital conduit par les États-Unis tandis que celui-ci impose des mesures d’austérité aux classes ouvrières du centre » (p. 91). Mais le sous-développement du monde arabe – c’est-à-dire le déficit de souveraineté des classes ouvrières arabes – est, pour Kadri, « un résultat des nécessités de l’impérialisme conduit par les États-Unis », « le pétrole et les guerres locales arabes » étant fondamentalement « nécessaires pour le capital [qui] tombe dans le domaine » du pouvoir étatsunien (p. 218). Ici, la pierre angulaire était « le facteur israélien seul […] [qui] engendre un état de défaite » et qui a participé de la réorientation du rapport de force, après quoi la contre-révolution a commencé à lentement triompher régionalement (p. 212).
On ne sait pas et on ne pourra savoir ce qui serait advenu en l’absence de la victoire militaire israélienne, de la contre-insurrection saoudienne au Yémen ou du blitzkrieg omano-britannique de la révolution à Dhofar. Mais les blocages auxquels fait référence Kadri dans les États pauvres en pétrole n’étaient pas que ceux de comptes s’approchant de zéro, mais de forces sociales perdant leur capacité à arracher le capital aux riches et à investir dans les capacités locales. Les déficits actuels des comptes sont liés aux limites de la capacité extractive de l’État, notamment des classes moyennes et supérieures. Il ne s’agit pas de processus naturels. Ils sont politiques, liés au rapport de forces sociales, un rapport qui n’est jamais simplement national, mais toujours régional et international.
C’est là que se trouve l’un des deux points qui me gênent dans le livre. Kadri devrait davantage historiciser et être plus didactique. Comme il le sait, bien qu’il ne le dise pas réellement, la politique de l’ISI et son dénouement étaient enchâssés dans un processus plus vaste de changement social, une révolution globale, incluant l’espace pour la lutte anti-systémique qu’a ouvert l’URSS.
Par conséquent, Kadri exhorte à la mise en œuvre des mêmes politiques macroéconomiques qui ont propulsé le monde arabe dans les années 1960 et 1970. Il doit y avoir, affirme-t-il, « des moyens d’endiguer la fuite des richesses, de faire circuler à nouveau la valeur nationalement, de revaloriser la force de travail et de redistribuer la valeur par des politiques sociales » (p. 69). Cela signifie, fondamentalement et avant tout, une réforme foncière et la renationalisation de biens « précédemment dérobés via le consortium de l’État marchand et répressif » (p. 69). Afin de revendiquer de jouer son rôle dans les cycles de production, il faudrait que le peuple puisse avoir les moyens de formuler des revendications. De plus, cela suppose « des prix multi-niveaux d’ingénierie » afin de remodeler les politiques de taux d’échange et d’intérêt pour enfermer « les ressources de la région », comprenant tant le peuple que le capital (p. 201). En plus de la réforme foncière, cela implique la mise en place de « garanties de production agricoles finançant l’industrie et l’agriculture à des taux concessionnels, ainsi que l’intégration de l’agriculture par un investissement accru dans l’économie » (p. 201).
Par-dessus tout, faire cela implique de trouver le bon plan de bataille. Kadri affirme que l’anti-impérialisme est central, notant, dans une formule qui irritera sûrement la myriade d’idiots utiles qui perçoivent les milices de droite équipées par l’impérialisme comme des « révolutionnaires », que « dans le développement des formations constamment soumises à des assauts impérialistes, la lutte des classes est principalement anti-impérialiste et circulairement conditionnée à la sécurité des classes ouvrières nationales » (p. 85). Elliptiquement, il poursuit et affirme que « la pleine sécurité étend la souveraineté » (p. 86). Dans les faits, ce point va vraisemblablement irriter doublement les apologistes de l’impérialisme, qui prétendent parler au nom des ouvriers même lorsqu’ils justifient la disparition des États dans lesquels les ouvriers vivent leur vie, le tout en émettant un flux continu de clichés néocoloniaux selon lesquels on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, les révolutions ne sont pas des dîners de gala et autre charabia.
Dans une mise en garde, Kadri commente alors la faiblesse générale de l’internationalisme mondial. L’idéologie corrosive d’Amid Wahhabi propage l’idée selon laquelle « le front anti-impérialiste est chiite. » Cela signifie que, « comme toute secte constituant une forme d’organisation sociale [elle est] capitaliste ». Toutefois, « le problème d’un front sectaire […] est que même s’il gagne la guerre militaire, il perd la guerre sociale, à moins que les luttes quotidiennes de la gauche marquent l’œuvre de l’histoire » (p. 180). Bien évidemment, un tel jugement omet le soutien militaire de l’Iran à des organisations sunnites au sein de la Palestine historique. Le terme « sectaire » implique donc une équivalence conceptuelle entre le sectarisme de l’impérialisme étatsuno-saoudien et celui des forces sociales qui pourraient déployer une identification commune comme l’un des liens cimentant leurs solidarités et leur anti-impérialisme. Néanmoins, le besoin d’insister sur l’importance de la classe sur le front de la résistance est important et est, bien sûr, mis en œuvre par les forces régionales populaires.
Le second point qui me gêne est la distinction qu’établit Kadri entre le capital marchand et le capital industriel. Dans la région comme à un niveau plus global, l’industrie lourde a toujours bénéficié des garanties d’État. En effet, perçue comme non profitable dans le monde arabe comme ailleurs, elle a souvent été l’enfant de l’État, traînant derrière elle des investissements privés ou en bénéficiant de manière parasite. C’est ainsi, car les élites de l’État ont souvent perçu l’industrialisation comme la manière d’offrir un bien-être social à la population tout en bâtissant un échafaudage pour l’investissement privé dans l’industrie. Le capital s’enracine dans les processus industriels lorsque c’est profitable et les conditions de la profitabilité sont simultanément politiques et sociales. Je crains que se trouve implicitement dans cette typologie une voie de développement idéale-typique, allant du marchand à l’industriel. Mais même les États européens n’ont saturé leur base productive nationale en industrie qu’en réaction à des guerres et révolutions mobilisant les masses, y compris en Union soviétique et ailleurs[4]. (Ce n’est pas le lieu pour s’attarder sur le fétiche de l’industrialisation lui-même). Le reflux de la peur de ce vieux spectre peut expliquer la volonté de diverses élites d’opter simultanément pour une évolution vers des formes globalisées d’accumulation du capital – la transition de ce que Kadri nomme le capital industriel au capital marchand dans le monde arabe.
De plus, il semble difficile, en tous les cas, d’identifier ce qu’est le capital marchand et le capital industriel à l’ère des conglomérats – si cela a un jour été possible. Les grandes sociétés ou groupes commerciaux sont aujourd’hui souvent à la fois marchands et industriels en même temps. Un processus plus insaisissable de déracinement est à l’œuvre et je ne suis pas certain que la division marchand-industriel nous aide à le théoriser. Mais c’est là un débat conceptuel de longue date et l’argument de Kadri ne repose guère sur la légitimité de cette typologie. En bref, Arab Development Denied est l’un des livres les plus importants publiés depuis longtemps sur l’économie politique arabe et il mérite d’être lu par toutes les personnes qui s’intéressent à cette région. Je ne peux qu’en recommander la lecture.
Notes
[1] Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development (Institute of Palestine Studies, 2001).
[2] Syrian Center for Policy Research, « Confronting Fragmentation, » février 2016, http://scpr-syria.org.
[3] Sayres S. Rudy, “Pros and Cons: Americanism against Islamism in the ’War on Terror,’” The Muslim World 97, n° 1 (2007): 33–78.
[4] Sandra Halperin, War and Social Change in Modern Europe: The Great Transformation Revisited (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004).

