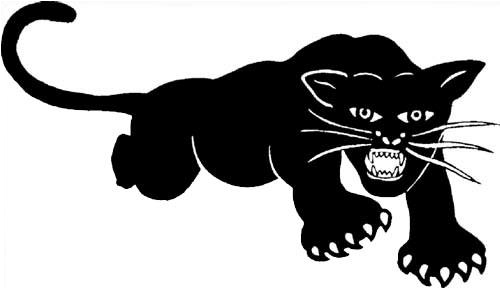Angela Davis: « Il nous faut une structure politique alternative qui ne capitule pas devant les entreprises »
Dans cette interview, Angela Davis aborde le poids du complexe pénitentiaire industriel au sein des sociétés capitalistes, ainsi que le rôle de l’ idéologie raciste et coloniale comme source des discriminations actuelles. Une interview réalisée par Maria Colera Intxausti pour Espai Fabrica.
Dans l’essai « Are prisons obsolete ? » {Les prisons sont-elles obsolètes?}, vous parlez de l’emprisonnement massif des gens pauvres et des migrants illégaux. Le capitalisme considère ces personnes comme autant de sujets qui ne sont pas indispensables mais les utilise comme main d’œuvre esclavagée et bon marché, et les transforme en consommateurs captifs de l’excédent de production. Ce même excédent qui se trouve à l’origine d’une crise économique engendrant aussi pauvreté et migration, formant une parfaite boucle. Percevez-vous un quelconque parallélisme entre ces politiques d’emprisonnement et le processus entamé pendant la transition du féodalisme au capitalisme, où des millions de personnes furent expulsées des terres qui assuraient leurs moyens de reproduction et furent forcées à l’esclavage salarié ?
Il y a, certes, des parallélismes/similitudes entre les deux époques mais le plus important est de constater qu’il y a aussi entre elles des différences considérables. Dans le saut du féodalisme au capitalisme, tel que Marx l’a décrit, les enclosures et d’autres processus de dépossession privèrent les gens des terres qui constituaient leur moyen de subsistance et façonnèrent simultanément une classe de personnes à qui il ne restait plus que la force de travail. Ces personnes sont alors devenues la main d’œuvre nécessaire pour que le capitalisme naissant multiplie sa richesse. Ces personnes furent en effet libérées des contraintes féodales mais elles se sont vues forcées, in fine, à passer d’une forme d’oppression à une autre.
S’il est vrai qu’il est souvent inutile de faire un classement des différentes formes d’oppression, l’on peut quand-même affirmer que, malgré la dépendance totale et absolue du capitalisme vis-à-vis de l’exploitation, le fait de dépasser l’esclavage et le féodalisme constitua un progrès certain. Au moins quelques travailleurs trouvèrent accès à l’emploi, quoiqu’il qu’il fût, et continue d’être, dégradant.
D’autre part, le complexe pénitentiaire industriel et global est certainement plus rentable. Néanmoins, sa rentabilité réside dans les technologies destinées à reléguer une grande masse de la population à des vies marginales, improductives et chargées de violence. L’emprisonnement massif aux Etats Unis, en Australie, ou encore en Europe de citoyens de couleur ou immigrants, s’appuyant sur la persistance d’un racisme et d’une xénophobie structurels, sont la preuve de l’échec absolu du capitalisme global à faire face aux nécessités des individus de par le monde.
L’on pourrait pareillement considérer que c’est aussi la preuve la plus convaincante du besoin de concevoir un système socio-économique au-delà du capitalisme. Dans cet espoir, le mouvement abolitionniste contemporain, à travers son appel à démanteler le complexe pénitentiaire industriel, se présente comme un mouvement anticapitaliste qui exige l’égalité raciale, des emplois dûment rémunérés, un logement abordable, des soins de santé et une éducation gratuits, et une justice environnementale concernant tous les êtres vivants.
Tu défends la justice restauratrice au lieu de la justice punitive. Comment faire disparaître les inégalités et l’injustice issues du processus d’accumulation primitive qui est à la base du capitalisme ? Autrement dit, quelle serait la forme d’une justice restauratrice destinée à réparer le « péché originel » d’exploitation et d’accumulation duquel découlent les inégalités de répartition dans nos sociétés ?
J’ai en effet souvent utilisé les termes « justice restauratrice», « justice réparatrice » et aussi « justice transformatrice » comme alternatives à la justice punitive ou vindicative. Dans l’absolu, je préfère la notion « justice transformatrice » car elle ne suppose pas l’existence d’un état idéal qu’il faille restaurer.
Pour répondre à ta question, j’aimerais souligner l’importance de la mémoire historique dans notre contexte actuel qui a besoin d’une analyse explicitement anticapitaliste. « L’accumulation primitive du capital » est l’un des passages les plus importants du Capital, justement parce qu’il met en lumière l’expropriation, l’injustice et la violence qui marquèrent les débuts du capitalisme, et demeurent, malgré les apparences, au centre du processus capitaliste.
Vers la fin du XXème siècle, le complexe pénitentiaire industriel commence à nous révéler combien pèsent encore, au sein des sociétés capitalistes, les idéologies racistes et coloniales quand il s’agit de développer des technologies de violence. De cette façon se poursuit la violence séculaire de l’esclavage et de la colonisation.
Tu as parlé des réflexes automatiques avec lesquels on répond au crime et au délit, cherchant le refuge auprès des institutions juridiques et policières au lieu d’imaginer des solutions provenant de l’intérieur de la communauté. Pour ce qui est des cas de violence sexuelle, tu soutiens l’autodéfense, ce qui nous amène au sujet des femmes face à la violence. Dans « Are prisons obsolete ? » tu mentionnes la « nécessité de remettre en question l’idée préconçue selon laquelle la seule relation possible entre les femmes et la violence suppose que les femmes en soient les victimes ». C’est quoi selon toi l’autodéfense féministe ?
J’ai toujours choisi soigneusement la façon dont j’employais le terme « violence ». En tant que chercheuse dans la théorie critique, je me rappelle toujours que les outils conceptuels que je décide d’emprunter peuvent, en réalité, contrevenir à ce que je tente d’exprimer. C’est pour cette raison que j’essaye de ne pas associer « autodéfense » et « violence contre l’agresseur ». D’ailleurs, la formation en autodéfense que je soutiens s’inscrit dans un contexte plus large : elle se base sur une analyse qui relie la violence misogyne aux systèmes de domination raciale, de genre et de classe, dans une stratégie qui prétend purger nos sociétés de toute forme d’exploitation et de violence.
Dans « Women, Race and Class » {Femmes, Race et Classe} tu déconstruis le mythe du violeur noir et tu expliques qu’il fut une « invention clairement politique ». Une propagande élaborée en vue de justifier et pérenniser les lynchages, une méthode de « contre-insurrection » ayant pour but d’éviter que les Noirs prennent possession de leurs droits. Nous avons encore assisté au déroulement de ce même mythe à Cologne en fin d’année : on a ciblé les hommes « d’apparence arabe ou nord-africaine » et, dans un nouvel exemple de « purple washing », on a utilisé le soutien aux femmes pour criminaliser les demandeurs d’asile et les résidents illégaux. Comment interprètes-tu l’utilisation faite des droits des femmes (voile, violeur noir, oppression des femmes afghanes…) pour s’engager dans d’autres croisades ?
Dans le livre « Arrested Justice : black women, Violence, and America’s Prison Nation » {La justice sous arrestation : femmes noires, violence et la prison-nation d’Amérique}, Beth Richie dévoile le danger de faire confiance aux technologies de la violence comme étant des solutions aux problèmes de la violence de genre.
Son argument est que le mouvement anti-violence prédominant aux Etats Unis opéra un virage, dangereusement orienté, lorsqu’il commença à soutenir la répression policière et l’emprisonnement comme stratégies principales pour la protection des « femmes » vis-à-vis de la violence masculine. Il était facilement prévisible que ces efforts de protection cibleraient tout particulièrement les hommes des communautés déjà soumises à l’hyper-vigilance policière, les mêmes qui contribuent de façon disproportionnée à l’augmentation de la population pénitentiaire.
En fait, la généralisation du concept « femme » cachait toute un racialisation clandestine à l’intérieur de la catégorie. De cette façon, les « femmes » devenaient en réalité les « femmes blanches » voire les « femmes blanches et aisées ».
Ce qui est arrivé à Cologne et le discours sur le violeur arabe (qui prétend consolider les représentations colonialistes des hommes arabes en tant que potentiels agresseurs sexuels) nous rappelle l’importance des théories et des pratiques féministes qui questionnent l’instrumentalisation raciste des « droits des femmes » et mettent l’accent sur l’inter-sectionnalité des combats pour la justice sociale.
Ces dernières décennies, nous avons été témoins de ce que Nancy Fraser définit comme le « découplage des dénommées « politiques identitaires » des politiques de classe », qui s’est transformé en une lutte pour la reconnaissance au lieu d’une pour la redistribution, avec le déplacement du sujet collectif vers un sujet individuel. D’un autre côté, tu as défendu les « communautés de la lutte » quand tu considères que « les communautés sont toujours des projets politiques ». Quel est ton avis sur les politiques identitaires ? Quels sont les combats et projets politiques qui devraient être au centre de l’hégémonie néolibérale actuelle ?
Ce qui me semble le plus problématique dans les politiques identitaires, c’est la manière dont on naturalise souvent les identités pour ne plus les considérer comme un produit du combat politique. De cette façon, on les coupe des luttes de classe et de la lutte antiraciste.
Le mouvement « trans », par exemple, est récemment devenu une dimension importante du combat pour la justice. Après tout, il y a une différence fondamentale entre les représentations dominantes des questions « trans », axées sur l’identité individuelle, et les mouvements « trans » inter-sectionnels qui considèrent la race et la classe comme éléments fondamentaux des luttes menées par les personnes « trans ».
Au lieu de se focaliser sur le droit de la personne à « être » elle-même, ou lui-même, ces mouvements « trans » font face à la violence structurelle (de la police, des prisons, du système sanitaire, du système de logement, du chômage, etc.) que les femmes « trans » noires ont le plus de probabilité de subir, plus que n’importe quel autre groupe social. Autrement dit, ces mouvements luttent pour des transformations radicales dans nos sociétés, en opposition à l’assimilation simple d’un fait établi.
Poursuivons au sujet de l’identité : au vu de ce que tu dis sur l’inter-sectionnalité, je comprends que tu es davantage en faveur d’une confluence des luttes (Ferguson, Palestine), que d’une conjonction d’identités différentes, diverses et multiples. Ceci, dans un contexte où une grande partie des défenseurs des politiques inter-sectionnelles affirment et naturalisent les identités, au lieu de les questionner, tout en ignorant souvent le contexte matériel et historique qui les entoure. Comment comprends-tu l’inter-sectionnalité et en quels termes devient-elle, selon toi, productive aujourd’hui ?
Le concept d’inter-sectionnalité, tel que je l’entends, a une généalogie particulièrement intéressante qui remonte au moins à la fin des années 60, début des années 70. Comme je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails, je ferai seulement mention de ce fait saillant : la création de l’organisation Alliance de femmes noires, en réponse à la volonté d’engager un débat sur les questions de genre au sein du Comité de Coordination Étudiante Non Violente (SNCC), principale organisation de la jeunesse du Mouvement pour la Liberté du Sud.
L’Alliance soutenait qu’il était impossible de comprendre le racisme dans toute sa complexité sans y ajouter une analyse sur le sexisme. C’est pour défendre cette thèse qu’en 1970 Fran Beale écrivit l’article amplement diffusé « Double Jeopardy : To Be Black and Female » {Risque double : être noir et femme}.
Peu après la publication de l’article, alors que l’on prenait conscience des luttes des femmes portoricaines contre la stérilisation forcée, l’Alliance de Femmes Noires se transforma en Alliance des Femmes du Tiers-Monde, et publia un journal nommé Triple Jeopardy, en référence au racisme, au sexisme et à l’impérialisme. Cet article rendait nécessaire une militance de terrain pour, simultanément, lutter contre le racisme, la misogynie et la guerre impérialiste.
C’est avec l’esprit de ces anciens efforts intellectuels organiques qui tentaient de comprendre les catégories de race, de genre et de classe en tant qu’éléments connectés, entrelacés, noués, que je conçois aujourd’hui les concepts féministes d’inter-sectionnalité.
Dans un cycle de conférences données récemment au CCCB sous le titre « La frontière comme centre. Zones d’être et de ne pas être {migration et colonialisme} », la représentante du Parti des Indigènes de la République Houria Bouteldja affirmait ce qui suit : « Je ne sais pas qui est blanc, mais la police française, elle, le sait très bien. Elle ne se trompe jamais quand il s’agit de décider sur qui faire tomber la discrimination et la violence ». Pareillement, Itziar Ziga, féministe basque, dans une interview chez Argia, disait d’elle-même « je suis une femme car c’est en l’étant que j’ai subi la violence physique, affective, économique, symbolique… J’affirme être une femme, mais pas à cause de ce que j’ai entre les jambes ». Dans les deux cas, le sujet se définit politiquement par l’oppression et, donc, le combat. Dans ce sens, c’est quoi selon toi être femme et c’est quoi être noire ?
Ces deux catégories se sont élargies et répandues au-delà de ce que j’aurais pu imaginer auparavant dans ma vie. De façon que si je prétendais m’accrocher aux définitions historiques, je continuerais de me sentir obligée de me baser sur des définitions politiques de genre et de race quoi qu’il arrive, tant du point de vue des structures de domination et de ses idéologies associées, que du point de vue des mouvement collectifs qui cherchent à démanteler lesdites structures et combattre ces idéologies.
Par ailleurs, j’ai toujours insisté sur la priorité de la pratique radicale au-delà de l’identité pure et simple. Ce que l’on fait pour faciliter la transformation radicale est plus important que l’imaginaire que l’on a de soi-même et de ce que l’on est. Et, évidemment, comme je l’ai déjà indiqué, les catégories de race et de genre, de même que la sexualité et la classe, ne sont significatives que dans des inter-relations plus complexes.
En relation à la politique étatsunienne, tu as mis en avant le « défi de compliquer le discours », étant donné que la « simplification de la rhétorique politique facilite l’adoption de positionnements extrémistes ». Ces dernières années, en Europe, nous avons été témoins de l’apparition de la prétendue « nouvelle politique », qui s’oppose à « ceux d’en haut » et dont l’objectif premier est celui d’enclencher une révolution démocratique par la voie de la « révolution des sourires ». Dans cette ère de populisme dépolitisant et de signifiants creux, que signifie pour toi la démocratie ?
Il est vrai que nous qui sommes à gauche aux États Unis (mais c’est le cas aussi de certains cercles conservateurs), nous vivons avec stupéfaction la montée en puissance de Donald Trump et l’expansion de son influence. Celle-ci profite du fait que des secteurs clé des communautés de classe ouvrière blanche sont attirés par cette rhétorique politique simpliste, extrémiste et d’inclinaison fasciste.
De façon analogue, une dangereuse attraction envers des personnages et partis d’extrême droite fait son chemin en Autriche, en France, en Pologne, et encore d’autres territoires européens, où la combinaison d’une récession économique et d’une crise des réfugiés a propulsé le populisme d’extrême droite sur un fond de racisme anti-noir et anti-immigrants. Cette même combinaison a servi à réactiver l’islamophobie, offrant de nouveaux spectacles au racisme séculaire.
Il ne sera possible de faire face au populisme d’extrême droite, ainsi que de générer un dialogue sur des horizons démocratiques – approches substantives et transformatrices qui déplacent le focus politique de la représentation néolibérale de l’individu vers les nécessités et aspirations des communautés – que si nous sommes capables de structurer des mouvements puissants contre le racisme et la xénophobie partout dans le monde.
Interrogée à propos de ton positionnement vis-à-vis des élections présidentielles aux Etats Unis, tu as récemment évoqué « qu’il nous faut un nouveau parti ». Pour quelle raison ? À quel type de parti penses-tu ? En tant qu’ancienne candidate à la vice-présidence du Parti Communiste des Etats-Unis, en quoi ce nouveau parti devrait-il y ressembler et en quoi s’en différencier ? Quant au programme, considères-tu que les 10 points du Parti des Black Panthers continuent d’être d’actualité ? Quelle serait la base électorale de ce nouveau parti ?
La politique électorale étatsunienne est depuis de nombreuses années l’otage du système bipartite. Que ce soit le Parti Démocrate ou le Parti Républicain, ils sont tous les deux totalement enchaînés au capitalisme. Il nous faut une structure politique alternative qui ne capitule pas devant les entreprises mais qui, au contraire, représente en premier lieu les nécessités des travailleurs, des pauvres, et des différentes races.
Ceci est évident depuis de plusieurs cycles électoraux et, quand j’ai pris part directement dans la politique électorale en tant que candidate à la vice-présidence du Parti Communiste il y a de cela de nombreuses années, je l’ai fait pour rendre visible ce besoin de déclarer l’indépendance vis-à-vis du système bipartite.
Au regard du retour obtenu par Bernie Sanders, il est devenu clair qu’un nombre considérable de gens désirent une alternative au capitalisme. De plus en plus de monde réfléchit sérieusement à la nécessité d’un parti qui représente la classe ouvrière, les mouvements antiracistes, les questions féministes et LGBTQ, les revendications contre la guerre et la justice environnementale.
Quant au Parti des Black Panthers, il est clair que son programme en 10 points est profondément enraciné dans les conditions historiques de la première moitié du XXème siècle et, néanmoins, chacun des points demeure encore tout aussi lié aux luttes radicales contemporaines.
Les Black Panthers furent des pionniers avec leur politique de « womanism » qui plaçait au même niveau la lutte des classes et la lutte raciale. Elle soutenait le droit à l’avortement, organisait la garde des enfants lors des réunions et soutenait le modèle traditionnel africain de la famille élargie en opposition à la famille bourgeoise et nucléaire. De même, le journal du parti était dirigé par des femmes et 70 % des militants étaient des femmes. Mis à part le fait que les hommes étaient en train d’être emprisonnés, voire assassinés, comment a-t-on pu atteindre ces résultats? Quelles leçons pourraient en retirer les mouvements de libération, et spécialement les féministes, de l’expérience du Parti des Black Panthers?
En réalité, nous ne devrions pas être excessivement surpris d’apprendre que la majorité des militants des Black Panthers étaient des femmes, de la même façon qu’il n’est pas surprenant que les femmes aient joué un rôle fondamental au sein du Mouvement pour la Liberté du Sud des Etats-Unis. Ce qui est véritablement surprenant c’est qu’un demi-siècle après nous continuions d’être captifs des visions historiquement obsolètes d’un leadership charismatique masculin.
Historiquement, les paradigmes associés au leadership féminin – d’Ella Baker à Erika Huggins – tendent à mettre l’accent sur le leadership collectif au-delà de l’individuel. La jeunesse des mouvements radicaux actuels est en train de prioriser le leadership des femmes, le leadership queer et celui des collectivités.
Parce-que tu as été élève de Marcuse, j’aimerais te poser une question que lui-même posait dans son livre « An Essay on Liberation » [Un essai sur la libération] : « comment [l’individu] peut-il satisfaire ses nécessités sans toutefois […] reproduire, à travers ses aspirations et ses satisfactions, la dépendance à un système exploiteur qui, lorsqu’il satisfait ses besoins, perpétue son esclavage ? ». En d’autres termes, comment pouvons-nous nous libérer de la marchandisation de nos sentiments ?
Aujourd’hui, je ne suis plus sûre qu’il soit possible d’esquiver totalement les conséquences du désir marchand car il est devenu la nature même du désir contemporain ; le capitalisme a tellement envahi nos vies intérieures qu’il nous est extrêmement difficile de nous en séparer. Je crois néanmoins que je suis la tradition philosophique de Marcuse quand j’affirme que nous devrions essayer de développer une conscience critique envers notre propre implication, par le biais de la marchandisation de nos sentiments, dans l’entretien du système capitaliste. C’est à travers ce type de réflexions négatives que nous pouvons commencer à entrevoir des possibilités de libération.
Pendant ta visite au Pays Basque, nous avons discuté de l’importance de l’art et de la littérature en tant que sphères permettant d’étendre les limites de l’intelligible, de démonter les paradigmes du sens commun hégémonique, d’affronter la camisole de force de la vraisemblance, de mettre à terre le monopole de la réalité, et de traduire, donner, former, et mettre en pratique nos notions politiques. Comment concrétise-t-on tout ça ?
Maintenant (et spécialement maintenant) que la possibilité de libération semble être mise à l’écart par ces mêmes luttes politiques qui prétendent nous montrer la voie vers des futurs meilleurs, nous pouvons profiter de ce que Marcuse nommait la « dimension esthétique » et Robin Kelley les « rêves de liberté » ou « imagination radicale ».
Ce que la toute-puissance capitaliste a complètement étouffé, c’est notre capacité collective d’imaginer une vie qui ne soit pas chargée de marchandises. C’est pour cette raison que nous avons besoin de l’art, de la littérature, de la musique et d’autres pratiques culturelles dans le but d’éduquer notre imagination de façon à ce qu’elle s’affranchisse des contraintes de la privatisation.
Lors de cette visite à Bilbao, un concert fut organisé en ton hommage pendant lequel tu fis mention d’une très belle chanson de Nina Simone « I Wish I Knew How It Would Be To Be Free » [j’aimerais savoir ce que c’est que de se sentir libre], et qui dit : « I wish I could break all the chains holdin’ me, I wish I could say all the things that I should say, say ’em loud, say ’em clear for the whole ’round world to hear » [j’aimerais pouvoir rompre toutes les chaînes qui me retiennent, j’aimerais pouvoir dire tout ce que j’ai à dire, les dire haut et fort pour que tout le monde l’entende]. Que signifie être libre pour toi et quelles sont les chaînes que l’on doit briser ?
J’ai évoqué cette chanson de Nina Simone, non pas pour laisser entendre qu’un demi-siècle après j’ai finalement une réponse définitive à la question sous-jacente à l’aspiration de savoir ce que c’est que d’être libre enfin, mais plutôt pour que nous continuions de nous déterminer par ce désir de nommer et de faire l’expérience de la liberté.
Aux Etats Unis, cet objectif est de nos jours beaucoup plus difficile à atteindre qu’à la moitié du XXème siècle. De fait, il semble que, plus on approche de ce que l’on avait initialement imaginé comme « liberté », plus nous nous rendons compte qu’il s’agit de quelque chose de bien plus compliqué, de bien plus vaste…
Angela Davis est professeur afro-américaine marxiste du Département d’Études Féministes de l’Université de Californie et leader historique du Parti Communiste des EUA et des Black Panthers.
Traduit du catalan par Joan Roisse pour Investig’Action
Source : Espai Fàbrica/l’esquerra avui
Angela Davis nous parle de son combat (Octobre 1975)
« L’histoire du peuple noir aux Etats-Unis est une histoire de la combativité, il faut résister », déclare Angela Davis dans cette interview. Historienne, philosophe, professeur d’université et compagne de route des Black Panthers, Angela Davis est une grande figure militante des droits civiques et du féminisme.
Angela Davis nous parle de son combat (Octobre… par Nzwamba