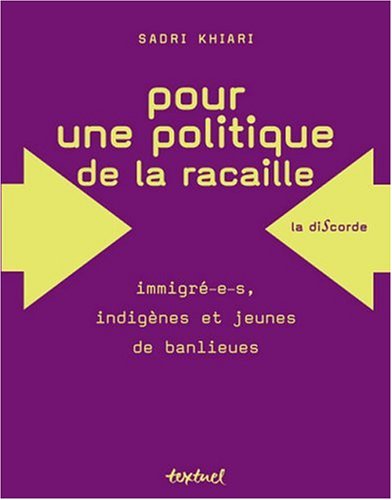Pour une politique de la racaille – Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues
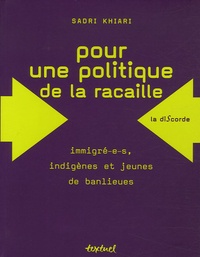
DESCRIPTION
Pour une politique de la racaille – Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues PDF. Découvrez de nouveaux livres avec histoiresdenlire.be. Télécharger un livre Pour une politique de la racaille – Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues en format PDF est plus facile que jamais.
Sadri Khiari propose ici une réflexion sans tabous sur le legs colonial, l’insertion des populations issues de l’immigration, la place de l’Islam dans la République… Et ce dans l’esprit des thèses développées par l’Appel des indigènes de la République. Ces questions sont au cœur de l’élaboration d’une nouvelle identité de gauche en France. S’inspirant d’Albert Memmi, de Frantz Fanon ou encore de Malcolm X, l’auteur revient de manière critique sur l’histoire des luttes de l’immigration et des mouvements antiracistes. Il ébauche alors les contours d’une » politique de la racaille » fondée sur la contestation des logiques postcoloniales toujours à l’œuvre, insérée dans une dynamique plus large d’émancipation.
7 mars 2006
Le texte qui suit reprend l’essentiel de l’introduction du dernier livre de Sadri Khiari : Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue.
L’Appel dit :
« Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s’y réduire, la politique coloniale. (…) La figure de l’« indigène » continue à hanter l’action politique, administrative et judiciaire ; elle innerve et s’imbrique à d’autres logiques d’oppression, de discrimination et d’exploitation sociale. (…) La République de l’Egalité est un mythe. »
L’Appel… ? Je veux parler de L’Appel des indigènes de la république, rendu public en janvier 2005 à l’initiative de plusieurs associations et de militants engagés dans les luttes de l’immigration et des quartiers [1]. A sa manière, Dominique de Villepin n’a rien dit d’autre en décrétant l’état d’urgence pour briser la révolte des cités populaires. Cette loi d’exception est, en effet, directement puisée dans l’arsenal législatif colonial. Adoptée en 1955 en pleine guerre d’Algérie, elle est à l’origine du couvre-feu instauré à Paris en 1961 qui a débouché sur le massacre de centaines de manifestants algériens. En 1984, Laurent Fabius, alors Premier ministre, l’impose à son tour en Nouvelle-Calédonie pour mater la rébellion kanak. Le 23 février 2005, quelques mois avant le grand fracas des quartiers populaires, le parlement votait massivement – droite et gauche [2] – une loi réaffirmant « le rôle positif de la présence française outre-mer notamment en Afrique du nord ». Il ne s’agit guère de coïncidences. L’instauration de l’état d’urgence couronne une politique profondément enracinée dans l’histoire coloniale.
Je plante rapidement le décor. La scène se déroule dans un quartier « sensible », à forte concentration de populations issues de l’immigration : Clichy-sous-bois. Personnages principaux et « de couleur » : trois adolescents – Muttin, Zyed et Bouna. L’un d’entre eux est sans-papiers. Personnage principal sans couleur : un ministre de l’Intérieur – Nicolas -, candidat à la présidentielle de 2007. Figurants : une brigade de police. Accessoires : matraques et autres objets contondants. Probablement, des menottes. L’action : poursuivis par des policiers, alors qu’ils retournent tranquillement chez eux après un match de football, les trois adolescents se réfugient dans un transformateur EDF. L’un d’entre eux – Muttin – est grièvement brûlé ; les deux autres – Zyed et Bouna – meurent électrocutés. Le ministre de l’Intérieur les présente d’abord comme des délinquants, après avoir parlé de « racailles ». Quelques mois plus tôt, il avait également lancé cette autre provocation : « Il faut nettoyer les quartiers au Kärcher » (…)
Face à l’émeute qui embrase les cités pendant plus de trois semaines, la machine répressive se déploie. Gendarmes et CRS investissent l’espace des quartiers. Plus de quatre mille interpellations, des centaines de jeunes condamnés à des peines de prison ferme et l’expulsion annoncée des étrangers (la « double peine »). Le lexique politique retrouve des accents guerriers. On parle de « reconquête » du territoire, de « pacification » des banlieues. Quelques manifestants menés par un maire UMP entonnent la Marseillaise. Une manière de dire « la patrie est en danger » face aux jeunes issues de l’immigration. La gauche socialiste n’est pas en reste. Assimilant, la révolte à « une guérilla urbaine d’un genre nouveau », Julien Dray et Delphine Batho craignent une « reddition de la République ». [3]
La « racaille » est musulmane, présuppose-t-on. Pour ramener la « paix civile », les imams sont invités à la table de la République laïque. La loi de Dieu est convoquée au secours du code pénal. Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris, arrive à la rescousse ; l’UOIF [4] accourre une fatwa à la main :
« Il est interdit à tout musulman recherchant la grâce divine de participer à quelque action qui frappe de façon aveugle des biens privés ou publics ou qui peuvent attenter à la vie d’autrui. Contribuer à ces exactions est un acte illicite. » [5]
S’il n’est ni arabe ni musulman, le « casseur » est supposé noir ; et, s’il est noir, c’est que son père est polygame ! La polygamie est directement responsable des « violences urbaines » assurent ministres et députés de droite ; elle ne permet pas d’éduquer les enfants selon les normes de la société « organisée » – comprendre « civilisée » – ; il faut abandonner le laxisme du regroupement familial.
C’est précisément la politique que dénonçait l’Appel des indigènes de la république :
« Discriminés à l’embauche, au logement, à la santé, à l’école et aux loisirs, les personnes issues des colonies, anciennes ou actuelles, et de l’immigration post-coloniale sont les premières victimes de l’exclusion sociale et de la précarisation. Indépendamment de leurs origines effectives, les populations des “quartiers” sont “indigénisée”, reléguées aux marges de la société. Les “banlieues” sont dites “zones de non-droit” que la République est appelée à “reconquérir”. Contrôles au faciès, provocations diverses, persécutions de toutes sortes se multiplient tandis que les brutalités policières, parfois extrêmes, ne sont que rarement sanctionnées par une justice qui fonctionne à deux vitesses. Pour exonérer la République, on accuse nos parents de démission alors que nous savons les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. Les mécanismes coloniaux de la gestion de l’islam sont remis à l’ordre du jour avec la constitution du Conseil français du Culte Musulman sous l’égide du ministère de l’Intérieur. »
Les mêmes raisons qui ont provoqué la révolte des quartiers populaires expliquent l’impact de l’Appel des indigènes auprès de nombreux jeunes issus de l’immigration. En quelques semaines, trois mille signatures, individuelles ou associatives, ont été recueillies, parmi lesquelles quelques élus courageux et des militants « minoritaires » du Parti communiste, de la LCR ou de la CNT (seuls, en tant que parti, les Verts ont soutenu l’Appel). Des collectifs se sont formés en Ile de France et dans différentes villes (Lyon, Marseille, Tours, Lille, Toulouse, Nantes…). Des enseignants ont constitué un « Collectif des profs indigènes ». Le 8 mai 2005, malgré l’hostilité de la plupart des appareils politiques, des syndicats et des médias, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris de la Place de la République à l’Eglise Saint Bernard. Deux espaces symboliques : la République de l’inégalité, pour point de départ, et le centre d’un combat majeur pour l’égalité, la lutte des sans-papiers, pour débouché. Issus dans leur grande majorité de l’immigration, originaires d’Afrique noire, du Maghreb, des Antilles et d’ailleurs, jeunes et chibanis, femmes et hommes, associations aussi diverses que l’ATMF, le CMF, la FTCR, la Coordination nationale des sans papiers, les comités de solidarité avec la Palestine ou le Togo, les résidents des foyers Sonacotra et tant d’autres, se sont rassemblés pour protester contre la politique coloniale, post-coloniale et néo-coloniale de la France et, plus largement, contre toutes les formes de domination d’un peuple par un autre (…).
De même que l’état d’urgence policier a été opposé à la révolte des cités, un état d’urgence intellectuel, médiatique et politique a été opposé à l’Appel des indigènes. Avec les mots de la politique, les indigènes sont sortis de leurs réserves. Au double sens du terme. Ils n’ont brûlé aucune voiture ; ils ont incendié l’antiracisme consensuel et paternaliste. Ils ont parlé pour eux-mêmes. Acte impardonnable. Aventurisme irresponsable. Immaturité. Transgression irraisonnée. Mettre la République au banc des accusés suscite stupeur et colère. La gauche nationale-républicaine, la gauche sociale libérale, la gauche de la gauche, trépignent : « Les indigènes divisent ! » hurlent-ils à l’unisson, quand les indigènes se contentent de ramener au jour des clivages refoulés. Les indigènes ne divisent pas ; ils sont la division. Ils sont divisés entre une histoire qui n’est déjà plus la leur et une histoire qui ne veut pas d’eux. Leur existence même divise la France. On dénonce le « nouveau racisme » des Indigènes de la république, leur « antisémitisme », leur « islamo-gauchisme », leur « communautarisme », leur « violence ». Les moins frileux, à gauche, sont affligés par les « excès », les « maladresses », les « amalgames », la « confusion » des notions employées, le caractère « victimaire » de l’Appel. On s’inquiète de son manque de clarté sur la question sociale, le racisme anti-Juif, le sexisme, l’universalisme. Pourquoi ne pas nous avoir « consulté » ? Pourquoi ne pas nous avoir associés ? Pourquoi, en vérité, ne pas nous avoir laisser parler à votre place !? Vous exagérez !« On dit toujours de quelqu’un qu’il exagère quand il décrit une injustice à des gens qui ne veulent pas en entendre parler », écrit Albert Memmi dans sa préface au livre – splendide – de James Baldwin, La Prochaine fois le feu [6]. La prochaine fois le feu…
L’affaire du voile avait déjà révélé les lignes de fracture ; l’Appel récidive. Il met le doigt là où ça fait mal et farfouille dans la plaie en jubilant : la République est coloniale. Il ne se contente pas de regretter les discriminations et le racisme ; il dit : le racisme est dans la République. Il ne lance pas un SOS à la gauche ; il lui révèle ses propres cul-de-sac. Mais, la gauche a mieux à faire : mobiliser en faveur ou contre la constitution européenne, tisser et retisser des passerelles dans la perspective des élections de 2007. Les indigènes, eux, n’ont guère le choix. Ils ne peuvent entrer en politique que par effraction. S’ils parlent, c’est pour dire l’indicible. Ils n’hésitent pas à bousculer les calculs politiciens des uns et des autres ; ils refusent de subordonner leurs propres revendications aux enjeux des « recompositions » électoralistes. Cette conjoncture n’est pas notre conjoncture. Votre « agenda » n’est pas notre « agenda ». Nous aussi avons mieux à faire : inventer une politique de la racaille !
C’est l’objectif du Mouvement des indigènes de la république. Il voudrait, avec d’autres, contribuer à l’émergence d’une expression politique et organisée de la colère des populations issues de l’immigration. Le pari ne sera peut être pas tenu tant les écueils sont nombreux et puissantes les forces de résistance de la société postcoloniale. Une année à peine après la publication de l’Appel, il est bien trop tôt pour faire le moindre pronostic. Le Mouvement des indigènes résistera-t-il à l’épreuve de sa « structuration » ? Saura-t-il faire de sa diversité – et de ses contradictions – une richesse ou se perdra-t-il dans la « gestion » infinie de ses propres conflits ? Parviendra-t-il à préserver sa radicalité initiale ou succombera-t-il aux forces de normalisation du champ politique ? Je ne saurais le dire. Mouvement improbable et indispensable à la fois, il faut pourtant le faire. Cette idée, je vais m’attacher, ici, à la défendre.
Si je parle de l’intérieur du Mouvement des Indigènes de la république [7], je ne prétends nullement me faire le porte-parole de l’ensemble de ses membres. Il s’agit pour moi de contribuer à la controverse indigène tout en réagissant aux critiques qu’a suscité l’Appel, sans chercher cependant à masquer les lacunes et les tensions qui traversent ma propre réflexion. On remarquera aussi que je n’emploie pas le « nous » impersonnel ou de « majesté », ni le « ils » ou « elles » du sociologue (que je ne suis pas – comme Aimé Césaire, « j’ai une spécialité : je suis Nègre » [8]). J’utilise alternativement « je », « nous », « ils », « elles », « vous », « eux », parce que j’écris de l’intérieur et de l’extérieur ; j’écris de l’intérieur même des paradoxes de la politique antiraciste ; j’écris, selon l’expression à la mode, sur la frontière.
Mais, à propos de frontières, je me dois d’ajouter ceci : je suis en France depuis peu. Issu d’un Etat désormais indépendant mais toujours puissamment déterminé par son ancienne métropole en termes économiques, politiques et culturels, j’ai franchi, il y a à peine trois ans, la frontière tuniso-française. Comme on pourra le constater, soit dit en passant, j’ai emporté dans mes bagages mes archaïsmes politiques et mon lexique éculé. Je viens d’un pays où la citoyenneté n’existe pas. A l’instar de l’ensemble de mes compatriotes – cette « poussière d’individus » disait Bourguiba, formé à l’école de la République ! – j’ai toujours été privé de ces droits élémentaires qui en sont constitutifs : la liberté d’expression, la garantie de l’intégrité physique, le droit d’association et d’organisation, le droit de vote. Vulnérables et sans droits sont les Tunisiens, sinon celui de risquer l’enfermement ou de demander, la honte aux tripes, la protection des « Démocraties » contre le dictateur qu’elles… protègent. Si le sort me destinait à demeurer durablement au « pays des droits de l’homme », l’idée d’être privé, encore et toujours, de ces mêmes droits ou d’une partie d’entre eux me fait horreur. Sur cette rive de la Méditerranée, comme sur l’autre, je suis un indigène ; sur cette rive comme sur l’autre, je n’ai pas d’autre choix que de participer au combat contre l’indigénat. D’où, ce livre…
fragments sur le champ politique blanc
Introduction : Le PS, un « parti blanc » ?
par
8 mars 2006
Le texte qui suit est le premier d’une série de quatre extraits du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille.Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue [1], que nous recommandons vivement. Il est extrait, comme les trois textes suivants, du chapitre III, intitulé : « Le champ politique blanc ».
Un militant du MRAP a eu la malencontreuse idée d’employer la formule « PS blanc », déchaînant une gigantesque campagne de dénonciation au sein de l’association antiraciste. Il n’y a pourtant nulle trace de racisme dans cette formule. Elle se contente de prendre acte de la nature postcoloniale du système politique et de ses différentes composantes. Le PS est blanc, comme est blanc l’ensemble du champ politique dont est exclue cette frange de la population qui a pour stigmate de n’être pas blanche ou de n’être pas considérée comme telle du fait de son origine coloniale.
(…)
On pourrait, avec les mêmes précautions, parler de partis masculins. Dans un numéro récent de Politis, Joan Scott cite une formule tout à fait pertinente de l’historienne Michelle Perrot :
« L’universel est un cache-sexe qui ne recouvre le plus souvent que du masculin et qui a servi à exclure les femmes du gouvernement de la cité » [2].
Dire cela ne choque plus grand monde aujourd’hui – du moins, à gauche. Il est désormais largement admis que les institutions constitutives du champ politiques sont dominées par des hommes – ce qui est difficilement contestable – et qu’elles reproduisent des logiques de domination masculine. De manière similaire, comme on parle de partis bourgeois et qu’on pourrait parler de partis masculins, il est parfaitement légitime de définir comme blancs des mouvements qui contribuent à la reproduction des hiérarchisations ethniques de la société postcoloniale.
(…)
Aux Etats-Unis, non plus, la nationalité américaine ne fait guère de sens pour de nombreux Noirs. Malgré la conquête des droits civiques, ils savent bien qu’ils n’ont qu’une place subordonnée dans le système politique. Malcolm X l’exprime parfaitement bien :
« Je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicain et je ne me tiens pas même pour un Américain. (…) Ces Hongrois qui viennent de débarquer, ils sont déjà des Américains ; les Polonais sont déjà des Américains ; les émigrants italiens sont déjà des Américains. Tout ce qui est venu d’Europe, tout ce qui a les yeux bleus, est déjà américain. Et depuis le temps que nous sommes dans ce pays, vous et moi, nous ne sommes pas encore des Américains. »
Ou encore :
« L’ “homme” (blanc) lui dit et lui répète : “vous êtes américain”. Mais mon vieux, comment pouvez-vous vous prendre pour un Américain, alors que jamais vous n’avez été traité en Américain dans ce pays ? (…) Supposons que dix hommes soient à table, en train de dîner, et que j’entre et aille m’asseoir à leur table. Ils mangent ; mais devant moi il y a une assiette vide. Le fait que nous soyons tous assis à la même table suffit-il à faire de nous tous des dîneurs ? Je ne dîne pas tant qu’on ne me laisse pas prendre ma part du repas. Il ne suffit pas d’être assis à la même table que les dîneurs pour dîner. »
Comment les Français issus de l’immigration pourraient-ils se reconnaître dans les institutions politiques françaises alors que celles-ci les invitent au mieux à s’asseoir à leur table mais que leurs assiettes restent désespérément vides ? Le reproche qui leur est fait de ne pas participer au système politique n’est en vérité qu’une expression supplémentaire de l’injonction paradoxale à l’« intégration ». On vous exclut et on vous somme en même temps de vous intégrer. Comme vous ne le faites pas, c’est bien vous le coupable et non pas le système politique. Et comme vous êtes coupables, cela prouve bien que celui-ci a raison de vous exclure !
Second extrait : « Même patron, même combat » ?
p.-s.
Le livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue, est publié aux Editions Textuel.
notes
[1] S.Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue, Editions Textuel, 2006.
[2] Politis du 20 octobre 2005
« même patron, même combat » ?
Remarques sur les limites d’un slogan
par
8 mars 2006
Le slogan « Travailleurs français-immigrés, même patron, même combat » masque une réalité : les travailleurs immigrés ne sont pas seulement des travailleurs ; ils sont aussi des postcolonisés. Les travailleurs français ne sont pas seulement des travailleurs ; ils sont des travailleurs blancs.
Qu’ils le veuillent ou non, ceux qui ne sont pas issus de la colonisation, s’ils sont exploités, en tirent tout de même quelques avantages matériels, politiques, symboliques ou autres. Ne serait-ce que le fait de n’être pas au bas de l’échelle et quand bien même ils subissent à leur tour les effets indirects de la persistance du rapport postcolonial. « Ainsi, aujourd’hui, comme le précise l’Appel des indigènes, dans le contexte du néo-libéralisme, on tente de faire jouer aux travailleurs immigrés le rôle de dérégulateurs du marché du travail pour étendre à l’ensemble du salariat encore plus de précarité et de flexibilité. »
Dans son Portrait du colonisé, Albert Memmi écrit, à juste titre :
« Je ne crois pas qu’une mystification puisse reposer sur une complète illusion, puisse gouverner totalement le comportement humain. Si le petit colonisateur défend le système colonial avec tant d’âpreté, c’est qu’il en est peu ou prou bénéficiaire. La mystification réside en ceci que, pour défendre ses intérêts très limités, il en défend d’autres infiniment plus importants, et dont il est par ailleurs la victime. Mais, dupe et victime, il y trouve aussi son compte. »
Ainsi, ce sont les privilèges (pas nécessairement matériels mais aussi politiques et symboliques) qui forment le colonisateur et non pas son « idéologie ». Tout ce qui est discrimination pour le colonisé est privilège pour le colonisateur – même « petit » :
« Se trouve-t-il en difficulté avec les lois ? La police et même la justice lui seront plus clémentes. A-t-il besoin des services de l’administration ? Elle lui sera moins tracassière ; lui abrégera les formalités ; lui réservera un guichet, où les postulants étant moins nombreux, l’attente sera moins longue. Cherche-t-il un emploi ? Lui faut-il passer un concours ? Des places, des postes lui seront d’avance réservés ; les épreuves se passeront dans sa langue, occasionnant des difficultés éliminatoires au colonisé. »
J’ai mentionné plus haut [1] les privilèges relatifs dont bénéficiaient les ouvriers français de Renault par rapport à leurs collègues immigrés. Cette inégalité se reflète dans les priorités du mouvement syndical même si celles-ci procèdent de multiples logiques. On ne peut, certes, nier que les syndicats et la gauche se sont mobilisés en faveur des travailleurs immigrés (de même qu’il serait abusif d’occulter le rôle de certaines fractions de la gauche dans la lutte anticoloniale), on pourrait, cependant, donner également de multiples exemples de l’exclusion ou de la relativisation des revendications des travailleurs immigrés par le mouvement syndical et la gauche, tout au long des dernières décennies – sans oublier la politique de la gauche gouvernementale. Mais, ce qui importe ici est de souligner que les logiques immanentes au champ politique blanc peuvent se déployer dans le cours même de la solidarité avec les luttes des travailleurs immigrés.
Les résidents des foyers Sonacotra ont pu ainsi s’appuyer sur un très large mouvement de solidarité au sein de la gauche [2] qui leur permettra d’organiser de grandes manifestation (25 000 personnes à Paris, le 24 avril 1976). Dès le départ, pourtant, leur volonté de garder le contrôle de leur propre lutte se heurte à de sérieux obstacles. Pour la plupart inexpérimentés, ne maîtrisant pas tous le français, ignorants les méandres du champ politique français, ils sont obligés de s’en remettre à des militants « plus qualifiés » et à des « experts ». L’exemple des conférences de presse que relate Assana Ba, ancien porte-parole des résidents en lutte, est particulièrement significatif :
« Nous étions quatre ou cinq des foyers. Deux seulement parlaient bien français. Mustapha ouvre les débats (on comprend à moitié ce qu’il dit). Moi, je positionne. Puis nous donnons la parole à « notre » architecte (Yannis Thiomis), « notre » expert-comptable (Jean-Yves Doucet), « notre » économiste (Jean-Yves Barrère). Et ils expliquent tout. » [3]
Ils sont confrontés en outre à la prétention de la CGT et du PCF de s’emparer de la direction du mouvement en invoquant la nécessité de ne pas diviser la classe ouvrière. Ainsi, alors que les locataires des foyers exigeaient le « renvoi des gérants racistes », « le PC et la CGT nous répondaient, se souvient encore Assana Ba : “ Impossible ! Certains de ces gérants sont syndiqués chez nous. C’est l’unité des travailleurs qui va être brisée.” » Soucieux de préserver l’unité des travailleurs, le couple CGT-PCF n’hésite cependant pas à diviser les comités de résidents. Dès la fin de l’année 1975, en effet, les relations sont quasiment rompues entre les représentants du foyer Salvador-Allende, liés aux PCF par l’intermédiaire de ses élus locaux et de la CGT, et les représentants du foyer Romain-Rolland de Saint-Denis qui affirment leur autonomie. Assana Ba relate ainsi l’attitude des principales organisations ouvrières :
« Les premières frictions ont concerné la question de l’autonomie. Le Parti communiste souhaitait s’immiscer dans la désignation des délégués. À Montreuil, par exemple, ils voulaient mettre un militant du PC qui travaillait à la mairie et un délégué CGT de chez Renault. A priori, cela ne me dérangeait pas, mais quand j’ai vu qu’on proposait la même chose à Saint-Denis ou à Bagnolet, j’ai compris qu’on risquait d’avoir des délégués qui seraient des représentants du Parti plus que des représentants des foyers. » [4]
Les communistes, ajoute-t-il, « avaient ôté de la plate-forme de revendications notre exigence essentielle : les négociations directes avec la Sonacotra ». Considérant que « les travailleurs avaient déjà des représentants – les syndicats », le PCF tentait ainsi d’évincer le Comité de coordination, émanation directe des résidents. De fait, sur cette question, il se trouvait avoir la même position que le gouvernement qui refusait de reconnaître la légitimité du Comité de coordination. Assana Ba y voit le résultat de l’insertion institutionnelle du parti communiste :
« La Sonacotra et le PCF – dont les représentants locaux et nationaux se connaissent bien, ayant eu à négocier ensemble l’implantation des foyers lors de leur construction. »
L’autonomie se heurte également aux enjeux et à la compétition au sein même de la gauche. Le PCF paraît d’autant plus déterminé à imposer son contrôle au mouvement qu’il y décèle une influence maoïste, effectivement non-négligeable [5]. Pour ces derniers, l’occasion semble trop belle d’affaiblir le « social-impérialisme » dont le PCF est, à leurs yeux, le relais en France. Mais, au-delà des enjeux qui les opposent, toutes les formations de gauche, mobilisées en faveur des locataires de la Sonacotra, partagent un paradigme commun : le caractère central de la lutte des classes et de l’unité des travailleurs :
« les étudiants de Vincennes nous disaient que notre lutte avait d’autant plus de chance d’aboutir qu’elle était partagée par le mouvement ouvrier français et ses représentants. C’est aussi ce que disait la LCR. Ce n’était d’ailleurs pas faux. »
Ce n’était pas faux à condition, précise l’ancien porte-parole des résidents en lutte, qu’ils n’en fassent pas « un préalable pour nous soutenir. » Or, justement, dans le contexte spécifique français, le mouvement ouvrier institutionnalisé, partie prenante de la société postcoloniale, ne peut pas soutenir le combat immigré sans lui imposer sa direction et ses propres enjeux.
p.-s.
Ce texte est extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue [6]
notes
[1] Cf. S. Khiari, Pour une politique de la racaille. Indigènes, immigrés, jeunes de banlieue, Editions Textuel, 2006
[2] Le PS reste à l’écart.
[3] Entretien à Vacarme, été 2001, n° 16, « Vingt ans après – Entretien avec Assane Ba ».
[4] « Mais un dimanche, alors qu’on était en réunion pour préparer les revendications et exiger une rencontre avec la Sonacotra, on apprend par L’Humanité qu’un comité de coordination a été formé. Or les responsables de ce comité étaient justement membres du PC ou délégués syndicaux. » Assana Ba, Ibidem.
[5] Ceux-ci n’ayant effectivement pas ménagé leur soutien et étant parvenu à « retourner un certains nombre de délégués intermédiaires ».Ibid.
[6] S. Khiari, Pour une politique de la racaille. Indigènes, immigrés, jeunes de banlieue, Editions Textuel, avril 2006
« tous ensemble » ?
Réflexions sur les ambivalences de « l’internationalisme prolétarien »
par
9 mars 2006
L’universalisme peut être raciste en ce que, déterminé par l’histoire de l’expansion occidentale, il a pu justifier la « mission civilisatrice » et les horreurs qui l’ont accompagnée. Mais l’internationalisme prolétarien, lui, peut-il être raciste ?
Oui, l’internationalisme prolétarien peut être raciste. De même que le slogan
« Travailleurs français-immigrés : même patron, même combat » est faux et juste à la fois, le mot d’ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » est lourd d’ambivalences. Il est vrai qu’il a pour finalité l’abolition de toutes les formes d’exploitations de l’homme par l’homme [1] mais, outre qu’il plonge ses racines dans un certain universalisme idéaliste, il présuppose une homogénéisation de l’espace et du temps par la domination capitaliste, conçue comme la forme ultime de la société de classes et, par là, la plus progressive, toutes les autres formes sociales n’étant que les résidus destinés à disparaître des anciennes sociétés de classes. Si Marx a soutenu le mouvement national en Irlande, ce n’était sans doute pas tant pour défendre les droits nationaux des Irlandais que pour affaiblir le capital anglais, considéré comme la pointe avancée de la domination bourgeoise. Dans les articles où il analyse la Guerre de sécession aux Etats-Unis, il prend naturellement parti contre l’esclavage. « Le travail sous peau blanche ne peut s’émanciper là où le travail sous peau noire est stigmatisé et flétri », écrit-il dans Le Capital [2] :
« Tant que les travailleurs (américains blancs) se glorifièrent de jouir – par rapport aux Noirs, qui avaient un maître et étaient vendus sans être consultés – du privilège d’être libres de se vendre eux-mêmes et de choisir leur patron, ajoute-t-il plus loin, ils furent incapables de combattre pour la véritable émancipation du travail, ou d’appuyer la lutte d’émancipation de leurs frères européens. Toute velléité d’indépendance de la part des ouvriers est restée paralysée aussi longtemps que l’esclavage souillait une partie du sol de la République. » [3]
Marx n’appelle pas les esclaves à se joindre aux travailleurs privilégiés « d’être libres de ne pas se vendre » dans une lutte commune contre le capital, comme l’auraient fait de nombreux gauchistes français. Il considère au contraire que le devoir révolutionnaire des travailleurs américains blancs est de soutenir la lutte de libération des esclaves noirs pour leur libération. Reste que, indépendamment des convictions humanistes anti-esclavagistes qui sont les siennes, il appréhende la lutte contre l’esclavage à travers le prisme d’une histoire confondue avec la lutte des classes et fléchée par l’émancipation des travailleurs.
(…)
En vérité, l’ « émancipation » dite universelle, pensée comme la mise au jour de relations sociales débarrassées de toutes formes d’aliénation individuelle, n’est pas seulement illusoire, elle est lourde d’ambivalences. La revendication universaliste peut, en effet, facilement se dévoyer en ruse des dominants. L’histoire du colonialisme et de l’impérialisme occidental en a montré maints exemples. Un ethnocentrisme – au sens donné par Claude Lévi-Strauss consistant « à répudier purement et simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions » [4] – peut se nicher dans la prétention universaliste. Elle devient raciste lorsqu’elle disqualifie comme archaïque, réactionnaire, retardataire, la recherche tâtonnante, par des peuples occidentalisés malgré eux, de formes sociales où, tout simplement, on se sente bien. Elle devient aveugle à ses propres apories lorsqu’elle refuse de s’interroger sur elle-même à partir des résistances des peuples qu’elle veut soumettre à ses présupposés/finalités. Un certain fondamentalisme universaliste parlant au nom de « l’émancipation » a davantage d’analogies avec l’intégrisme islamique qu’il ne le croit.
p.-s.
Ce texte est extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue [5]
notes
[1] Il n’envisage pas, soulignons-le, les différentes formes de domination et d’oppression qui ne sont pas constitutives en tant que telles du « mode de production capitaliste ».
[2] Marx, Le Capital, livre I, Gallimard, La pléiade, Paris, 1965, p.835
[3] Marx, Le capital, livre I, tome I, Editions sociales, Paris, 1962, pp.19, 294-295.
[4] Dans Race et histoire (1e éd. : 1952), Paris, Denoël/Gallimard, coll. « Folio-essais », 1987, p.19.
[5] S. Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue, à paraître aux éditions Editions Textuel, avril 2006
y a-t-il un « racisme anti-blanc » ?
Oppression raciste et « racisme » des opprimés : une différence de nature
par
10 mars 2006
Bien des « Français d’origine française » – des Blancs – peuvent se sentir agressés par mon propos. Et je le regrette. Il n’est nullement dans mon intention, pas plus que dans celle du Mouvement des indigènes, de suggérer une culpabilité collective. Cependant, le fait de se sentir ainsi agressés ne révèle-t-il pas un problème ?
Lorsqu’il est dit qu’un individu qui consomme et travaille, participe à la reproduction du capital, qu’il le veuille ou non, qu’il soit de droite ou de gauche, cet individu se sent-il agressé ? Quand il est enseignant, responsable dans l’administration, journaliste, chercheur dans un laboratoire pharmaceutique, se sent-il agressé si on lui fait remarquer les incidences de son activité professionnelle en termes de reproduction d’un système inégalitaire ? Soupçonne-t-il chez le sociologue de la domination une volonté d’instaurer une sorte de culpabilité collective ? Non. Il paraît donc intéressant de se demander pourquoi le reproche d’ « agressivité » a été opposé au discours indigène.
Nous avons vu plus haut que certains Blancs ont pu trouver inconvenant de se réclamer d’un « nous » qui revendique une filiation d’oppression et de lutte avec les anciens esclaves et les colonisés [1] ; d’autres se sont sentis « agressés » par la formule « Nous, Noirs, Arabes, Musulmans etc… ». Pourtant, les gens de gauche qui ont entre les mains un tract où figure la formule « Nous, les ouvriers… » ne se sentent nullement agressés même s’ils ne sont pas ouvriers. Ce sont les bourgeois et les personnes qui en partagent les valeurs, précisément ceux qui sont dans l’autre camp, qui se sentent agressés. De même, depuis peu (et comme résultat des luttes menées par les homosexuels), un hétérosexuel non-homophobe ne se sentira pas agressé par un tract intitulé « nous les homo ». C’est peut-être finalement que ces combats semblent plus légitimes. Non pas que l’antiracisme le soit moins dans l’esprit des personnes dont je parle, mais il ne l’est qu’à la condition de s’inscrire dans le cadre d’un combat considéré comme vraiment légitime par les Blancs, c’est-à-dire une lutte sociale et universaliste. On comprend donc que les Noirs, les Arabes, les Musulmans, etc. se sentent eux-mêmes agressés par ceux qui se sentent agressés par leur auto-affirmation en tant que Noirs, Arabes ou Musulmans. Oui, nous sommes noirs, comme Aimé Césaire revendiquait sa couleur noire. Oui, bien que magnifique spécimen de type caucasien, je suis Noir !
« Soit, nous dira-t-on sans grande conviction, admettons que le système dans son ensemble soit ségrégationniste, on ne peut de toute façon considérer que tous les Français blancs soient racistes, quand bien même – admettons-le aussi – ils bénéficieraient indirectement et involontairement du régime postcolonial. Pourquoi ne pas parler d’un champ politique postcolonial mais d’un champ politique blanc qui est une catégorie raciale ? Vous ne dites pas seulement les “partis blancs”, vous dites aussi les “Blancs”, le “Blanc”. Peut-on parler de “Blancs” sans sombrer dans l’ethnicisme, le racial et le biologique ? Ne risque-t-on pas ainsi d’alimenter une forme de racisme anti-Blanc ? »
Mais qui sont les populations exclues du champ politique sinon celles qui ne sont pas blanches ou considérées comme telles ? Parler de Blancs, ce n’est pas essentialiser le Blanc en tant que blanc, ce n’est pas dire le Blanc est mauvais, intrinsèquement mauvais, coupable à jamais des crimes de ses ancêtres. « Humainement, personnellement, la couleur n’existe pas. Politiquement elle existe. »(James Baldwin) [2] Politiquement, c’est-à-dire comme rapport social. Le Blanc est un rapport social et non un fait naturel. Il n’existe en tant que tel que comme moment d’un rapport social d’oppression et de lutte contre cette oppression. Il ne leur est pas antérieur.
Lorsque nous parlons de Blancs, c’est pour pointer la réalité d’un système politique au sein duquel la ségrégation d’origine coloniale est toujours active et auquel, malgré eux souvent, les individus ne peuvent échapper. Car si tout le monde subit, d’une certaine façon, le legs colonial, celui-ci est fondé sur une discrimination ethnique ou culturelle. De ce point de vue, les personnes qui ne sont pas issues de la colonisation font partie de la société dominante même si elles y sont intégrées dans une position subalterne. Elles appartiennent au monde des dominants même si elles ont fait le choix individuel de nier subjectivement leur propre situation. La capacité de certains Blancs à s’arracher à cette détermination est sans doute précieuse ; elle doit assurément être encouragée mais ne peut fonder ni l’analyse du réel ni une stratégie politique, au sens d’en être l’axe privilégié.
(…)
Le racisme, on ne le répétera jamais assez, est un système de domination. Il produit la stigmatisation de l’Autre dans le même temps où il instaure hiérarchisations et discriminations. La notion de racisme, comme hétérophobie, est une notion abstraite qui identifie des réalités historiques trop différentes et conduit, sur le plan politique, à l’impasse de l’antiracisme comme gadget éthique. L’être humain se méfie comme de la peste de tout ce qui lui paraît différent : et alors ? S’il s’agit d’un comportement quasiment inné ou naturel, il n’y a rien à y faire et ce ne sont pas des campagnes éducatives pour l’élévation morale du genre humain qui y changeront grand chose. S’il s’agit de relations sociales et politiques bien spécifiques, alors, si l’on veut combattre la détestation de l’Autre qui en procède, on se doit de définir précisément ces relations sociales et politiques. De ce point de vue, on ne peut évidemment identifier dans une même catégorie la haine raciale du dominant à l’encontre du dominé et la haine raciale du dominé à l’encontre du dominant. Toutes deux sont produites par le même système raciste mais l’une en est un agent actif tandis que l’autre constitue une réaction voire une forme de résistance au système raciste. L’une est armée, l’autre est désarmée. C’est pourquoi, lorsqu’il analyse la condition spécifique du colonisé, Albert Memmi parle d’un « racisme édenté » [3]. Ce racisme n’est pas une modalité de la domination et toute la différence est là. Quand un commerçant blanc refuse d’employer un indigène, c’est du racisme même si ce refus procède d’une simple logique commerciale : préserver sa clientèle habituelle qui, elle, pourrait être raciste ; quand un commerçant marocain refuse d’employer un Blanc et lui préfère un Marocain, ce n’est pas du racisme ; c’est un acte de soutien à un opprimé même si la motivation réelle est tout simplement d’être entre-soi (le fameux « communautarisme ») et même si le commerçant marocain n’aime pas les Blancs.
Quand nous employons la notion générique de racisme, il faut constamment avoir à l’esprit cette distinction fondamentale entre le racisme à proprement parlé, indissociable de la domination, du « racisme édenté » propre aux dominés. Sur le plan de l’analyse comme sur le plan de la lutte politique, on ne saurait les assimiler.
Lorsque des dominés renoncent à cette forme de racisme contre eux-mêmes – réverbération du racisme dont ils sont l’objet -, qui consiste à se croire réellement inférieurs aux dominants et à vouloir leur ressembler à tout prix, et s’affirment au contraire supérieurs, c’est bien une nouvelle illusion puisque nul n’est supérieur à personne, c’est une démarche ambivalente certes, comme l’est la vie réelle, mais cela peut être en même temps un moment de leur lutte contre la domination qu’ils subissent. Le mouvement d’émancipation des Noirs aux Etats-Unis a été et demeure traversé par un racisme anti-Blanc, il n’en demeure pas moins un mouvement d’émancipation. On peut considérer qu’une telle idéologie ne peut conduire à terme qu’à une impasse du point de vue des objectifs de libération du peuple noir et, plus généralement, du point de vue des idéaux égalitaires ; pour autant, peut-on appréhender ce racisme dans l’absolu, indépendamment du contexte historique précis de son émergence ? Ne faut-il pas plutôt en comprendre les ressorts et pointer les contradictions ? « Toute thèse affirmant la supériorité d’une race est condamnable » écrit Claude Julien [4] mais, ajoute-t-il aussitôt, « elle obtient le prodigieux résultat de rendre aux Black Muslims la fierté et la dignité humaines que le racisme des Blancs leur refuse » :
« En exaltant la négritude, les Black Muslims libèrent le Noir de la honte et du sentiment d’infériorité qui lui ont été imposés par des siècles d’esclavage, de mépris, d’injustices. »
Mis en perspective historique, contextualisé, ce « racisme édenté » a été en même temps que réactionnaire du point de vue des valeurs d’égalité, un moment progressiste de la lutte pour l’égalité des Noirs et des Blancs aux Etats-Unis. Dans le même esprit, Albert Memmi écrivait :
« Le racisme du colonisé n’est en somme ni biologique ni métaphysique, mais social et historique. Il n’est pas basé sur la croyance à l’infériorité du groupe détesté, mais sur la conviction, et dans une grande mesure sur un constat, qu’il est définitivement agresseur et nuisible. Plus encore, si le racisme européen moderne déteste et méprise plus qu’il ne craint, celui du colonisé craint et continue d’admirer. Bref, ce n’est pas un racisme d’agression, mais de défense. (…) C’est pourquoi on peut soutenir cette apparente énormité : si la xénophobie et le racisme du colonisé contiennent, assurément, un immense ressentiment et une évidente négativité, ils peuvent être le prélude d’un mouvement positif : la reprise en main du colonisé par lui-même. »
Redire Memmi, aujourd’hui, dans un contexte idéologique marqué par l’hégémonie de l’antiracisme abstrait, conduit au pilori, une plaque d’infamie clouée au front : « Coupable de hiérarchiser les racismes » ! Bien plutôt, il s’agit, pour nous, de ne pas confondre dans une même « haine de l’autre » des phénomènes différents, de saisir leurs dynamiques historiques et les paradoxes des luttes des dominés, dominés également par les valeurs des dominants qu’ils combattent.
Son rejet du racisme, Malcolm l’attribue à son pèlerinage à la Mecque et à ses voyages en Afrique durant les mois qui suivent sa rupture avec les Black Muslim. Durant ces voyages, explique-t-il, il a pu rencontrer de nombreux blancs, blonds, aux yeux bleus complètement dénués de racisme anti-Noir ; il a pu voir, en Algérie et au Maroc, d’autres blancs, eux-mêmes traités en Noirs, et qui avaient été violemment colonisés ; il a pu surtout constater que d’autres peuples étaient en lutte contre l’Amérique qui dominait le monde comme elle dominait les Noirs en son propre sein :
« Auparavant, j’ai permis que l’on se servît de moi pour condamner en bloc tous les Blancs, et ces généralisations ont injustement blessé certains d’entre eux. (…) je me refuse dorénavant à condamner en bloc toute une race (…). Je ne suis pas raciste et je ne souscris à aucun des dogmes du racisme. » [5]
Il ne cessera de le répéter par la suite [6], tout en continuant à parler de « l’homme blanc » :
« Tous nous avons subi, dans ce pays, l’oppression politique imposée par l’homme blanc, l’exploitation économique imposée par l’homme blanc et la dégradation sociale imposée par l’homme blanc. Lorsque nous nous exprimons ainsi, cela ne veut pas dire que nous sommes anti-Blancs, mais que nous sommes opposés à l’exploitation, opposés à la dégradation, opposés à l’oppression. Et si l’homme blanc ne veut pas que nous soyons ses ennemis, qu’il cesse de nous opprimer, de nous exploiter, de nous dégrader. » [7]
Malcolm X met en cause le système ségrégationniste mais, sans faire du Blanc un coupable éternel. Il souligne sa participation à ce système car, dans les conditions de l’Amérique, seule une petite minorité des Blancs parvient elle-même à se détacher du racisme anti-Noir.
Les indigènes sont opprimés en tant qu’Arabes ou que Noirs dans une société qui privilégie les Blancs, comment pourraient-ils lire la réalité de cette société à travers une autre grille que la grille ethnique ou raciale ? « C’est habituellement le raciste blanc qui a créé le raciste noir. » [8] Il ne s’agit certes pas de « refaire à rebours le chemin de Malcolm X », comme le craint Daniel Bensaïd [9], mais de ne pas rejeter indistinctement ceux qui commencent là où il a commencé. Supprimer le postcolonialisme, c’est reconnaître, pour les supprimer, les frontières qui clivent une société basée sur les discriminations ethniques. Ce combat se mène dans la durée mais sans céder à la tentation ultimatiste (poser la fin comme précondition), sans craindre les situations paradoxales, il constitue dès l’abord un axe majeur.
p.-s.
Ce texte est extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Indigènes, immigrés, jeunes de banlieue [10].
notes
[1] Ecartons tout de suite l’argument étrange formulé maintes fois selon lequel, il serait « indécent » pour des Blancs de prétendre s’identifier à un « nous » qui renvoie aux descendants d’esclaves et de colonisés. Je ne peux que répéter ici ce que nous avions écrit Alix Héricord, Laurent Levy et moi-même :
« Ainsi de même qu’il y a plein de bonnes raisons de participer à une manifestation de défense de l’avortement sans être une femme ou sans être une femme qui a avorté, de même qu’il y a plein de bonnes raisons de participer à une gaypride sans avoir de pratiques homosexuelles, de même qu’on peut participer à un mouvement de précaires sans l’être (ou du moins pas encore) ou à une manif de sans-papiers tout en ayant sa carte d’identité dans la poche, il n’est pas besoin de brandir son arbre généalogique pour participer à un mouvement des « indigènes de la République ». L’usage expansif de la 1ère personne du pluriel depuis les années 70 dans les luttes pour l’émancipation a fait émerger des sujets politiques complexes dont nous ne comprenons pas pourquoi les “indigènes” seraient exclus. »
On pourrait ajouter qu’il n’a jamais semblé ridicule aux militants d’organisations d’extrême-gauche de se définir comme « militants ouvriers » du simple fait qu’ils s’identifiaient au combat ouvrier ; leur position sociale réelle n’entrant aucunement en ligne de compte dans cette auto-définition.
[2] James Baldwin, La prochaine fois le feu, op.cit., p.134
[3] Albert Memmi, Le Racisme.
[4] Cl. Julien, préface à Malcolm X, op.cit., p.25
[5] Malcom X, op.cit., p.96
[6] Un mois avant son assassinat, il déclarait au journal Young Socialiste, organe de l’organisation de jeunesse du SWP (IVème internationale) :
« Tout d’abord, je ne suis pas un raciste. Je suis ennemi de toutes les formes de racisme et de ségrégation, de toutes les formes de discrimination. Je crois aux droits de la personne humaine et au fait que toute personne doit être respectée, peu importe la couleur de sa peau. »
[7] Malcolm X, op.cit., p.59
[8] Malcolm X, ibidem, p.234
[9] Daniel Bensaïd formule cette crainte dans son livre Fragments mécréants, qui reprend, en les développant, les reproches aterrants qu’il avait adressés au Mouvement des Indigènes de la République au printemps 2005 dans une tribune parue dans Libération. Précision du collectif Les mots sont importants
[10] S. Khiari, Pour une politique de la racaille. Indigènes, immigrés, jeunes de banlieue, Editions Textuel, avril 2006
SOS Racisme… des potes qui nous voulaient du bien
par Sadri Khiari
Source : ce texte est extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille.Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue, que nous recommandons vivement.
Le succès de SOS-Racisme a généralement été appréhendé comme une simple opération de « récupération », concoctée dans les cabinets de Mitterrand et favorisée par « l’immaturité » des mouvements « beurs ». Dans sa thèse sur le traitement médiatique de l’association anti-raciste, P. Juhem [1] a mis en lumière les multiples déterminations qui ont rendu possible la « récupération ». Plutôt que de recourir à l’hypothèse fantaisiste d’une vaste manipulation engagée par une sorte de « comité central » des médias dominé par les socialistes, il a tenté de repérer les logiques spécifiques au champ médiatique, la pluralité des facteurs (enjeux internes, compétitions, stratégies commerciales, évolution du profil idéologique des journalistes, etc.), qui ont convergé pour aboutir à une gigantesque campagne de promotion de SOS-Racisme, sans minimiser, pour autant, la volonté politique de certains responsables socialistes – en premier lieu, Mitterrand – et l’efficacité de leurs interventions dans un contexte favorable.
Les énormes subventions reçues, le soutien de plus en plus affirmé de la gauche, des médias et de nombreux intellectuels ont incontestablement contribué, en effet, au succès de SOS-Racisme. On doit y voir également l’effet de dispositifs propres au système postcolonial. La « récupération » apparaît comme une menace inhérente à celui-ci – ce qui ne signifie pas inévitable – et non pas comme le seul produit d’intérêts politiques circonstanciés et de stratégies habilement menées. On a parfaitement raison de condamner de ce point de vue la politique du PS mais il est tout aussi important de saisir pourquoi, malgré leur bonne volonté, de nombreux militants antiracistes ont pu jouer le jeu d’une entreprise d’exclusion/inclusion.
Au début des années 80, « les Beurs deviennent trop subversifs » [2]. La Marche pour l’Egalité et les multiples formes d’action qui l’ont précédé ou suivi donnent aux jeunes issus de l’immigration une formidable visibilité qui inquiète, dans un contexte politique mouvant. L’abandon des promesses qui avaient conduit Mitterrand au pouvoir et l’adoption d’une politique de rigueur ne suscite pas la mobilisation sociale qu’espérait l’extrême gauche. La tendance politique dominante, notamment au sein de la jeunesse lycéenne et étudiante, n’est plus à la contestation mais plutôt à la désaffection vis-à-vis de l’engagement politique tandis qu’avec le recul des paradigmes marxistes s’imposent les idéologies molles de la défense des droits de l’homme et du progrès « sociétal ». La droite, par contre, progresse. Elle remporte plusieurs élections municipales partielles et repart à l’offensive comme en témoignent les gigantesques manifestations pour « l’école libre ». Le Front national connaît, quant à lui, ses premières grandes victoires (élections européennes). La « bête immonde » resurgit, craignent de nombreux secteurs de la gauche, assimilant la nouvelle situation à la montée du fascisme dans les années 30. Pour beaucoup, la lutte antifasciste devient la priorité de l’heure et l’antiracisme devient l’arme de cette lutte, d’autant plus efficace leur semble-t-il qu’un antiracisme moral et englobant peut permettre un large rassemblement de forces et remobiliser la jeunesse sur des « valeurs de gauche ».
Dans ce contexte, le mouvement « beur » pose incontestablement problème. L’irruption des enfants de l’immigration sur la scène publique inquiète. Il alimenterait le discours du Front national. Il embarrasse le pouvoir socialiste déterminé à restreindre l’immigration, mais il peut constituer aussi une nouvelle ressource électorale pour la gauche. D’une part, parce que de nombreux jeunes issus de l’immigration ont le droit de vote mais également parce que la problématique antiraciste qui est la sienne suscite la sympathie de larges franges de la jeunesse. Il s’agit dès lors de l’encadrer, de neutraliser ses tendances les plus contestataires et d’aseptiser son discours. « Convergence 84 révéla, écrivent Ahmed Boubeker et Nicolas Beau, une réelle capacité de mobilisation des cités. Personne pourtant pour canaliser cette révolte. Une place était à prendre ; message vite compris par Harlem Désir et ses potes : le jour même de l’arrivée de Convergence, 5000 badges « Touche pas à mon pote » de SOS-Racisme étaient vendus. L’idée du mélange, débarrassée de ses relents égalitaires, était reprise par Harlem Désir : « Vivons avec nos ressemblances, quelles que soient nos différences » : ce slogan de Convergence permettait à chacun, français ou immigré, de s’exprimer, sans complexes, sur la société multiraciale. Les beurs avaient perdu ce monopole. Avec SOS-Racisme, la société française reprenait la parole. Le relais était passé. » [3] C’est, en effet, à l’occasion de la seconde Marche, organisée par « Convergence 84 » que le petit groupe constitué autour de Julien Dray, transfuge de la LCR au Parti socialiste, apparaît sur la scène publique en diffusant massivement la fameuse petite main jaune. Mogniss Abdallah y voit un «talisman, hybride de la main de Fatma et de l’étoile jaune des Juifs sous le nazisme » [4]. Alors que les jeunes issus de l’immigration avaient manifesté contre le racisme particulier dont ils sont l’objet, SOS met en avant une vision exclusivement moralisante et non politique du racisme, détachée de l’histoire sociale et politique concrète. La référence implicite à l’étoile jaune n’est pas non plus innocente. Elle n’est pas sans lien avec le « choix exclusif de l’UEJF comme co-fondatrice de l’association » [5] suppose Mogniss Abdallah. En décembre 1983, de nombreux marcheurs étaient fiers de porter le Keffieh, symbole du peuple palestinien. Le « talisman » de SOS suggère, quant à lui, que la question palestinienne ne serait qu’un conflit entre juifs et arabes soluble dans l’antiracisme. M.Abdallah décrypte également le slogan « Touche pas à mon pote ». Celui-ci met « en scène un Français (anti-raciste) s’adressant à un autre Français (raciste, donc souvent suspect d’accointance avec le FN) pour protéger son « pote » issu de l’immigration. Le « pote » devient par un spectaculaire retournement de situation le spectateur passif d’un enjeu politique franco-français où il est question de cordon sanitaire anti-FN ou d’un « front républicain » pour des échéances électorales et les « combinazzione » à venir » [6]. Le racisme apparaît ainsi comme un rapport inter-individuel, une forme d’hétérophobie portée par l’extrême-droite. L’antiracisme devient une posture éthique, un combat qui se déroule entre Blancs.
Si le discours de SOS évoluera progressivement au fur et à mesure de l’enracinement du mouvement et des nouveaux enjeux politiques qui se poseront à lui, à sa fondation, la nouvelle association s’attache à se présenter comme a-politique, ni trop de gauche ni de droite. « Alors que quelques années auparavant un mouvement se proclamant « apolitique » aurait rencontré l’opposition de toutes les organisations politiques et antiracistes « de gauche », note P. Juhem (…), au contraire en 1985, l’affichage de « l’apolitisme » du mouvement est la condition de sa réussite, à la fois à l’égard de journalistes qui se réjouissent de la « fin des idéologies » et vis-à-vis de jeunes qui sont proportionnellement plus nombreux qu’auparavant à être indifférents à l’égard de « la politique ».» [7] SOS apparaît ainsi comme le cadre idéal pour mobiliser la jeunesse et canaliser la révolte des banlieues.
La finalité de l’association antiraciste est double. Il s’agit d’inclure les « beurs » dans des logiques politiques qui ne sont pas les leurs et d’exclure du champ politique ceux qui développent une orientation en rupture avec le consensus antiraciste basé sur l’intégration individuelle. Cette exclusion se réalise par diverses procédures. La première est évidemment de donner à SOS une légitimité qu’elle n’a pas en la présentant comme l’héritière de la Marche de 1983[8]. La seconde consiste à marginaliser les mouvements autonomes qui n’ont guère d’alliés dans le champ politique blanc ni, évidemment, de subventions. Le soutien gigantesque dont bénéficie SOS lui permet alors d’occuper tout l’espace antiraciste. Les mouvements autonomes sont soumis, quant à eux, à une terrible injonction qui contribuera à aggraver les dissensions en leur sein : se résoudre à une alliance avec SOS, c’est-à-dire accepter son hégémonie et les enjeux (blancs) qui sont les siens, ou prendre le risque de l’isolement avec – déjà – l’accusation de diviser le mouvement antiraciste. Ainsi, si SOS ne parvient pas à s’implanter réellement dans les cités, elle réussira néanmoins à gagner des militants comme Kaïssa Titous et Malik Lounès qui se résignent à y voir le seul cadre de regroupement possible et espèrent avoir suffisamment d’influence pour en changer l’orientation. « Lors du premier congrès de SOS-Racisme à Epinay-sur-Seine en 1986, rapporte P. Juhem, le principal débat aura lieu entre, d’une part, Julien Dray et la direction historique de l’association et, d’autre part, Kaïssa Titous qui, soutenue par les militants de la LCR, tentera de constituer au sein de SOS une tendance « beur », attachée à défendre la spécificité des « jeunes issus de l’immigration maghrébine ». D’autres batailles seront menées, notamment pour que l’association antiraciste prenne partie en faveur du peuple palestinien ou s’oppose à l’engagement des troupes françaises lors de la première guerre du Golfe. Mais ces batailles, si elles n’ont pas toujours été sans résultats, ne pouvaient pas rendre la parole à ceux qui en avaient été exclus.
Au principe de SOS, il y a en effet l’exclusion des « Beurs » du champ politique ou leur implication dans des enjeux qui leur sont extérieurs. SOS n’existe que comme cadre de mobilisation et de pression au sein du jeu des forces politiques blanches en instrumentalisant les problématiques de l’immigration et du racisme. Les « beurs » sont appelés à y trouver leur place à la condition de s’insérer dans les enjeux du champ politique blanc et de ne pas en bousculer les règles. SOS n’a pas « récupéré » le mouvement pour l’égalité au sens où elle s’est contentée d’en prendre la direction ; en exploitant ses ambivalences, elle l’a projeté dans le plan politique blanc. Ce faisant, elle a retourné le mouvement contre lui-même.
Sadri Khiari
Source : ce texte est extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille.Immigré-e-s, indigènes, jeunes de banlieue, que nous recommandons vivement.
[1] Juhem, P., Thèse de science politique : « SOS-Racisme, histoire d’une mobilisation « apolitique ». Contribution à une analyse des transformations des représentations politiques après 1981 ».
[2] Bouamama, S., Dix ans de marche des Beurs. Histoire d’un mouvement avorté, Desclée de Brouwer, 1994, p.4
[3] Ibidem, p.91
[4] Ibid., p.69
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] « SOS-Racisme est le premier mouvement de masse de l’après-guerre fondé sur des résolutions d’ordre exclusivement éthique. Il ne propose aucun projet de société, ne nourrit aucune ambition politique. Ses adhérents, pour la plupart des jeunes, ne se font guère d’illusions sur l’état du monde, […].Ils ne croient pas davantage aux promesses d’un monde lointain », Marek Halter, La main ouverte, Le Monde, 16 juin 1985 (cité par P. Juhem).
[8] « À la fin de 1984, il n’y a pas d’organisation nationale ou de porte-parole qui puisse revendiquer représenter l’ensemble des « jeunes issus de l’immigration ». Lorsque SOS-Racisme apparaît les journalistes peuvent, sans risque d’être démentis, faire de l’association l’héritière des « marches » et la représentante naturelle des « beurs ». » Ibidem.
« 8 mai 1945 : jour de fête, jour de deuil »
Passé / Présent, Mémoire / Histoire
par
3 mai 2008
À l’occasion de la quatrième Marche du 8 mai, coorganisée cette fois-ci par les Indigènes de la République et une quinzaine d’autres associations, nous publions un nouvel extrait du livre de Sadri Khiari, Pour une politique de la racaille. Immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues, consacré au rapports entre passé, présent, mémoire et histoire du point de vue des personnes indigénisées, c’est-à-dire issues de l’immigration coloniale et postcoloniale, et traitées comme des sous-citoyen-ne-s. À tous les discours, de droite mais aussi de gauche, qui reprochent aux militant-e-s indigènes leur « manie de la repentance » ou leur « enfermement mémoriel », Sadri Khiari adresse cette cinglante réponse.
« Le monde finira peut-être par étouffer de ses vomissements, ou par crever d’une overdose mémorielle. Comme s’il oubliait l’impossibilité de vivre sans oubli » [1], écrit Daniel Bensaïd. Va pour les vomissements ! L’inquiétude semble hélas plus que fondée à voir les horreurs que la « modernité » apporte au monde. Mais comment exiger de ceux qui ont tout oublié, à qui l’on impose de tout oublier pour mieux les opprimer, de renoncer à se souvenir ? Car, comme le remarquait Abdelmalek Sayad,
« c’est dans les moments de crise, dans les moments de plus grande rupture – et il n’est pas de rupture plus grande, plus douloureuse, plus dramatique, que celle qui se traduit par l’émigration hors de la terre natale et l’immigration en quelque autre terre étrangère –, que l’on a le plus besoin de l’histoire de ses racines ; comme l’histoire de la “généalogie” ou, mieux, de l’ancestralité. » [2]
Il s’agit, pour nous indigènes, non de magnifier mais de retrouver notre histoire pour nous reconnaître nous-mêmes. Juger le passé lointain avec les catégories juridiques et intellectuelles du présent n’a guère de sens, mais comment occulter les plaies profondes qui entaillent nos corps et nos esprits ; comment ne pas voir que ce passé détermine encore nos histoires collectives et singulières ? Comment occulter que les siècles d’esclavage pèsent encore sur le destin du monde ?
Le temps n’est pas encore à la « création d’une “mémoire commune” unificatrice », comme le souhaite Alain Gresh [3], même s’il a peut être raison d’y voir la condition d’une future « réinvention d’une identité française ». Il n’est certainement pas au sommeil laiteux de la « réconciliation des cœurs » ou à l’accouplement des « mémoires meurtries », comme peut l’entendre ici et là. Critiquant, dans Le Figaro, l’Appel des Indigènes de la République, Benjamin Stora affirme, quant à lui, qu’il s’agit désormais d’ « entrer dans la souffrance de l’autre ».
« Entrer dans la souffrance de l’autre » !
Pfff… !!!
Nous n’irons pas déposer une gerbe sur la tombe des pauvres bougres que la République a envoyé se faire tuer en Indochine quand bien même, en échange, des fleurs républicaines seraient offertes en hommage aux Vietnamiens morts au combat. Toutes les histoires ne se valent pas. À la France d’admettre enfin que Diên Bien Phû est sa propre victoire puisqu’elle est une victoire contre le colonialisme. Le véritable universalisme est là.
Reconstruire nos identités

Face à l’histoire coloniale que reproduit constamment la république, une histoire excluante et stigmatisante, il s’agit d’opposer aujourd’hui une autre lecture de l’histoire qui reconnaisse l’histoire des vaincus et nous réinsère dans l’histoire du monde. « L’écriture de l’histoire légitime est un pouvoir qu’il s’agit maintenant de s’approprier » [4], écrit justement Abdelalli Hajjat qui anime le collectif lyonnais « Ici et là-bas ». Contre la « mémoire assimilée, brisée et ambivalente » [5], nos identités sont à reconstruire non à déterrer ou à « purifier ». La « réinvention » de l’Islam à laquelle certains s’attachent, quitte à en idéaliser l’histoire, procède de cette même volonté.
L’histoire à reconquérir est aussi l’histoire des parents immigrés. « La colonisation, c’est le père vaincu et le moi humilié », écrivait avec justesse Jacques Berque. Dans son bilan de la période des Marches, Saïd Bouamama a montré, quant à lui, comment « les médias et le monde politique, en s’emparant du vocable “beur”, l’orientent vers une signification de rupture d’avec la génération des parents. » [6]. « L’histoire de l’immigration est frappée d’indignité », note à son tour Abdellali Hajjat [7] :
« Nos parents n’existent pas historiquement. On a ainsi l’impression d’un phénomène spontané, ces indigènes devenus immigrés apparaissent quasiment de nulle part, pour travailler, et uniquement pour travailler (…) Nous avons, tous, ces souvenirs de réunions de famille au bled où l’on ne connaît pas la moitié des membres tellement ils sont nombreux. On connaît rarement nos liens de parenté avec un tel ou une telle. Qui d’entre les héritiers connaît l’histoire du pays d’origine de leurs parents ? Pourquoi ceux-ci se sont exilés (car il s’agit bien d’exil) ? Comment sont-ils venus en France ? Quel accueil ont-ils reçu ? Comment ont-ils vécu les guerres d’indépendance ? Il n’est pas rare qu’un enfant ne sache pas que sa mère ou son père ait participé activement à la lutte d’indépendance. (…) Chaque génération semble avoir vécu une expérience propre, mais sans qu’une transmission intergénérationnelle n’ait réellement eu lieu. » [8]
Abdellali Hajjat appelle à restaurer la communication, à remplir les vides de la mémoire, à « construire ce qui est nié, à éclairer les zones d’ombres (et il y en a) de l’histoire de l’immigration, et la restituer » :
« Pour que nous soyons fiers de nos parents. Ils n’ont pas été ces ouvriers qui baissent constamment la tête. Ils n’ont pas été des misérables. Ils se sont battus, pour leur pays d’origine, pour leur vie, mais surtout, pour leurs enfants. Beaucoup nous disent que c’est ce qu’il leur reste. Les héritiers de l’immigration post-coloniale doivent être fiers d’eux, et être dignes de leur héritage. »
Un impératif incompréhensible pour la gauche qui « hait la famille ». Elle reste perplexe devant cette formule inscrite sur l’affiche des Indigènes de la république annonçant la Marche du 8 mai 2005 :
« Nos pères, nos mères, ont été humiliés… ».
Les indigènes commémorent d’abord pour rendre hommage à leurs morts. A tous ceux, de Madagascar, du Sénégal, de Tunisie et d’ailleurs, massacrés par les troupes coloniales. Commémorer, c’est se remémorer ; c’est redonner vie à ces morts ; c’est réhabiliter leur combat ; c’est rendre aux morts leur dignité ; c’est leur rendre justice. Commémorer, c’est effacer symboliquement leurs douleurs ; c’est transformer les victimes en héros. Les indigènes refusent d’oublier parce qu’oublier serait rendre inutiles ces morts. Oublier serait assassiner une seconde fois les manifestants du 17 octobre.
Nous ne cultivons pas le culte des ancêtres et des morts mais nous leur sommes attachés. Du point de vue de la raison matérialiste et abstraite, rien ne le justifie ? Ce serait absurde ? Du point de vue de la raison sociale, morale, historique, affective, tout le rend nécessaire au contraire. Le lien qui nous rattache à ces morts, c’est-à-dire à leur histoire, fait partie du lien qui nous rattache à la vie, aux autres du temps présent, et à ceux qui viendront.
Valeurs obsolètes voire réactionnaires et teintées de religiosité ? Peut-être du point de vue de la civilisation capitaliste matérialiste et de ces gauches qui en procèdent jusqu’à la caricature, croyant mener jusqu’au bout le « désenchantement du monde ». Mais les indigènes ne pensent pas que les morts sont morts et « qu’ils crèvent ! ». Loin d’être un rite creux et a-politique, l’hommage rendu aux morts est un rite (mais doit-on se débarrasser des rites pour être libres ?), un rite politique et spirituel – oui, spirituel ! Le Mystère ! Les indigènes sont émus quand ils pensent à leurs morts et les morts sont émus quand les indigènes pensent à eux ; tant pis pour ceux qui jugent que c’est ridicule !
Rendre hommage à ces morts, c’est perpétuer leur souvenir, c’est les continuer ; c’est transformer ces morts en acteurs des luttes actuelles qui sont le prolongement de leurs propres combats. Nul esprit de revanche. Ni « paix des braves » ni « réconciliation ». Transformer le monde. Pour s’y sentir bien, tout simplement.
La Marche du 8 mai 2005 n’a donc pas été conçue comme une simple commémoration des carnages de Sétif et Guelma. Il ne s’agissait certainement pas d’exiger une quelconque repentance de la république mais de pointer le paradoxe républicain. « 8 mai 1945. Jour de fête, jour de deuil », pouvait-on lire sur la banderole des Indigènes. Jour de fête, pour la France, libérée enfin de l’occupation nazie ; jour de deuil pour les colonisés algériens, anéantis par milliers pour avoir manifesté contre l’occupation française. Jour de deuil pour l’ensemble des colonisés. L’infâme régime de Vichy balayé, les soldats de la République retrouvent leur hargne colonialiste à Madagascar et ailleurs.
En sollicitant d’autres mouvements de lutte de l’immigration ou des mouvements engagés contre le néo-colonialisme dans leurs propres pays, les Indigènes de la république ont tenté de mettre en lien ces événements du passé et les événements du présent. Contre le mémoriel trempé dans le formol, il s’agit d’historiciser et de contextualiser le racisme spécifique dont sont victimes les personnes issues de l’immigration, pour ouvrir la voie à un futur où l’on puisse affirmer : l’indigénat n’existe plus.
p.-s.
La Marche 2008 contre la république raciste et coloniale aura lieu le 8 mai prochain à Paris, métro Barbès.
notes
[1] Daniel Bensaïd, Fragments mécréants, éditions Lignes, Paris, 2005, p.10
[2] A.Sayad, Histoire et recherche identitaire, éditions Bouchene, 2002, p.11
[3] A. Sayad, Histoire et recherche identitaire, éditions Bouchene, 2002, p.11
[4] Abedellali Hajjat, « Les enjeux de la mémoire de l’immigration en France ».
[5] Idem
[6] S.Bouamama, op.cit., p.23
[7] Abedellali Hajjat, Immigration postcoloniale et mémoire, L’Harmattan, 2005, Paris, p. 90
[8] Abedellali Hajjat, « Les enjeux de la mémoire de l’immigration en France », op.cit
Note de lecture des livres : Pour une politique de la racaille : immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues; La contre-révolution coloniale en France : de de Gaulle à Sarkozy; Nous sommes les indigènes de la République
Nous republions, avec l’aimable autorisation de l’auteure et de la revue Société Migrations, une note de lecture de nos textes par Samia Moucharik initialement paru dans le numéro 146 de la revue Migrations Société
La Rédaction
La publication à l’automne 2012 de l’ouvrage Nous sommes les indigènes de la République nous donne l’occasion de nous plonger dans les textes publiés depuis 2005, date de sa création, par le Mouvement des Indigènes de la République (MIR), devenu le Parti des Indigènes de la République (PIR) après la modification de ses statuts en 2010. L’ensemble des textes réunis dans ce recueil émane d’une organisation qui se veut une expression politique des étrangers et des Français liés à l’histoire des immigrations postcoloniales([Maghrébines, africaines, antillaises.)]. Cette expression politique se constitue à partir de la critique de la pensée élaborée par l’État français – qu’elle soit formulée ou implicite – à l’endroit de ces populations. Les deux thèses fondatrices de la pensée du MIR/PIR(Le rappel du double sigle sera utilisé lorsqu’il sera question de l’organisation depuis sa création, indépendamment de son statut. En revanche, le sigle simple correspondra à la sé-quence propre à l’organisation.) posent, d’une part, l’existence d’un racisme d’État qui irriguerait toutes ses politiques et, d’autre part, le caractère consubstantiel de ce racisme à la République, à son histoire, son idéologie, ses institutions. Le nom que les fondateurs du MIR/PIR ont choisi pour leur organisation rend compte précisément, tant par le nom “indigène” que par la référence à la “République”, de leur subjectivation politique singulière, qui se constitue clairement dans un face à face avec l’État.
La publication de ce recueil de textes – aussi bien de nature théorique que relatifs à des interventions portant sur une situation ou un débat – rappelle le nombre important d’écrits du MIR/PIR depuis sa création. C’est ainsi que le geste fondateur du MIR, qui lui a permis de faire effraction dans le champ politique français, a justement été la rédaction d’un appel, d’ailleurs repris comme titre de cet ouvrage collectif. Celui-ci reprend des textes publiés depuis 2005, entre autres, dans le journal L’Indigène de la République ou sur le site internet de l’organisation, écrits au nom du MIR/PIR ou par des membres et sympathisants en leur nom propre. Outre cet ensemble de textes, Sadri Khiari, membre fondateur, a lui-même publié deux ouvrages en 2006 et 2009, certes en son nom propre, mais qui participent également à la réflexion politique de l’organisation : il s’agit respectivement de Pour une politique de la racaille : immigré-e-s, indigènes et jeunes de banlieues et de La contre-révolution coloniale en France : de de Gaulle à Sarkozy.
S’intéresser à une organisation politique suppose préalablement de saisir la pensée qu’elle forge et qu’elle met en œuvre, et cela à partir de ses catégories et de ses énoncés. Ce pré requis s’impose davantage concernant le MIR/PIR, car l’élaboration et la systématisation d’une pensée politique constituent l’enjeu majeur, voire prioritaire, de cette organisation. L’importance numérique des textes témoigne du fait que son activité principale consiste justement à produire une pensée politique qui se déploie dans l’ensemble de ses écrits. Cette production constitue à nos yeux la spécificité de cette organisation, mais nous reviendrons sur ce point déterminant.
Une note de lecture sur ces trois ouvrages constitue justement un cadre, certes limité mais exigeant, permettant de saisir la pensée du PIR. Les deux ouvrages de Sadri Khiari – proposant une cohérence interne – ainsi que les textes théoriques publiés dans Nous sommes les indigènes de la République en constituent le matériau. Enfin, nous serons amenée au préalable à discuter des interprétations sociologiques sur le MIR/PIR formulées par d’autres chercheurs.
Les écueils évitables : le travail de lecture comme rempart à toute analyse dépolitisante
Outre l’enjeu mentionné consistant à saisir la pensée politique du PIR, notre analyse vise à entamer un travail de lecture jusqu’à présent manquant. Les écrits du PIR sont en effet tenus dans l’ombre par des chercheurs travaillant pourtant sur des questions traitées politiquement par cette organisation – les politiques étatiques concernant les “immigrés”, les “jeunes des banlieues”, les “sans-papiers”([Termes que nous plaçons entre guillemets car ils correspondent à des catégories, certes se présentant comme descriptives, mais investies par des discours de l’État.)] – ou bien encore sur les subjectivités de ceux désignés par ces catégories(Sans doute subjectivées autrement ou pas du tout par ceux-là mêmes qui sont désignés par ces catégories.) . Une telle ignorance n’apparaît pas légitime au regard tant de l’ensemble des textes publiés que de l’intérêt à porter à une subjectivation politique singulière des années 2000-2010, issue de militants se réclamant de l’immigration postcoloniale([Il ne s’agit pas de soutenir que le PIR est représentatif des subjectivités des étrangers et des Français issus des immigrations postcoloniales.)] .
L’ignorance des textes ne signifie pas que le MIR/PIR n’ait pas donné lieu à des analyses développées par des chercheurs en sciences sociales. Simplement, l’absence d’une lecture conjuguée à l’inscription des analyses dans des problématiques plus larges conduit à des interprétations qui sont entièrement sous la coupe de ces problématiques. Nous avons ainsi pu repérer des lectures réductrices, abusives, voire des contresens. Ce que nous discutons n’est nullement le fait que les chercheurs, abordant cette organisation politique à partir de leurs problématiques, puissent aboutir à leurs propres conclusions, disjointes de l’intellectualité du MIR/PIR, mais en revanche, il nous semble discutable que leurs conclusions n’aient pas donné lieu à une confrontation avec les catégories et les énoncés du PIR, ce qui aurait supposé leur analyse préalable(C’est le cas des interprétations données par Emmanuel Jovelin ou par Romain Bertrand. Voir JOVELIN, Emmanuel, “Ambiguïtés de l’antiracisme. Retour sur quelques associations mili-tantes”, Le Sociographe, n° 34, janvier 2011, pp. 25-35 ; BERTRAND, Romain, Mémoires d’empire : la controverse autour du “fait colonial”, Bellecombe-en-Bauges : Éd. du Croquant, 2006, 221 p., et plus précisément “Les ‘collectifs mémoriels’. La définition inachevée des identités victimaires”, pp. 147-166. En opposition avec ce que soutient le MIR/PIR sur lui-même, Emmanuel Jovelin qualifie cette organisation de « groupe ethnique », alors que Romain Bertrand la réduit à un « collectif mémoriel ».) . À notre sens, ces analyses renseignent bien plus sur les projections des chercheurs que sur la pensée du MIR/PIR elle-même.
Cette absence de lecture témoigne, certes, de peu de rigueur intellectuelle, mais elle manifeste surtout une approche des organisations politiques généralement admise, qui consiste à minorer, voire à négliger leur pensée politique. Dans le cas précis du MIR/PIR, cette approche dépolitisante prend deux formes : une approche sociologique centrée sur les militants et une focalisation exclusive sur la rhétorique, toutes deux présentes dans un article d’Abdellali Hajjat(Cf. HAJJAT, Abdellali, “Révolte des quartiers populaires, crise du militantisme et post-colonialisme”, in : BOUBEKER, Ahmed ; HAJJAT, Abdellali (sous la direction de), Histoire poli-tique des immigrations (post)coloniales en France, 1920-2008, Paris : Éd. Amsterdam, 2008, pp. 249-264. A. Hajjat s’interroge sur les facteurs politiques et sociaux ayant empêché la structuration d’un espace politique dans les quartiers populaires à la suite des révoltes de 2005.) . Du point de vue de celui-ci, l’émergence du MIR s’opère alors que l’organisation ne dispose d’aucun ancrage dans les quartiers populaires et que la construction de sa légitimité relève principalement de logiques médiatiques. Ainsi, si A. Hajjat note que les activités publiques du MIR sont essentiellement la production d’écrits et de discours, il ne les considère pas pour eux-mêmes comme point de départ d’une analyse de leurs propositions. L’auteur évacue les textes en les considérant comme le résultat de la conversion d’un fort capital scolaire et culturel([Ainsi qu’un sentiment de déclassement.)] de la part de militants, appréhendés comme des “entrepreneurs”.
Il ne s’agit pas pour nous d’invalider une telle approche sociologique, mais de la critiquer si elle se présente, comme c’est le cas en l’occurrence, de manière exclusive, donc se passant d’un travail de lecture de ces textes. Cette approche sociologisante centrée sur les militants fondateurs s’accompagne de la focalisation sur la dimension rhétorique de leurs productions intellectuelles et politiques. Considérant la seule existence de discours, A. Hajjat interprète les termes “indigène”, “continuum colonial”, “champ politique blanc” comme relevant de la nécessité de faire « preuve d’innovation discursive pour “se maintenir dans la radicalité”, en inventant des néologismes (…) et de nouveaux slogans(HAJJAT, Abdellali, “Révolte des quartiers populaires, crise du militantisme et post-colonialisme”, art. cité, p. 258.)» . La production de discours et ce qu’il identifie comme une surenchère lexicale ne se comprennent que dans la visée de “militants entrepreneurs” cherchant à se distinguer dans le champ politique en exploitant leurs ressources et compétences. La présence et l’importance de la dimension rhétorique dans les textes du MIR/PIR ne peuvent certes être négligées ; en revanche, sont contestables aussi bien la focalisation sur le seul discours qu’opère A. Hajjat que son interprétation quant au rôle que ce discours revêtirait pour l’organisation, à savoir se distinguer dans le champ politique. Une lecture des textes suffirait pour comprendre qu’“indigène” ne se résume pas à une “invention rhétorique”, mais à un statut de catégorie relevant d’une pensée, de même qu’elle permettrait de saisir le rôle du discours chez le MIR/PIR.
La production d’une rhétorique politique a sa propre logique : pour le PIR, il s’agit de la volonté manifeste de se présenter insolent, provocateur. Pour ce faire, la rhétorique repose sur un vocabulaire et un ton adéquats. L’insolence revendiquée par le PIR et soulignée par ses commentateurs trouve sa raison d’être tout d’abord dans la volonté de déroger à la politesse et à la réserve attendues des étrangers([Évoquée par Abdelmalek Sayad.)]. Elle se présente surtout en cohérence avec la pensée élaborée par le PIR, qui se veut en rupture avec la pensée et les catégories d’État([Il ne s’agit pas de nier le lien qu’elle entretient avec les idées, mais dans le cadre de cette note de lecture, son étude n’est pas nécessaire. Sans compter le fait qu’elle exige des méthodes et des outils spécifiques.)] . De ce fait, un nouveau vocabulaire est mis en circulation, qui peut paraître alors provocateur. De plus, il faut reconnaître, que du fait de la double dimension des mots – supports d’une pensée et d’une rhétorique -la rhétorique inventée par le MIR/PIR constitue un écran empêchant d’identifier des idées, l’exemple le plus frappant étant celui du mot “indigène” comportant indéniablement une charge de provocation ; or, sous peine de contre-sens et d’oblitérer son statut de catégorie, il doit également être analysé. Seule une lecture prêtant attention aux mots, aux énoncés et dépourvue d’a priori quant au sens des mots autorise ce travail. Il ne suffit pas de constater – le plus souvent pour le juger – le réinvestissement d’une catégorie historique et d’y voir une charge provocatrice. Ce qui nous semble le plus intéressant – et le plus rigoureux – est de saisir sa profondeur intellectuelle et politique, qui ne peut être exhumée que par une analyse “en intériorité” supposant de saisir le sens des catégories en les mettant en rapport les unes avec les autres. C’est ce que nous proposons ici, en nous intéressant aux catégories “Indigène”, “Blanc” et “postcolonialisme”.
Quelques caractéristiques sur l’écriture
Au préalable, nous aimerions rendre compte de quelques caractéristiques des textes théoriques réunis dans Nous sommes les indigènes de la République du PIR, ainsi que des ouvrages Pour une politique de la racaille et La contre-révolution coloniale en France de Sadri Khiari, caractéristiques qui tiennent à leur nature politique. Ces remarques concernent davantage l’écriture. Si elles n’épuisent pas la présentation des textes, elles en donnent néanmoins un aperçu.
Tout d’abord, coexistent une profondeur réflexive et la dimension rhétorique déjà soulignée. À notre avis, cette coexistence rend d’ailleurs la lecture parfois jubilatoire, en tout cas stimulante. Ainsi, tout en ayant le souci d’exposer clairement une pensée et des points de vue, le ton se présente libre, véhément, ironique, l’humour étant extrêmement présent.
Une autre caractéristique : de très nombreux textes, singulièrement ceux de S. Khiari, rendent compte de multiples et hétéroclites lectures effectuées au service des réflexions sur des situations ou des questions politiques. Nous lisons ainsi des auteurs qui ont beaucoup lu(Ce qui est frappant est précisément le reproche d’intellectualisme utilisé à l’endroit des mi-litants comme argument de disqualification politique. Comme si faire de la politique ne né-cessitait pas de produire de la pensée.). Les analyses politiques s’appuient sur de très nombreuses références universitaires, historiques ou sociologiques([Le sociologue de référence étant Abdelmalek Sayad.)]. Quant à la “bibliothèque politique”, elle est constituée d’ouvrages, parmi d’autres, de Frantz Fanon, d’Aimé Césaire, de James Baldwin ou de Malcolm X(Contre la lecture réductrice d’un plaquage d’une situation sur une autre et d’une réimportation infondée de concepts afro-américains, voir KHIARI, Sadri, Malcolm X : stratège de la dignité noire, Paris : Éd. Amsterdam, 2013, 128 p.) .
L’écriture de ces textes est pensée par l’organisation comme un enjeu à lui tout seul. Les textes théoriques constituent en effet le lieu d’élaboration des réflexions et des stratégies politiques. Outre la théorisation, il s’agit également de constituer au présent une mémoire écrite des luttes ainsi que de leurs bilans et critiques, conçue au service des générations futures. La mémoire des luttes politiques de l’immigration est un enjeu d’autant plus crucial qu’elle fait défaut lorsque le MIR/PIR entend s’appuyer sur l’analyse d’organisations et d’expériences passées comme le Mouvement des travailleurs arabes (MTA), le Mouvement pour l’égalité et contre le racisme de 1983 ou le Mouvement immigration banlieues (MIB).
Une autre caractéristique de l’écriture tient au fait que les auteurs ne cessent depuis le premier texte écrit à la suite de l’appel de 2005 d’intégrer dans leurs analyses les réponses aux contradictions et critiques que les textes ou les déclarations de l’organisation ont suscité et continuent de susciter. Ainsi, la pensée du MIR/PIR ne cesse de s’affiner de façon argumentée au fil des textes(Ce dont la lecture de l’ouvrage collectif permet de rendre compte puisque les textes re-groupés couvrent la période 2005-2012.).
Du fait de ce dialogue avec leurs contradicteurs, mais pas seulement, les textes portent en eux les marques de l’adresse. En l’occurrence, le MIR/PIR s’adresse à un certain nombre d’interlocuteurs. Les contradictions qui leur sont apportées proviennent d’organisations militantes, elles-mêmes engagées contre le racisme. Il s’agit ici d’une première interlocution, directe dira-t-on. Le MIR/PIR engage également, en particulier, une interlocution avec le monde de la recherche, les chercheurs travaillant à partir de problématiques relevant du post-colonialisme. Une troisième interlocution nous semble la plus déterminante : celle avec l’État, du moins avec la « pensée d’État(Au sens où elle est définie par Abdelmalek Sayad dans “Immigration et ‘pensée d’État’”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 129, septembre 1999, pp. 5-14.) ». Or distinguer les différentes interlocutions permet d’affiner l’analyse des catégories utilisées.
La pensée du Parti des Indigènes de la République appréhendée à partir de quelques catégories
Nous proposons donc d’éclairer et d’analyser séparément quelques catégories, et cela pour des raisons de clarté de l’exposé. Mais ces catégories entretiennent entre elles des liens logiques, voire insécables, puisqu’elles participent de la systématisation d’une pensée cohérente.
• La catégorie “Indigène”
Toute pensée politique contemporaine se voulant être un appui pour un projet d’émancipation doit produire une réflexion sur la ou les catégorie(s) permettant de construire la subjectivation politique de ceux qui sont concernés par ce projet. Le MIR/PIR formule une réflexion qui nous apparaît poussée et stimulante quant aux catégories permettant de se désigner et donc d’identifier son point de vue, sa place dans un pays, son rapport au monde, ce qui est véritablement un premier problème politique.
De ce point de vue, sans pouvoir les résoudre définitivement, la catégorie “Indigène” permet de réunir en son sein des contradictions inévitables : se penser dans une autonomie intellectuelle et politique à l’égard de l’État et de ses catégories, tout en n’occultant pas la spécificité de la domination combattue. Ainsi la catégorie “Indigène” trouve-t-elle une première raison d’être dans la nécessité de subjectiver la politique de l’État à l’endroit des étrangers et des Français liés à l’histoire des immigrations postcoloniales. La requalification politique d’un concept juridique et historique hérité du colonialisme permet justement de spécifier le racisme d’État, enraciné dans la République et sa politique coloniale. En même temps qu’elle permet de qualifier la politique de l’État, la catégorie “Indigène” assure la fonction de dévoilement de cette politique qui ne se formule pas comme telle. Cette catégorie permet de qualifier « le statut de ceux qui ne sont pas considérés officiellement et réellement ni nationaux (avec les droits qui en découlent) ni étrangers([BOUTELDJA, Houria ; KHIARI, Sadri (sous la direction de), Nous sommes les indigènes de la République, op. cit., p. 83.)] » . Loin d’être une autodésignation reposant sur un retournement d’un stigmate([Avec les risques de voir confortée la stigmatisation ou de basculer dans une essentialisation du statut de victime.)], sa mise au jour témoigne d’une distanciation par rapport à l’État, puisque ce mot n’appartient ni au champ politique ni même à celui des sciences sociales. Le réinvestissement de la catégorie “Indigène” rend compte de la subjectivation singulière effectuée par le MIR, déprise du vocabulaire admis.
Outre la fonction de dévoilement, cette catégorie permet également d’en subvertir d’autres qui, elles, circulent aussi bien dans le champ politique que dans le champ universitaire. La catégorie “Indigène” oblige en effet à réfléchir à l’usage de catégories qui se présentent comme descriptives mais qui sont en fait politiques. Elle se pose contre les catégories “travailleurs immigrés”, “Français issus de l’immigration”, “jeunes des banlieues”, qui sont « autant de catégories qui nous fractionnent et, surtout, expriment notre extériorité par rapport à la société française où nous vivons » . Ces catégories sont également considérées par le MIR/PIR comme relevant d’une problématisation classiste, minorant ou ignorant la dimension raciale de la domination combattue. Précisément, la catégorie “Indigène” permet de rappeler la dimension racialisante de la stigmatisation. De plus, elle entend s’opposer aux divisions portées par l’ensemble des catégories citées afin de construire une identification politique qui ne repose nullement sur une identité en tant que telle, mais sur un rapport social et politique produit par la politique de l’État. Ce rapport qualifié d’“indigénat” se caractérise par « l’exclusion en dehors de la nation. Pas seulement de la citoyenneté, mais de la nation. La nation qui est au fondement de la République est à la fois politique et ethnico-raciale([Ibidem, p. 244.)] » . Enfin, la catégorie “Indigène” affirme également le refus de l’injonction républicaine à l’assimilation, incarnée par la figure du “citoyen”, l’envers de l’“indigène”. Pour cela, cette catégorie rappelle, comme les catégories “Arabe”, “Noir” ou “musulman”, que si elles sont imposées, réductrices, stigmatisantes, elles sont également porteuses de ce que le MIR/PIR nomme la “dignité”, à savoir le refus de voir sa culture, son histoire dévalorisées, minorées, voire attaquées au nom d’une conception nationale-raciale qui ne dit pas son nom.
La catégorie “Indigène” qualifie donc à la fois la politique de l’État et les subjectivités de ceux qui justement refusent ce statut.
• La catégorie “Blanc”
La catégorie “Blanc” a suscité autant, si ce n’est davantage, de réactions, de critiques et, en retour, de justifications dans les textes. Cette charge s’explique sans doute par le fait que cette catégorie ne permet pas seulement de qualifier la politique de l’État, mais désigne la société française et les organisations politiques y compris de “gauche”.
Pas plus que la catégorie “Indigène”, la catégorie “Blanc” n’est pensée comme une identité. Sadri Khiari reconnaît la pertinence de s’interroger sur ce terme et sur les risques d’ethnicisme. « Parler de Blancs, ce n’est pas essentialiser le Blanc en tant que blanc (…). Le Blanc est un rapport social et non un fait naturel. Il n’existe en tant que tel que comme moment d’un rapport social d’oppression et de lutte contre cette oppression([KHIARI, Sadri, Pour une politique de la racaille, op. cit., p. 90.)] » . À ce titre, il apparaît en totale homogénéité avec les catégories “Noir” ou “Arabe”, désignant un rapport politique. « C’est bien en tant qu’Arabes, que Noirs ou que musulmans que les populations issues des anciennes colonies sont discriminées et stigmatisées. Ce qu’il y a en face (…) tend à être appréhendé dans un vocabulaire ethniciste »([Ibidem.)] . Cette catégorie témoigne de la subversion des catégories admises, puisque le MIR/PIR impose une catégorie qui reflète le point de vue des “Indigènes”.
La catégorie “Blanc”, plus précisément la catégorie “pouvoir blanc”, permet de qualifier la politique de l’État, aussi bien celle qu’il exerce dans le pays que dans le reste du monde et dans ses rapports avec les anciennes puissances coloniales et les anciennes colonies(Cf. KHIARI, Sadri, La contre-révolution coloniale en France, op. cit.) . Elle permet aussi au MIR/PIR d’intégrer la société française et les organisations politiques “de gauche” dans ses ana-lyses. Ainsi, la catégorie “Blanc” désigne le fait de faire « partie intégrante du monde blanc et être reconnu comme tel ; c’est jouir de privilèges statutaires garantis par l’État »([Ibidem, p. 91.)] .
Cette catégorie permet également de penser le rapport avec les organisations politiques luttant contre le racisme, qui relèvent de ce qui est nommé “champ politique blanc”. Celui-ci, selon le MIR/PIR, problématise le racisme de manière sociale, ce dont témoignent les catégories “travailleur immigré” et “sans-papiers”. Il peut être alors conçu comme des résidus du racisme colonial ou abordé en des termes moraux. Le MIR/PIR s’oppose à ce racisme dit “consensuel” qui est homogène à la conception dite universelle de la citoyenneté défendue par l’État([Pour lire une théorisation du rapport avec le “champ politique blanc”, nous renvoyons particulièrement à KHIARI, Sadri, Pour une politique de la racaille, op. cit.)] . Il nous semble que cette catégorie permet également de penser l’existence d’une homogénéité subjective entre l’État et les organisations politiques relevant de l’espace parlementaire, y compris de la part de celles qui cherchent à s’en distancier au maximum.
La catégorie “Blanc” permet donc de penser les rapports avec l’État, mais également avec la société et le champ politique.
• La catégorie “postcolonialisme”
Sans doute qu’à la différence des deux catégories précédentes, celle de “postcolonialisme” est moins critiquée, peut-être même est-elle consensuelle aujourd’hui.
Pour le MIR/PIR, elle permet de qualifier le contexte politique à l’échelle nationale et mondiale, qui se caractérise par une « contre-révolution coloniale à l’échelle internationale », une « offensive raciale, dite républicaine et laïque » à l’échelle française, une « extension et radicalisation des résistances des populations indigénisées »([BOUTELDJA, Houria ; KHIARI, Sadri (sous la direction de), Nous sommes les indigènes de la République, op. cit., p. 13.)] . La catégorie “postcolonialisme” permet de qualifier l’État et sa politique, qui puise donc dans l’histoire du colonialisme, tout en présentant des ruptures. La domination raciale puise ses origines et son intellectualité dans le racisme colonial en le réactualisant. La thèse du MIR/PIR est que le racisme d’État ne relève pas de résidus de racisme qui se nicheraient dans l’imaginaire et les représentations collectives. Des rapports coloniaux persistent dans la pensée au sein même de l’État et également de la société française. De ce fait, la catégorie “Indigène” prend toute sa raison d’être en lieu et place de catégories ne rendant pas compte de la nature de ce racisme. La catégorie “postcolonialisme” permet également de revendiquer une filiation avec l’histoire des luttes anticoloniales(Même si, comme le note Sadri Khiari, les références en vue de nourrir les réflexions théo-riques et stratégiques sont souvent en lien avec les luttes des Afro-Américains.).
Évoquer un « ordre postcolonial », c’est désigner un système de « ségrégation », de « hiérarchisation », d’« oppression » à la fois sociales, politiques et culturelles.
Son analyse pourrait être encore poursuivie en évoquant l’interlocution menée par le MIR/PIR avec les chercheurs ayant adopté des problématiques dites “postcoloniales”.
Notre conclusion servira à suggérer des pistes de lecture et des questionnements qui n’ont pas été soulevés dans la présente note, qui se veut une invitation à poursuivre le travail par une analyse plus approfondie des catégories traitées ici et à l’étendre à d’autres catégories comme celles de “dignité” et d’“autonomie”(La catégorie “pouvoir” est traitée par Matthieu Renault sur le site de Contretemps, http://www.contretemps.eu/auteurs/matthieu-renault). Nous considérons que cette dernière est essentielle et qu’elle ne doit pas être entendue comme une simple autonomie à l’égard des autres organisations politiques([nière est essentielle et qu’elle ne doit pas être entendue comme une simple autonomie à l’égard des autres organisations politiques)].
L’ensemble des textes publiés par le MIR/PIR pourrait donner lieu à une lecture diachronique révélant les évolutions d’une pensée en train de se constituer depuis 2005. Il serait aussi possible d’analyser les prises de position sur des débats ou des situations précises, qu’ils concernent la politique française ou la politique internationale. Ce sont des pistes parmi d’autres qui révèlent la richesse du matériau.
Faire ce travail sans faire la grossière erreur de postuler que le PIR est représentatif des subjectivités des étrangers et des Français liés par la même histoire permettrait de ne plus circonscrire le rapport à la politique de ces derniers de manière normée et consubstantielle à l’espace politique parlementaire. Ainsi, en vue de saisir les subjectivités politiques des “immigrés” et de leurs descendants, les études sur le rapport au vote, aux partis politiques, aux discours sont souvent privilégiées. Lorsque les recherches portent sur les engagements politiques, elles se limitent dans la plupart des cas à l’étude des militants ou des élus(À titre d’exemple, “Représentants et représentés : élus de la diversité et minorités visibles” (dossier), Revue Française de Science Politique, vol. 60, n° 4, 2010, pp. 655-768.). À notre connaissance, très peu d’investigations sont menées sur les subjectivités, à distance des dispositifs électoraux, ne réduisant pas les subjectivités politiques à des réactions aux discours et aux politiques menées par les partis politiques. Or, le PIR propose une problématisation singulière de la politique de l’État français à l’endroit des “immigrés” et de leurs descendants, en même temps qu’une énonciation subjective construisant un “nous” politique – et non identitaire – inédit. Et à ce titre, elle ne peut être éludée.
Samia MOUCHARIK
Doctorante en anthropologie
Université Paris 8