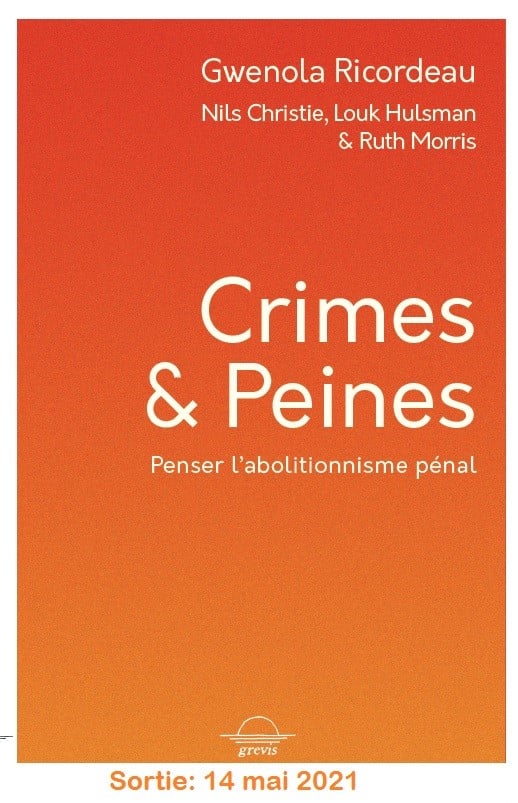Crimes & Peines – Penser l’abolitionnisme pénal
Gwenola Ricordeau
Lorsque l’on parle de crime, de prison, de police, de leur abolition, on se place le plus souvent sur le plan de l’argumentation, de la démonstration, de la raison. Il s’agit de convaincre, de prouver que ces institutions sont absurdes, mauvaises voire contre-productives. Le texte de Gwenola Ricordeau que nous publions cette semaine propose un pas d’écart. Il part de l’expérience, du viscéral, il parle de ce que la prison et la police nous font sensiblement. Il introduit « Crimes et Peines. Penser l’abolitionnisme », un livre autour de trois textes « classiques » de la pensée abolitionniste (Nils Christie, Ruth Morris et Louk Hulsman) qui sont traduits pour la première fois en français (par Pauline Picot et Lydia Amarouche). Le livre, publié par les éditions Grevis, sort en librairie le 14 mai.
Pour le petit bout de soi qui s’en va lorsque des policiers viennent t’arracher à tes proches, à tes amours, à ta vie. Lorsqu’un juge t’enlève ton fils, ta sœur, ton père ou ton amante. Lorsque tu essaies de serrer contre toi un être cher à travers des grilles.
Pour le petit bout de soi qui s’en va lorsqu’il te faut être convaincante et même « crédible », alors que tu voudrais seulement qu’on t’écoute et qu’on te croie. Lorsqu’ils ne prennent même pas la peine d’essayer de comprendre. Lorsque c’est ton histoire, mais qu’on te reproche d’en faire « toute une histoire ».
Pour le petit bout de soi qui s’en va lorsqu’ils mettent ton nom ou celui d’un autre sur un dossier et que ton histoire n’est déjà plus vraiment la tienne, ou la nôtre. Lorsqu’ils font de toi ou de nous leur « affaire » — une petite affaire de rien du tout, ou une belle affaire.
Pour le petit bout de soi qui s’en va lorsque, entre les murs de leurs tribunaux, ils dissèquent nos existences à coups de scalpel. Lorsque leurs procureurs nous parlent en hommes et que leurs juges prennent à témoin la société comme si celle-ci n’avait pas déjà prononcé sa sentence. Lorsque c’est la plus grande des solitudes sur le ban des accusés, et la grande ronde de ceux réunis là pour nous passer à la moulinette.
Pour le petit bout de soi qui s’en va pendant qu’ils défilent à la barre, ceux qu’on a conviés au festin de nos entrailles, ceux qui sont payés pour nous examiner sous toutes les coutures et pour donner leur avis sur notre âme et sur nos faits. Pendant que les témoins de moralité font ce qu’ils peuvent et que le public chuchote et se repaît du spectacle.
Pour le petit bout de soi qui s’en va lorsque rien ne sera plus comme avant et qu’on sait que cela recommencera de nouveau — que cela est en train d’arriver à l’instant précis où on y pense. Que rien ne sera plus comme avant parce qu’il est des balises de détresse que personne ne veut voir, mais qu’il restera la colère comme bouée de sauvetage et la peur avec laquelle il faudra apprendre à vivre.
Pour le petit bout de soi qui s’en est allé malgré la tendresse qui nous relie en retour à la sœur, à l’amie, à l’inconnue — à elles toutes qui savent la colère et la peur. La tendresse qui nous relie aussi à toutes celles et à tous ceux qui connaissent le tranchant de leurs scalpels.
Parce qu’il y a le souvenir de tous ces petits bouts de soi qui s’en sont allés, ce trop-plein de souvenirs, et ces vides à jamais. Les blessures encore ouvertes, la justice jamais vraiment rendue, les promesses faites que c’était pour notre bien. Parce que les parloirs, ce n’est pas une vie. Parce que les grilles se referment sur les innocents et sur les coupables. Parce que les morts des mitards et des quartiers d’isolement.
Pour nos vies en morceaux. Pour nos morceaux de vie dont ils font leur affaire. Pour leurs séances de dissection. Pour les peines qu’ils prononcent sans remords.
Parce que les flics blessent, mutilent et tuent. Parce que les procureurs n’ont jamais à la bouche que le droit et les juges qu’un code pénal à la place du cœur. Parce qu’on ne demande aux jurés rien de plus que leur intime conviction quand on nous demande rien de moins que d’étaler nos tripes devant eux. Parce que les matons nous regardent nous aimer et nous déchirer au parloir. Et qu’ensuite il y a toujours quelques travailleurs sociaux et des bénévoles pour venir, la main sur le cœur, se rassasier de l’histoire de nos malheurs.
Parce que c’est la justice des hommes, des bons pères de famille, de ceux qui sont dans leur droit et qui, s’ils n’ont pas déjà tous les droits, nous disent quand même sans frémir leur « vérité judiciaire ». Parce que c’est la justice de ceux pour qui les lois ont été écrites, de ceux que la police protège et qui savent que la prison est faite pour les autres.
Parce qu’ils se servent de nos blessures et de nos corps comme d’un étendard, là-bas pour leurs guerres et leur mission de civilisation, ici pour designer et punir leurs monstres, leurs pauvres, leurs arabes, leurs noirs. Parce qu’ils nous reprochaient de parler, et qu’aujourd’hui ils nous reprochent encore de nous taire ou de ne pas parler comme il le faudrait. Puisque, lorsqu’ils rendent justice, c’est un dossier qu’ils referment. C’est comme le mot « fin » prononcé après une histoire un peu triste. Un œil pour un œil, sa peine pour ma peine. Parce que leur justice, c’est leur lot de consolation pour notre impuissance organisée. Parce que notre camp, c’est celui des victimes, de celles qui parlent et de celles qui ne disent rien.
Parce que la prison, ça peut arriver à n’importe qui, mais que c’est toujours les mêmes qui y vont. Ceux qu’hier on envoyait au bagne et pour qui on élevait des potences et pour qui aujourd’hui on bâtit des prisons, des centres de détention et des camps. Parce qu’on nous demande de croire encore en la justice de notre pays, et peut-être même de lui être reconnaissante. Parce qu’ils s’octroient un supplément d’âme à chaque fois qu’ils nous font la charité ou qu’ils parlent de réinsertion. Comme si dans leur société, on pouvait s’arranger pour qu’il y ait de la place au soleil pour tout le monde. Parce que notre camp, c’est celui du peuple qui croupit à l’ombre en attendant les lundis au soleil, c’est le camp de ceux et celles qui grandissent et vivent à l’ombre des murs.
Puisque leur soif de pouvoir et d’argent ont fait du monde notre cauchemar et qu’ils n’aspirent qu’à recouvrir la terre de prisons. Parce que nous ne voulons pas de leur lot de consolation, parce qu’il n’y aura pas d’arrangements. Ni avec leur justice, ni avec leur charité. Ni avec leurs policiers, leurs juges et leurs matons. Parce que notre camp, c’est celui des empêcheurs de condamner-en-rond et d’enfermer-en-paix, c’est celui de ceux et celles qui rêvent un monde sans commissariats, ni tribunaux, ni prisons.
Prendre le parti de notre camp, c’est ouvrir des brèches dans leurs murs et construire des solidarités, avec ceux et celles qui luttent, dedans et dehors, et avec ceux et celles qui n’ont parfois plus la force de se battre. Prendre le parti de notre camp, c’est tenir tête à leurs chimères d’une police qui nous protègerait et d’une justice qui pourrait être juste. Prendre le parti de notre camp, c’est refuser qu’on punisse au nom de notre émancipation. Parce que ni le racisme, ni le capitalisme, ni le patriarcat n’ont jamais tremblé devant leurs tribunaux et leurs prisons. Prendre le parti de notre camp, c’est faire front avec ceux et celles qui attaquent. Parce que les murs ne tomberont pas tous seuls et qu’il faut souffler sur la braise pour que l’incendie se propage.
Prendre le parti de notre camp, c’est s’engager sur le chemin de l’abolition de leurs prisons et de leur justice. Un chemin dont la destination est encore incertaine. Parce qu’on ne sait pas encore bien à quoi ressemblera le monde sans police, ni tribunaux, ni prisons qu’il nous reste à construire. Mais c’est un chemin sur lequel on avance à coups de rêves et il nous faut rêver fort pour avancer encore. C’est un chemin que l’on prend avec pour seule boussole que de savoir que nous ne voulons « la prison pour personne » et avec pour seuls bagages nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs. C’est un chemin escarpé, mais on met ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous y ont précédé et qui ont laissé sur le bord du chemin quelques pierres qui témoignent de leur passage et qui nous rappellent qu’on ne va jamais loin si on fait seuls le chemin. C’est un chemin escarpé, mais il résonne de ce qu’on s’y raconte. On y dit nos blessures, nos deuils, nos guérisons et nos bricolages pour vivre, aimer et rire malgré tout.
Sur le chemin de l’abolition, nous parvient le brouhaha des sarcasmes de ceux qui croient qu’il en a toujours été ainsi, de ceux qui espèrent qu’il en sera toujours ainsi car ils ont encore quelque chose à gagner ou à sauver et de ceux qui nous accusent de naïveté, alors qu’ils trouvent si pratique de faire comme s’il n’y avait toujours que des victimes et que des coupables. Le brouhaha que font aussi ceux qui moquent nos rêves alors que les leurs sont remplis de prisons et de miradors, de nos gestes épluchés par des caméras de surveillance et de nos chevilles et nos poignets entourés de bracelets électroniques.
Sur le chemin de l’abolition, on avance remplies par nos doutes, nos peurs, nos colères et nos espoirs. Hantées par le souvenir du froid des grilles, de nos défaites, de nos entrailles hurlantes sous leurs scalpels, et par le sentiment que l’histoire marche parfois contre nous. Habitées par le vide laissé par celles et ceux qui nous ont laissé continuer seules le chemin, mais habitées aussi par la chaleur de nos rêves et les brûlures laissées par l’espérance.
Car un soir viendra où on dansera sur les cendres de leurs commissariats, de leurs tribunaux et de leurs prisons.
Et puis arrivera enfin le jour où on visitera les ruines de leur monde en frissonnant tristement à la pensée des temps anciens. Au milieu des tournesols qui auront poussé dans les anciennes cours de promenade. Dans la poussière qui aura recouvert leurs registres, leurs menottes et leurs clés. On honorera ceux et celles qui ont souffert entre les murs de leurs prisons et le courage de ceux et celles qui les ont fait tomber. On s’y recueillera et on se souviendra de nos malheurs et de nos larmes, mais aussi de nos bonheurs volés à tous les enfermeurs.
Gwenola Ricordeau est professeure de criminologie à l’université d’État de Californie (Chico). Elle travaille notamment sur l’abolitionnisme pénal et la prison.