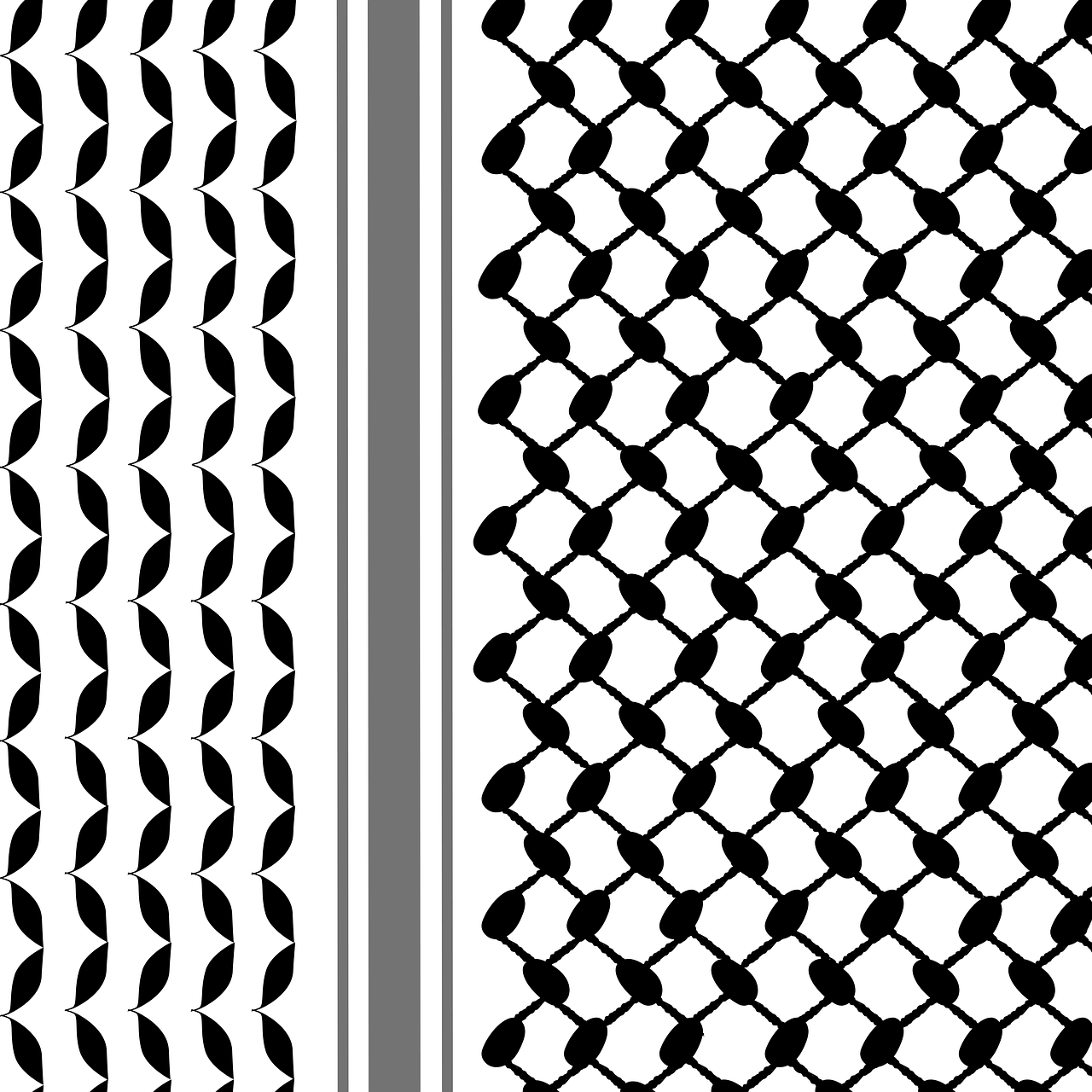Dans son ouvrage Une cause sacrée. Religion, décolonisation et mobilisations pour la paix en Israël-Palestine (éd. Karthala), Caterina Bandini analyse des mouvements peu connus qui, à partir d’une approche religieuse, défendent une perspective de « paix » en Palestine. Dans cet entretien, on cherche à comprendre ces approches, aussi bien leurs logiques que leurs angles-morts.
Caterina Bandini est chercheuse en sociologie, et membre de la rédaction du site Yaani, qui développe des recherches sur les contextes israélo-palestiniens, les rapports coloniaux qui les structurent et les oppressions systémiques des Palestinien·nes. Ses travaux portent sur l’engagement militant et les mouvements sociaux, sur le militantisme religieux et sur les rapports coloniaux en Palestine.


Contretemps – Ton livre évoque les mobilisations religieuses en faveur de la paix en Palestine-Israël. Tu as enquêté pendant plusieurs années aussi bien dans les territoires occupés qu’en Israël pour mettre à jour une réalité peu connue. Peux-tu pour commencer préciser de quels groupes et quels militants tu parles ? Et comment ces groupes s’inscrivent dans une histoire politique du conflit ?
Caterina Bandini – Il me faut d’abord préciser qu’il s’agit d’un espace de mobilisation très hétérogène, composé de groupes et d’individus aux positionnements politiques différents, parfois opposés. L’idée même de « paix », que je reprends comme une catégorie émique, mise en avant par mes enquêtées elles et eux-mêmes, recouvre en réalité des engagements et des visions du futur plurielles, ambivalentes, voire paradoxales.
Néanmoins, ma thèse consiste à dire que ces groupes et individus sont reliés par une démarche commune : considérer que si « la religion » fait partie du conflit – tout en n’étant pas sa cause principale -, elle doit aussi faire partie de la solution. Il s’agit là d’une conception située de l’histoire du conflit et des possibles solutions : c’est le produit du travail militant d’intellectuels, d’activistes et de théologiens au sein de cet univers de sens partagé que je nomme l’espace des organisations religieuses pour la paix.
J’ai enquêté au sein de trois milieux distincts : le mouvement de théologie de la libération palestinienne, portée par des Palestiniens chrétiens depuis la première Intifada (1987-1993) et notamment par l’ONG Sabeel ; les organisations religieuses juives de défenses des droits humains, dont la plus importante, Rabbis for Human Rights, a été fondée à la même période ; et les groupes de dialogue interreligieux qui ont vu le jour dans le contexte des accords d’Oslo (1993-1995), mais avec un gros focus sur les groupes formés par des colons juifs et des Palestiniens en Cisjordanie occupée qui sont, eux, beaucoup plus récents – la plus importante organisation dans ce milieu, Roots, a été fondée en 2014.
Ces groupes s’inscrivent dans l’histoire politique du conflit en ceci qu’ils cherchent à défendre des interprétations alternatives et contextuelles des textes de la tradition pour promouvoir leurs visions de paix, de justice et de non-violence face à ce qu’ils perçoivent comme leurs adversaires au sein de leur propre communauté religieuse : le sionisme chrétien pour les Palestiniens chrétiens ; la droite sioniste religieuse pour les Juifs non orthodoxes qui militent contre l’occupation ; les colons opposés à toute forme de partage de la terre avec les Palestiniens, pour les colons engagés dans le dialogue interreligieux.
Puisque ces groupes et militants sont ancrés dans la situation coloniale que connaissent les populations palestiniennes et israéliennes depuis les débuts de l’entreprise sioniste en Palestine, ils n’échappent nullement à l’asymétrie propre à tout contexte colonial. Palestiniens et Israéliens ne se trouvent jamais dans une position d’égalité, même s’ils évoluent au sein d’un même espace de discours et de pratiques ou qu’ils se mobilisent ensemble.s.
Contretemps – Tu évoques des organisations pour la paix fondées par des colons en Cisjordanie. Cela est très surprenant vu de France (et sans doute d’ailleurs), car cela semble relier deux termes a priori peu conciliables : « colons » et « paix ». Peux-tu nous en dire plus ? N’y a-t-il pas une ambiguïté intrinsèque au mot de paix, dès lors qu’il ne s’articule pas avec la justice et donc la décolonisation ? Autrement dit, a-t-on à faire aux mêmes apories qu’avec le camp de la paix qui s’est forgé dans les années 1980 ?
Caterina Bandini – Absolument. Cette ambiguïté traverse l’ensemble de l’espace enquêté, mais a fortiori les groupes formés par des colons en Cisjordanie occupée. Or ce qui est intéressant, c’est qu’elle ne touche pas seulement le mot « paix », mais le mot « décolonisation » aussi, auquel ces colons se réfèrent parfois. Ce que je montre dans le livre, c’est que ces catégories sont en réalité très ambivalentes et qu’en l’occurrence, cette ambivalence est rendue possible par l’usage d’un langage religieux par essence « plastique », capable de porter des messages politiques extrêmement différents.
On voit par exemple que la manière dont les colons que j’ai étudiés mobilisent la théorie postcoloniale s’apparente à une forme de redwashing : en entrant en dialogue avec des Palestiniens, en prônant la reconnaissance mutuelle et l’attachement des deux peuples, juif et palestinien, à l’ensemble du territoire de la Palestine historique, ils cherchent à s’auto-indigéniser, à acquérir une forme de légitimité par rapport à la terre.
En même temps, ils le font avec des discours et des pratiques diamétralement opposées par rapport à celles de la très grande majorité de la société des colonies qui prône la ségrégation, la violence politique, le nettoyage ethnique pur et simple. Et à la différence de ce qu’on a pu appeler le « camp de la paix » israélien des années 1980, ces colons rejettent le paradigme de la séparation imposé par les accords d’Oslo. Les militants de Roots, par exemple, soutiennent le projet de confédération A Land for All – Two States One Homeland, reconnaissent le droit au droit au retour des Palestiniens et se disent prêts à vivre en Cisjordanie en tant que citoyens israéliens d’un futur État palestinien.
Contretemps – Concernant les organisations juives que tu étudies, ce discours pour la paix cohabite-t-il avec une défense du sionisme ?
Caterina Bandini – Oui, que ce soit dans le milieu des organisations pour les droits humains ou dans celui du dialogue interreligieux, seulement une petite minorité parmi mes enquêtés se définit comme a-, non- ou antisioniste. Pour mes recherches postdoctorales, je me suis intéressée à la gauche radicale israélienne où la rupture avec le sionisme est beaucoup plus répandue. Ici, au contraire, l’engagement pour la « paix » et contre l’occupation cohabite avec des lectures plus ou moins critiques du sionisme.
Certains vont se revendiquer de l’héritage bubérien, à savoir d’un sionisme « humaniste » et binational, qui ne se reconnaît pas dans le projet d’un État-nation exclusivement juif. D’autres, dans les colonies notamment, défendent un post-sionisme où le préfixe « post » n’a qu’une valeur temporelle : le sionisme ayant « réussi » dans son projet politique, il faut désormais passer à autre chose et cela implique de partager la terre avec les Palestiniens.
Il existe enfin un milieu juif religieux historiquement hostile à l’idéologie sioniste dans toutes ses formes : c’est le monde ultra-orthodoxe. On parle dans ce cas d’un antisionisme théologique basé sur la conviction que seul Dieu pourra « restituer la Terre d’Israël au peuple juif ». Il s’agit d’un terrain auquel je n’ai pas eu accès. Hormis un entretien que j’ai réalisé en tout début de thèse avec le porte-parole du mouvement ultra-orthodoxe antisioniste Naturei Karta à Jérusalem, il a vite été clair qu’en tant que femme non juive ne parlant pas le yiddish (et presque pas l’hébreu à l’époque), il aurait été très compliqué pour moi de poursuivre l’enquête.
Contretemps – Tu décris une théologie chrétienne palestinienne de la libération. Peut-on établir des comparaisons avec la théologie de la libération qui s’est forgée en Amérique Latine, à la fois en termes de composition sociale et de projet politique ?
Caterina Bandini – Les premiers théologiens de la libération palestinienne se sont inspirés de la théologie de la libération qui a vu le jour en Amérique du Sud au cours des années 1960, avec des auteurs comme Gustavo Gutiérrez au Pérou, ou Rubem Alves et Leonardo Boff au Brésil, mais aussi de la théologie de la libération afro-américaine, avec notamment l’œuvre de James H. Cone. La théologie de la libération noire d’Afrique du Sud, avec le document Kairós rédigé en 1985 par une majorité de clercs noirs pour dénoncer l’apartheid, ainsi que la théologie de la libération féministe portée par des autrices comme Elisabeth Schüssler-Fiorenza et Rosemary Radford Ruether, mais aussi les études postcoloniales de la Bible constituent autant de sources d’inspiration pour les Palestiniens.
La théologie de la libération palestinienne s’inscrit donc dans cette généalogie plurielle et complexe. Si les points communs avec la théologie de la libération d’Amérique du Sud sont nombreux (le rejet de l’universalité des Écritures et leur adaptation au contexte socio-politique contemporain, la priorité accordée à la praxis, la revendication d’une théologie qui vient des marges de l’institution ecclésiastique, la reconnaissance des spiritualités autochtones), il existe néanmoins des divergences. Le paradigme de l’Exode, en particulier, central dans l’exégèse sud-américaine où il est lu comme le récit de la libération et de l’autodétermination d’un peuple opprimé par une puissance étrangère (les Hébreux qui fuient l’Égypte), peut difficilement être transposé au contexte palestinien.
Le sionisme s’étant basé sur ce mythe pour cimenter le récit national israélien aux dépens des Palestiniens, il est impossible pour ces derniers de s’identifier aux Hébreux des Écritures. Deuxièmement, les mondes des théologiens sud-américains et celui des théologiens palestiniens sont complètement différents. Le christianisme palestinien évolue dans une société majoritairement musulmane dominée par la société juive israélienne qui détient le pouvoir politique. Dans cette configuration, le christianisme est numériquement minoritaire, alors qu’en Amérique du Sud c’est la religion majoritaire.
Enfin, la théologie de la libération d’Amérique du Sud est centrée autour des rapports sociaux de classe et de la pauvreté qu’ils engendrent, alors que la théologie de la libération palestinienne est avant tout une théologie de la terre qui cherche à déconstruire l’interprétation littérale de la promesse faite par Dieu au peuple juif, ce qui en explique la relative imperméabilité vis-à-vis de l’analyse marxiste. D’ailleurs, des débats vifs opposent théologiens et militants autour de l’appellation même de ce mouvement. Si certains continuent de parler de théologie de la libération (lahût at-taharrur en arabe), d’autres y préfèrent les expressions « théologie contextuelle » (lahût siyâqî) ou tout simplement, « théologie palestinienne » (lahût falastinî).
Contretemps – Tu ne mentionnes pas de groupes musulmans dans cette perspective religieuse pour la paix en expliquant que « les Palestiniens musulmans semblent manquer ‘d’adversaires’ au sein de leur propre communauté textuelle vis-à-vis desquels se positionner dans la construction d’un enjeu de mobilisation ». Est-ce à dire que la référence à l’islam ne constitue pas une ressource pour prendre part à la lutte pour la libération ? N’y a-t-il pas un risque consistant à invisibiliser les musulmans, malgré l’existence d’une théologie de la libération islamique ?
Caterina Bandini – Je ne crois pas. Il ne s’agit pas d’une démarche d’invisibilisation de ma part, moins encore d’une volonté de hiérarchiser les traditions religieuses, mais plutôt d’une donnée de terrain dont je propose des pistes d’analyse. Ce n’est pas quelque chose que j’avais décidée au préalable, bien au contraire : je voulais enquêter sur ces mobilisations minoritaires au sein des trois communautés religieuses et ce n’est que par la démarche résolument inductive de l’ethnographie que je me suis retrouvée avec un corpus d’organisations et d’enquêtés où les Palestiniens musulmans sont en minorité.
Dans le livre, j’explique que les Palestiniens musulmans n’ont pas investi de manière systématique le domaine théologique pour proposer des interprétations alternatives du Coran car, en raison de la nature relationnelle et dialectique du cadrage des luttes, ils ne doivent pas faire face à des lectures de leur propre Texte sacré justifiant leur dépossession, comme c’est le cas des Palestiniens chrétiens.
Certes, le référentiel coranique ou issu de la sunna occupe aujourd’hui une place importante dans le nationalisme palestinien, peut être mobilisé tout autant dans des discours sur la résistance armée que sur la résistance non violente, et est même à l’origine d’une théologie de la libération islamique qui a vu le jour au début des années 1990 grâce au travail d’intellectuels indiens, pakistanais et sud-africains. Ces phénomènes ne me paraissent pas contradictoires. Seulement, la démarche théologico-politique qui a fait l’objet de mon enquête se retrouve essentiellement, dans le contexte palestino-israélien, du côté chrétien et juif.
À ce propos, je voudrais ajouter que ce recentrement sur le christianisme et le judaïsme fait aussi l’originalité de mon travail par rapport à toute une littérature, largement apologétique, sur le dialogue judéo-musulman en Palestine-Israël. Cela permet de sortir de l’opposition binaire « juif/musulman » pour rappeler qu’il existe des altérités internes à chaque communauté : la figure du chrétien sioniste pour les militants palestiniens chrétiens et celle du Juif sioniste opposé à toute forme d’accord avec les Palestiniens, pour les militants juifs israéliens.
Cette perspective implique de complexifier la binarité structurelle souvent associée aux situations coloniales ; de mettre l’accent sur la centralité du fait sioniste chrétien, souvent méconnu ou ignoré ; et de rappeler l’existence et les engagements des Palestiniens chrétiens qui sont aussi souvent invisibilisés ou, pire, instrumentalisés dans le discours médiatique occidental.
Contretemps – Comme tu le soulignes, les mouvements de solidarité avec la Palestine, particulièrement en France, ont tendance à mettre à distance les référents religieux. Si on dépasse cela, comment envisager les usages de tels référents ? Autour de quelles pratiques et discours se forgent le militantisme que tu décris et cette « subjectivité minoritaire » ?
Caterina Bandini – Ce n’est pas le cas uniquement en France : les mobilisations que j’ai étudiées suscitent un profond scepticisme d’abord dans les milieux séculiers en Israël-Palestine. Mais c’est surtout vis-à-vis de leur communauté religieuse d’appartenance que mes enquêtés adoptent une posture de minorité critique. Les Palestiniens chrétiens doivent se confronter à la montée du sionisme chrétien et à son influence majeure sur la politique étrangère de pays tiers en faveur d’Israël, et notamment sur la politique étasunienne.
Les militants juifs non orthodoxes, essentiellement réformés et conservative, engagés dans des ONG de défense des droits humains se trouvent dans une position discriminée du fait de l’hégémonie du judaïsme orthodoxe au sein de la société israélienne. Les colons qui militent dans des groupes de dialogue avec des Palestiniens sont critiqués au sein de la société des colonies pour leur usage du référent juif qui vient remettre en cause – du moins en apparence – la vision exclusiviste du sionisme religieux. Les Palestiniens musulmans engagés dans le dialogue avec des colons représentent une toute petite minorité disqualifiée et condamnée au sein de la société palestinienne de Cisjordanie, au point que leur engagement est le plus souvent dissimulé.
Ma thèse est que ces différents groupes constituent, chacun à leur échelle, des « minorités cognitives » au sein de différentes communautés textuelles. J’emprunte ce concept au sociologue des religions Peter L. Berger, qui le définit ainsi : « Une minorité cognitive est un groupe formé autour d’un corps de “connaissance” déviante ». Le concept de « subjectivité minoritaire », que j’ai forgé, permet d’expliquer, dans une perspective relationnelle dénuée de toute considération statistique, la position et l’action de groupes minoritaires qui peuvent être dominants par ailleurs, dans d’autres sphères de la vie sociale.
C’est le cas notamment des militants juifs citoyens de l’État d’Israël de part et d’autre de la Ligne verte : ils et elles cherchent à s’approprier le pouvoir de définir leur identité à partir d’un rapport minoritaire à l’identité religieuse, ethnique et nationale, tout en occupant une position de pouvoir dans la relation de domination coloniale.
Du point de vue des mouvements de solidarité transnationale qui s’inscrivent plutôt dans la gauche radicale et décoloniale, je pense qu’il y a tout de même des choses intéressantes à prendre chez ces militants. D’abord, parce qu’ils n’évitent pas les questions épineuses. S’il est vrai que le conflit en Palestine-Israël est de nature coloniale et dès lors, il concerne d’abord la terre, on ne peut pas nier qu’il revêt aussi une dimension symbolique très importante, notamment en raison de sa résonance religieuse.
Qu’est-ce qu’on fait de ça ? Je pense que mettre cet aspect-là sous le tapis, considérer que tout ce qui a trait au religieux est forcément ésotérique et donc irrationnel, et que les marqueurs identitaires qu’ils soient nationaux ou religieux vont perdre de leur importance est illusoire, et même contre-productif. Deuxièmement, il me semble que ce que montrent les engagements que j’ai étudiés, quoique minoritaires, est que le langage religieux est une ressource puissante : elle peut traduire des discours et des actions opposés de par sa grande plasticité – dont des discours d’émancipation – et elle peut fournir un « cadre » à des personnes qui souhaitent s’engager mais n’arrivent pas à trouver leur place dans des mouvements séculiers.
La question qui se pose ensuite est celle des alliances possibles. Comme je le montre dans le livre, les individus et les groupes enquêtés peuvent sceller des alliances plus ou moins ponctuelles, plus ou moins stratégiques en fonction de la conjoncture historique et des rétributions, matérielles et symboliques, engendrées par l’engagement.
Contretemps – Tu as mené l’essentiel de tes recherches avant le début du génocide à Gaza, mais tu y es retournée depuis. Avant et après 2023, comment définir les horizons politiques des militants que tu as étudiés ? Alors que se mêlent fait colonial, question nationale, dimensions ethniques et religieuses, et que de plus en plus de travaux mobilisent une grille de lecture coloniale pour comprendre la situation en Palestine, comment envisager la perspective de tes enquêtés selon lesquels la religion doit être partie prenante de la solution à ce conflit, sans pour autant confessionnaliser celui-ci ?
Caterina Bandini – Comme je le dis dans la conclusion, il est impossible de prédire les effets du génocide sur l’évolution de ces mobilisations et sur le sens même des catégories religieuses ; et il est certainement trop tôt pour en proposer une analyse du point de vue des sciences sociales. Ce qui est sûr est que les convictions et les engagements de mes enquêtés restent fermes, à un moment où tout pas vers l’« autre » et tout avenir « commun » paraissent plus utopiques que jamais.
Le prisme colonial est fondamental pour comprendre le passé et le présent de ce qui se joue sur le terrain palestino-israélien, et donc pour saisir ces mobilisations aussi. Je m’inscris moi-même résolument dans le cadre théorique forgé par les études sur le colonialisme de peuplement (settler colonial studies en anglais). Si des Palestiniens considèrent aujourd’hui que leur libération passe aussi par l’acceptation du fait national et religieux juif en Palestine, c’est certainement parce que la situation coloniale les a amenés vers cette position. « Les Juifs ne vont pas partir et on ne va pas changer leur récit, donc il faut trouver un moyen de mettre un terme à leur domination et de partager la terre » : il s’agit d’une considération pragmatique qui mène inévitablement les Palestiniens à partager aussi leur autochtonie avec les Juifs.
Il n’en reste pas moins que, comme bien d’autres chercheurs, y compris palestiniens, l’ont pointé avant moi, les dimensions nationale et religieuse du sionisme demeurent effectivement des angles morts du paradigme du colonialisme de peuplement. Mon travail invite ainsi à explorer ces questions difficiles en prenant au sérieux les discours religieux critiques, quand bien même ils seraient minoritaires. C’est là, me semble-t-il, une exigence tout autant scientifique que politique.
*
Illustration : Tile Deadsea, de Ahed Izhiman (2024)