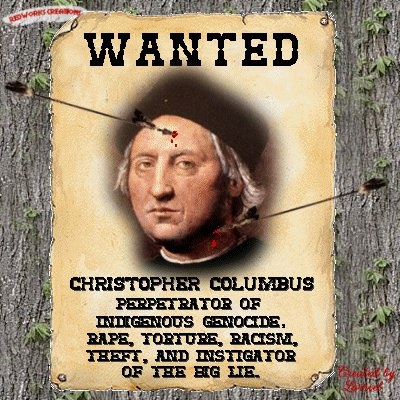Nous publions, avec l’aimable autorisation des éditions Wildproject, le chapitre 2, « La culture de la conquête », du livre de Roxanne Dunbar-Ortiz, Contre-histoire des États-Unis (Wildproject éditions, coll. « Le monde qui vient », 2018), traduit par Pascal Ménoret. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce livre ici. La préface de Pascal Ménoret est à lire ici.
La culture de la conquête
La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore.
Karl Marx[1]
Comment tout commença
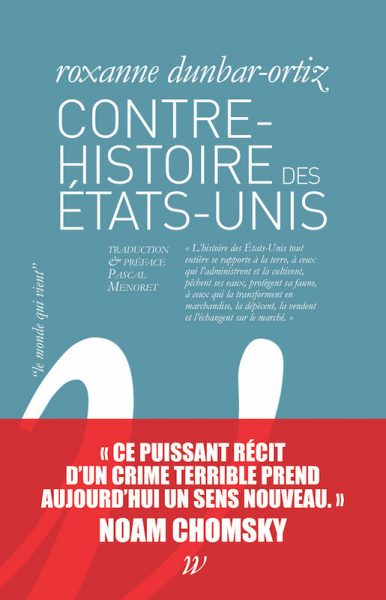
Suprématie blanche et classe
Les colons chrétiens arrivaient aussi avec leur croyance en la suprématie blanche. Comme le suggère un hymne protestant de 1878 (« Vos habits sont-ils immaculés ? Sont-ils blancs comme neige ? Sont-ils lavés dans le sang de l’agneau[9] ? »), l’idéologie de la blanchité (whiteness) dépasse la question de la couleur de la peau, bien que celle-ci ait été et continue d’être un ingrédient essentiel du racisme aux États-Unis. Les origines de la suprématie blanche se trouvent dans les entreprises coloniales des Croisades chrétiennes en terre musulmane et dans la colonisation protestante de l’Irlande. Ces projets sont la répétition générale de la colonisation des Amériques. Ils sont les deux ferments géopolitiques et socioculturels de la société états-unienne.
La Reconquista et l’expulsion des juifs et des musulmans de la péninsule Ibérique contribuèrent à faire de la suprématie blanche l’idéologie centrale du colonialisme moderne et la justification principale du génocide. Elles donnèrent naissance à la loi papale de la « pureté du sang » (limpieza de sangre) ; l’Église créa l’Inquisition pour l’évaluer et la déterminer. Le concept d’une race biologique fondée sur le « sang » n’était pas connu en Europe ou ailleurs avant cette époque, que ce soit sous la forme d’une loi ou d’un tabou[10]. Les Conversos (juifs convertis au christianisme) et les Moriscos (musulmans convertis au christianisme) étaient traités en boucs émissaires, et la suspicion à leur égard s’intensifia pendant plusieurs siècles en Espagne chrétienne. C’est alors que la doctrine de la « pureté du sang » devint populaire. Elle permettait d’accorder des privilèges psychologiques et légaux aux « vieux chrétiens », riches et pauvres, et de dissimuler les différences de classe entre l’aristocratie terrienne et les paysans et bergers sans terre. Quelle que soit leur situation économique, les Espagnols « vieux chrétiens » pouvaient s’identifier avec la noblesse. Un historien espagnol écrit que « les plébéiens regardaient vers le haut dans l’espoir de gravir l’échelle sociale et se laissaient séduire par les idéaux chevaleresques d’honneur, de dignité, de gloire et de vie noble[11] ». Lope de Vega, un contemporain de Cervantès, écrivit au 16e siècle : « Soy un hombre, aunque de villana casta, limpio de sangre y jamas de hebrea o mora manchada » (Je suis un homme de vilaine caste mais au sang pur et jamais souillé par les Hébreux ou les Maures).
Cet état d’esprit commun à toutes les classes sociales se retrouve dans l’attitude des descendants des premiers colons britanniques en Amérique du Nord. C’est là la première instance de nivellement des classes à partir d’une identité raciale imaginée : telle est l’origine de la suprématie blanche, l’idéologie centrale des projets coloniaux en Amérique et en Afrique. Comme Elie Wiesel l’a observé, la route d’Auschwitz fut pavée dès les premiers jours de la chrétienté[12]. L’historien David Stannard ajoute que, « en direction d’Auschwitz, cette route transperça le cœur des Indes occidentales et de l’Amérique du Nord et du Sud[13] ». L’idéologie de la suprématie blanche fut d’une importance cruciale pour neutraliser les antagonismes de classe entre les sans-terres et les propriétaires, et pour distribuer les propriétés confisquées aux musulmans et aux juifs en Ibérie, aux Irlandais en Ulster et aux peuples amérindiens et africains. La Grande-Bretagne devint une puissance coloniale outre- mer un siècle après l’Espagne et intégra plusieurs aspects du système espagnol de castes raciales dans ses rationalisations colonialistes, en particulier en relation avec les esclaves africains. Mais elle le fit dans le contexte du protestantisme, qui imaginait un peuple élu fondant une nouvelle Jérusalem. Les Anglais n’adaptèrent pas seulement les habitudes et les expériences de la colonisation espagnole ; ils avaient aussi leur propre expérience d’impérialisme outre-mer. Au début du 17e siècle, les Anglais conquirent l’Irlande et ouvrirent dans le nord 200 000 hectares de terre à la colonisation. Ceux qui peuplèrent cette colonie venaient en majorité de l’ouest de l’Écosse. Les Anglais avaient déjà conquis le pays de Galles et l’Écosse, mais n’avaient pas encore tenté d’expulser une population indigène si importante et de la remplacer par des colons. Ils attaquèrent systématiquement la structure sociale irlandaise, interdirent les chansons et la musique traditionnelles, exterminèrent des clans entiers et soumirent les survivants à une violence brutale. Ils tentèrent même de créer une réserve « d’Irlandais sauvages ». La « plantation » de l’Ulster prolongeait des siècles de guerre intermittente en Irlande, mais elle marquait aussi le début d’une autre histoire. Au 16e siècle, l’administrateur de la province irlandaise de Munster, Sir Humphrey Gilbert, ordonna « que les têtes de tous ceux (quelle que soit leur sorte) qui étaient tués en ce jour soient séparées de leur corps et amenées en la place où il campait pour la nuit, et qu’elles soient déposées sur le sol des deux côtés du chemin qui conduisait à sa propre tente, afin que nul n’y entre pour quelque raison que ce soit sans communément passer par une allée de têtes utilisée ad terrorem… [Cela répandit] une grande terreur parmi les gens quand ils virent les têtes de leurs pères, frères, enfants, voisins et amis occis[14]. »
Le gouvernement anglais payait des primes en échange de têtes irlandaises. Plus tard, seuls le scalp ou les oreilles furent requis. Un siècle plus tard, en Amérique du Nord, les têtes et scalps d’Indiens étaient également rapportés aux autorités en échange d’une prime. Bien que les Irlandais soient aussi « blancs » que les Anglais, leur transformation en êtres inférieurs à exterminer présageait du traitement racialisé des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique.
On observe un passage de la guerre de religion au colonialisme génocidaire dans les guerres chrétiennes contre les musulmans comme dans l’invasion de l’Irlande par les Anglais. Les Irlandais sous administration britannique seront regardés comme biologiquement inférieurs jusqu’au 20e siècle. Au milieu du 19e siècle, sous l’influence du darwinisme social, des savants anglais propagèrent l’idée que les Irlandais (et tous les peuples de couleur) descendaient du singe, tandis que les Anglais descendaient de « l’homme » qui avait été créé par Dieu « à son image ». Les Anglais étaient donc des « anges » et les Irlandais (et autres peuples colonisés) appartenaient à une espèce inférieure, que les suprématistes blancs états-uniens et autres identitaires chrétiens nomment aujourd’hui les « peuples de la boue » (mud people) : des produits inférieurs de l’évolution des espèces[15]. Le même Humphrey Gilbert qui avait été chargé de coloniser l’Ulster établit la première colonie anglaise d’Amérique du Nord, à Newfoundland, à l’été 1583. Dans les siècles qui conduisirent à la création des États-Unis, le protestantisme raffina la suprématie blanche en une véritable idéologie politique et religieuse.
Histoires finales
Selon un consensus actuel entre les historiens, le transfert général de terres des indigènes aux colons euro-américains après 1492 fut moins le résultat de l’invasion, des guerres et de l’avidité européennes, que des bactéries des envahisseurs, qu’ils transportaient sans le vouloir. L’historien Colin Calloway est l’un des tenants de cette théorie. Il écrit que « les maladies endémiques ont certainement entraîné une dépopulation gigantesque des Amériques, qu’elles aient été apportées par les envahisseurs européens ou ramenées par des marchands amérindiens[16] ». Une affirmation aussi absolue rend improbable tout autre destin pour les peuples indigènes. Le professeur Calloway est un historien méticuleux et immensément respecté de l’Amérique du Nord indigène, mais sa conclusion est l’expression d’une hypothèse par défaut. Cette hypothèse repose sur une théorie à la fois anhistorique et illogique puisque l’Europe elle- même perdit entre un tiers et la moitié de sa population pendant les épidémies médiévales. La principale raison pour laquelle le consensus est erroné et anhistorique est qu’il efface les effets du colonialisme de peuplement et de ses antécédents dans la
« Reconquête » espagnole et la conquête anglaise de l’Écosse, de l’Irlande et du pays de Galles. Au moment où l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre colonisèrent les Amériques, leurs méthodes d’éradication et d’asservissement étaient enracinées, simplifiées et efficaces. Si les maladies tuèrent autant d’indigènes, pourquoi les colonisateurs européens en Amérique jugèrent-ils nécessaire de faire une guerre sans répit aux communautés indigènes pour gagner chaque pouce de la terre qu’ils leur dérobèrent ? Pourquoi y eut-il presque 300 ans de guerres coloniales, puis des guerres permanentes conduites par les républiques indépendantes des Amériques ?
La démographie indigène précoloniale est objet de nombreux débats, mais personne ne discute le rapide déclin démographique des 16e et 17e siècles, qui se produisit à des moments différents selon les régions. Pratiquement 90 % des zones habitées des Amériques furent occupées au début de l’époque coloniale, réduisant les populations indigènes concernées de 100 millions à 10 millions d’habitants. Cet événement – présenté comme naturel – est le désastre démographique le plus extrême de l’histoire humaine. Cette destruction ne fut appelée génocide qu’à partir de la naissance de mouvements politiques indigènes au milieu du 20e siècle.
Benjamin Keen explique que les historiens « acceptèrent sans la critiquer l’idée qu’une “épidémie fatale s’ajoutant à l’absence d’immunité acquise” fut la cause de la diminution drastique des populations indiennes, et ne s’intéressèrent pas assez aux facteurs socioéconomiques […] qui prédisposaient les indigènes à succomber aux infections[17] ». D’autres chercheurs vont dans le même sens. Le géographe William M. Denevan n’ignore pas l’existence de maladies endémiques répandues, mais il s’intéresse aussi au rôle des guerres, qui renforcèrent l’impact fatal des épidémies. Il y avait des affrontements directs entre nations européennes et indigènes, mais une majorité de chercheurs pense que les puissances européennes montaient une nation indigène contre une autre, une faction contre une autre, tandis que les alliés européens aidaient l’un ou les deux côtés, comme ce fut le cas durant la colonisation des peuples d’Irlande, d’Afrique et d’Asie. Denevan cite d’autres facteurs mortels : le travail excessif dans les mines, les fréquents massacres, la malnutrition et la faim résultant de la rupture des réseaux commerciaux indigènes, de la production agricole et de la perte des terres, la perte de la volonté de vivre ou de se reproduire (et donc les suicides, avortements et infanticides), les déportations et la mise en esclavage[18]. L’anthropologue Henry Dobyns pointe l’interruption des réseaux commerciaux indigènes. Lorsque les puissances coloniales se saisirent des routes indigènes, de graves pénuries s’ensuivirent, notamment alimentaires. Elles affaiblirent les populations et les contraignirent à dépendre uniquement des colons, tandis que les produits de manufacture européenne remplaçaient les produits indigènes. Dobyns estime que tous les groupes indigènes souffraient de la disette une année sur quatre. Dans ces conditions, l’introduction et la promotion de l’alcool fut addictive et meurtrière ; l’alcool s’ajouta à la rupture de l’ordre social et de la responsabilité individuelle[19]. L’« absence d’immunité acquise » (y compris à l’alcool) semble donc un mythe pernicieux.
L’historien Woodrow Wilson Borah s’intéressa à la coloni- sation européenne en général, qui dépeupla aussi les îles du Pacifique, l’Australie, l’ouest de l’Amérique centrale et l’Afrique occidentale[20]. Sherburne Cook, qui travaillait avec Borah dans ce qu’on appelle l’École révisionniste de Berkeley, étudia la tentative de destruction des Indiens de Californie. Cook estima que 2 245 indigènes de Californie du Nord (parmi les Wintus, les Maidus, les Miwaks, les Omos, les Wappos et les Yokuts) perdirent la vie dans des conflits avec les Espagnols, tandis que 5 000 périrent de maladies et 4 000 furent déplacés vers des missions. Parmi les mêmes peuples, dans la seconde moitié du 19e siècle, les forces armées états-uniennes tuèrent 4 000 personnes et les maladies tuèrent environ 6 000 personnes. Entre 1852 et 1867, des citoyens des États-Unis kidnappèrent 4 000 enfants indiens parmi ces groupes. Dans ces conditions, la destruction des structures sociales traditionnelles indigènes et la dure nécessité économique contraignirent de nombreuses femmes à se prostituer dans les camps de chercheurs d’or, ce qui contribua à anéantir les vestiges de vie familiale dans ces sociétés matriarcales[21].
Les tenants de la théorie bactérienne, en insistant sur l’usure des sociétés par la maladie, négligent d’autres causes tout aussi meurtrières, sinon plus. Ce faisant, ils refusent d’admettre que la colonisation de l’Amérique était génocidaire par dessein, et que les morts massives n’étaient pas simplement le destin tragique de populations à la faible immunité acquise. Nul ne nie que, dans les camps de concentration nazis, la faim, la fatigue et la maladie tuèrent plus de juifs que les chambres à gaz ; nul ne nie non plus que la création et le maintien de ces conditions mortifères sont des actes évidents de génocide[22].
L’anthropologue Michael V. Wilcox pose la question suivante : « Pourquoi personne ne demande aux archéologues d’expliquer la présence continue de communautés indigènes 500 ans après Christophe Colomb, plutôt que d’expliquer leur disparition ou marginalisation ? » Cox appelle au démantèle- ment actif de ce qu’il nomme les « histoires terminales », ces
« récits de l’histoire indienne qui expliquent l’absence, la mort culturelle ou la disparition des peuples indigènes[23] ».
La fièvre de l’or
Parti à la recherche de l’or, Christophe Colomb toucha terre dans plusieurs îles des Caraïbes et dessina des cartes de la région. Bientôt une douzaine d’autres marchands-soldats cartographièrent la côte atlantique, des provinces maritimes de l’actuel Canada à la pointe de l’Amérique du Sud. Marchands, mercenaires, criminels et paysans vinrent de la péninsule Ibérique. Ils s’emparèrent de la terre et des propriétés des populations indigènes et déclarèrent que ces territoires appartenaient aux États espagnol et portugais. Ces actes furent confirmés par les monarchies et entérinés par l’autorité papale de l’Église romaine catholique. Le traité de Tordesillas divisa en 1494 le
« Nouveau Monde » entre l’Espagne et le Portugal selon une ligne de démarcation nord-sud qui traversait le Groenland et le Brésil. Le traité établissait la Doctrine de la Découverte, selon laquelle la possession du monde entier à l’ouest de cette ligne serait ouverte à la conquête espagnole, tandis que l’est serait réservé aux Portugais.
L’histoire est bien connue. En 1492, Christophe Colomb prit la mer avec trois navires. C’était son premier voyage sur ordre de Ferdinand, roi d’Aragon, et d’Isabella, reine de Castille. Le mariage de Ferdinand et d’Isabella en 1469 avait conduit à la fusion de leurs royaumes dans ce qui allait devenir le cœur de l’État espagnol. Christophe Colomb établit une colonie de 40 hommes sur « Española » (maintenant la République dominicaine et Haïti) et revint en Espagne avec des esclaves indigènes et de l’or. En 1493, il retourna aux Caraïbes avec 17 navires, plus de 1 000 hommes et des provisions. Les hommes qu’il avait laissés à son premier voyage avaient été tués par les indigènes. Après avoir établi une autre colonie, Christophe Colomb revint en Espagne avec 400 esclaves arawaks. Il retourna aux Caraïbes en 1498 à la tête de sept navires et atteignit l’actuel Venezuela. Il fit un quatrième et dernier voyage en 1502, cette fois vers la côte caribéenne de l’Amérique centrale. En 1513, Vasco Núñez de Balboa traversa l’isthme de Panama et cartographia la côte pacifique des Amériques. La même année, Juan Ponce de León revendiqua la péninsule de Floride pour l’Espagne. En 1521, après trois ans de massacres et le renversement de l’État aztèque, Hernando Cortés proclama une Nouvelle Espagne au Mexique. Tandis que Cortés écrasait la résistance mexicaine, Ferdinand Magellan explorait et cartographiait la côte atlantique du continent sud-américain. S’ensuivirent les guerres espagnoles contre la nation inca des Andes. Au Mexique et au Pérou, les conquistadors confisquèrent des objets raffinés et des statues en or et en argent. Ils les fondirent pour les transformer en monnaie. À la même époque, les Portugais dévastaient l’actuel Brésil et commencèrent un commerce fructueux des esclaves qui allait faire passer des millions d’Africains réduits en esclavage vers l’Amérique du Sud. Ce fut là le début du lucratif commerce atlantique des esclaves.
Les conséquences de cette accumulation de richesses se firent d’abord sentir dans les catastrophes que connurent les petits fermiers en Europe et en Angleterre. Les paysans s’appauvrirent et les ouvriers dépendants se massèrent dans les taudis urbains. Pour la première fois dans l’histoire humaine, la majorité des Européens dépendait pour leur subsistance d’une petite minorité fortunée, un phénomène que le colonialisme fondé sur le capitalisme allait répandre dans le monde entier. Le symbole de cette évolution, ou plutôt sa monnaie, était l’or. La fièvre de l’or était le nerf de l’entreprise coloniale, qui fut organisée à ses débuts pour acquérir ce métal dans sa forme brute. Plus tard, la ruée vers l’or devint plus sophistiquée ; les planteurs et les marchands créèrent les conditions nécessaires pour emmagasiner le plus d’or possible. Ainsi naquit une idéologie : la croyance dans la valeur intrinsèque de l’or en dépit de sa relative inutilité réelle. Les investisseurs, les monarchies et les parlementaires inventèrent des moyens de contrôler les processus d’accumulation de richesse et de pouvoir, mais l’idéologie de la fièvre de l’or continua de pousser des colons à traverser l’Atlantique vers un destin inconnu. La soumission de sociétés et civilisations entières, la réduction en esclavage de pays entiers et les massacres d’êtres humains village par village : nul prix était trop élevé, nulle méthode était trop brutale. Les systèmes de colonisation étaient modernes et rationnels – mais leur fondement idéologique était pure folie.
Notes
[1] Marx, Le Capital, « Genèse du capitalisme industriel » (Paris : Lachâtre, 1872), p. 336.
[2] Edward H. Spicer, Cycles of Conquest: The Impact of Spain, Mexico, and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960 (Tucson: University of Arizona Press, 1962), pp. 283-85.
[3] Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All (Berkeley : University of California Press, 2008), pp. 26-27.
[4] Deux textes historiques exceptionnels examinent en profondeur les premières pratiques et institutions coloniales. Sur la péninsule Ibérique et les Maures, cf. Henry Kamen, The Spanish Inquisition (New Haven : Yale University Press, 1999). Sur la colonisation anglaise de l’Irlande et les 13 colonies américaines, cf. Francis Jennings, The Invasion of America : Indians, Colonialism, and the Cant of Conquest (New York: W.W. Norton, 1976).
[5] Esther Kingston-Mann, « The Return of Pierre Proudhon: Property Rights, Crime, and the Rules of Law », Focaal : European Journal of Anthropology (2006), pp. 118-27.
[6] Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, (New York: Autonomedia, 2004), p. 184.
[7] Federici, Caliban and the Witch, pp. 171-80.
[8] Federici, Caliban and the Witch, p. 237.
[9] Intitulé « Es-tu lavé dans le sang ? » (« Are you washed in the blood ? »), cet hymne fut composé en 1878 par Elisha Hoffman, un pasteur presbytérien du Midwest. (N.d.T.)
[10] Norman Roth, Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain (Madison: University of Wisconsin Press, 1995), p. 229.
[11] Claudio Sánchez-Albornoz, España, un enigma histórico (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1962), p. 677.
[12] David E. Stannard, American Holocaust: The Conquest of the NewWorld (NewYork: Oxford University Press, 1992), pp. 153, 184, 246.
[13] Stannard, American Holocaust, 246. Pour une opinion contradictoire, cf. Gary Clayton Anderson, Ethnic Cleansing and the Indian: The Crime That Should Haunt America (Norman: University of Oklahoma Press, 2014).
[14] Jennings, The Invasion of America, p. 168.
[15] L. Perry Curtis Jr, Apes and Angels: The Irishman inVictorian Caricature (Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1997).
[16] Colin G. Calloway, compte-rendu de lecture de Julian Granberry, The Americas That Might Have Been: Native American Social Systems through Time, Ethnohistory (54-1, 2007), p. 196.
[17] Benjamin Keen, “The White Legend Revisited”, The Hispanic American Historical Review (51, 1971), p. 353.
[18] Denevan, « The Pristine Myth », pp. 4-5.
[19] Henry F. Dobyns, Their Number Become Thinned: Native American Population Dynamics in Eastern North America (Knoxville: University of Tennessee Press/Newberry Library, 1983), 2. Dobyns, Native American Historical Demography. Dobyns, « Estimated Aboriginal American Population », 295-416, et « Reply », pp. 440-444.
[20]Woodrow Wilson Borah, « America as Model: The Demographic Impact of European Expansion upon the Non-European World », Actas y Morías XXXV Congreso Internacional de Americanistas, México 1962 (Mexico City: Editorial Libros de México,
1964), p. 381.
[21] Sherburne F. Cook, The Conflict Between the California Indian and White Civilization (Berkeley: University of California Press, 1943).
[22] Cf. United States Holocaust Memorial Museum, « Documenting Numbers of Victims of the Holocaust and Nazi Persecution » (https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10008193) et « Killing Centers » (https://www.ushmm.org/ wlc/en/article.php?ModuleId=10007327, dernier accès 4 janvier 2018).
[23] Michael V.Wilcox, The Pueblo Revolt and the Mythology of Conquest: An Indigenous Archaeology of Contact (Berkeley: University of California Press, 2009), p. 11.