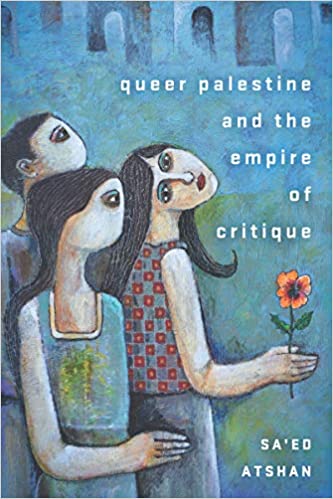
A propos de Queer Palestine and The Empire of Critic de Sa’ed Atshan (Stanford University Press, 2020).
Traduit de l’anglais par Nina Zadekine, avec l’aimable autorisation de l’auteur. Vous pouvez retrouver la version originale ici.
À l’aube du vingtième siècle, une fièvre étrange s’est emparée du monde civilisé : les parlements modernes ont adopté des lois ordonnant aux femmes orientales qu’ils gouvernaient d’abandonner les objets de mode couvrant leur visage. De Lord Cromer à Atatürk, « dévoiler » les femmes orientales est devenu une question de modernité ou de barbarie, de vie ou de mort. Tracts politiques, carnets de voyage et rapports de santé publique dépeignaient les nombreuses conséquences médicales, sociales ou politiques fâcheuses du « voile ». Des primes fiscales ou encore des rencontres avec des chefs d’Etat récompensaient celles qui se portaient volontaires pour se dévoiler. Les parlements soviétiques de l’Asie Centrale ouvraient leurs réunions avec des rituels de dévoilement : des dizaines de femmes retiraient leur foulard tout en prêtant allégeance au progrès socialiste séculaire et remettaient souvent leur voile sur le chemin du retour.
Plus d’un siècle plus tard, peu de choses ont changé. La Première Dame Laura Bush justifiait les guerres de son mari au Moyen-Orient par la libération des femmes. « Grâce à nos récentes victoires militaires dans une grande partie de l’Afghanistan, les femmes ne sont plus emprisonnées à la maison ». À partir de 2010, la loi française n° 2010-1192 « La République se vit à visage découvert », a interdit à toute femme d’accéder aux espaces publics si son visage était couvert, ce qui entraîna l’union du paysage politique autour de perles philosophiques telles que celle de Jacques Chirac : « le voile, qu’on le veuille ou non, est une sorte d’agression », ou encore celle de Hollande : « la femme voilée d’aujourd’hui […] se libérera de son voile et deviendra une Française ». Le texte de loi conclut : « Se dissimuler le visage, c’est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société ». Le « vivre ensemble » démocratique, tout comme la CIA, requiert des visages reconnaissables et identifiables. Ainsi, la burka apparaît fièrement comme le seul tissu criminalisé dans l’Union européenne.
Il fut un temps où la gauche aurait pu facilement lire en cet appétit pour la chair dénudée un symptôme de la domination coloniale. Dans les années 1950, le psychiatre Frantz Fanon, né en Martinique, diagnostiquait en cette maladie politique du regard colonial le désir agressif de « posséder » les insaisissables femmes racisées. « Cette femme qui voit sans être vue frustre le colon. Il n’y a pas de réciprocité. […] Elle ne s’offre pas. » Le voile dessinait une ligne abrupte au-delà de laquelle l’œil colonial n’arrivait pas à pénétrer – refusant l’accès aux recoins des cœurs et des esprits musulmans, tel un doigt d’honneur civilisationnel, témoin de l’échec de l’Occident à séduire le reste du monde avec ses normes, ses croyances et ses idéaux. Craignant pour les innocents plagistes, Manuel Valls, alors Premier ministre, partageait cette frustration avec une éloquence toute française : « Le burkini est […] la traduction d’un projet politique, de contre-société, fondée notamment sur l’asservissement de la femme. » En 2020, alors que les vertus sanitaires du niqab sont vivement débattues sur les ondes, certains parmi nous, confus, se demandent quelle sorte de société ombrageuse et sans visage le gouvernement français nous vend avec ses masques COVID obligatoires.
S’égarant bien loin de Fanon, le dogme progressiste d’aujourd’hui considère la visibilité non pas comme une injonction de l’occupation, mais comme la seule possibilité de représentation et de justice. Pendant la Journée de la Femme de 2011, au beau milieu de la plus large révolte que l’Égypte ait connue depuis longtemps, un petit groupe de femmes ont mis en scène sur la place Tahrir leur propre rituel de dévoilement, souvenir du bon vieux temps britannique, s’engageant de manière spectaculaire en faveur d’une existence démocratique éloignée des obscurantismes islamiques. Dans un autre coin de la place Tahrir, une demi-douzaine de jeunes socialistes queers scandaient des slogans proclamant publiquement leur différence sexuelle, sortant du placard, à la fois personnellement et politiquement, à la faveur de ce printemps arabe. Le front de la Guerre sur les voiles s’est étendu à des horizons plus queers. Les nouveaux porteurs de la flamme de la liberté toute nue, le mouvement LGBTQ international, promeuvent des rituels de sortie du placard qui feraient rougir Marie Kondo. Pendant les révoltes de Beyrouth de 2019, un jeune homme a traversé les manifestations avec une bannière sur laquelle on pouvait lire : « Je suis actif, alors pourquoi le gouvernement me baise-t-il encore ? #échangeonsnosplaces ». Et ainsi continue le déraillement axiomatique liant la visibilité et la représentation au progressisme de gauche, incontesté et incontestable. À quel point cette proposition reste-t-elle crédible par les temps qui courent ?
Le récent livre de Saed Atshan, Queer Palestine and the Empire of Critique, constitue un terrain fertile à la réflexion sur la nature réactionnaire des politiques de la visibilité. Cornell West le qualifie de « prophétique » dans la mesure où il révèle que « la justice et la liberté contre l’Empire et l’homophobie sont indivisibles ». A mes yeux moins religieux, Queer Palestine marche sur une corde raide séparant guide touristique-coquin et journal intime jargonnant, initiatique, sur les tribulations d’un maître de conférences à Swarthmore et quelques amis proches qui sortent du placard en Arabie. L’objet est enveloppé dans un discours queer corporatiste – législation anti-crime de haine, Mariage pour Tous et « Don’t Ask, Don’t Tell » – et couvert d’un vernis de « gayopolitique » : Tel-Aviv, tous les actifs sont partis à Berlin alors pourquoi tu ne laisses pas les Arabes dominateurs sexy entrer…
Atshan s’est, on ne sait comment, convaincu que les innovations « théoriques » de son livre, « ethnohétéronormativité » et « marginalisation discursive », seraient politiquement utiles à la libération sexuelle ou autre de la Palestine. Selon sa théorie conspirationniste, un obscur groupe de « puristes radicaux », tels que Michel Foucault, Edward Said et Joseph Massad, qu’il a dépassé, dominent le monde universitaire occidental et continue d’étouffer le mouvement queer palestinien en se focalisant implacablement sur la théorie critique et la politique anti-impérialiste, marginalisant ainsi les recoins « de gauche » des territoires palestiniens occupés. La voix d’un activiste triste capture les profondeurs de la détresse queer palestinienne : « La critique que fait Massad de notre travail est comme un nuage qui plane toujours au-dessus de moi. Comment puis-je prouver un négatif ? Je suis las. » Pour combattre les théoriciens « occidentaux » [sic] radicaux et leur combine destinée à « accabler de critiques des populations subalternes du Sud Global à des fins de subsistance », Atshan suggère de reconnaître la présence centrale et problématique de l’« ethnohétéronormativité » (syn : homophobie) au sein de la société palestinienne — sauvant ainsi les jeunes queers de leur besoin d’émigrer ou de devenir des collaborateurs du Mossad, tout en condamnant le reste d’entre nous à un inepte néologisme de plus.
C’est là que Queer Palestine se heurte au problème de l’empirisme : prouver l’homophobie palestinienne relève plus d’une vision de l’auteur que d’un rapport au réel. « Globalement, l’ensemble de la société palestinienne ne reconnaît pas l’existence des homosexuels parmi eux. […] En conséquence, les communautés queers palestiniennes ne provoquent pas de répression des autorités patriarcales. » L’intrigue se délite : les Palestiniens ne semblent utiliser l’« homosexualité » ni comme catégorie d’expérience vécue ni de criminologie. Dans de telles conditions, la haine de l’homosexualité peut donc rester insaisissable et requérir une démonstration peu orthodoxe. Atshan déduit, par exemple, l’homophobie du Hamas d’un seul article dans la section « divertissement » du magazine Out, intitulé « Arafat était-il gay ? », écrit par un journaliste américain sioniste et conservateur, familiarisé avec la langue arabe grâce à Google-traduction. Plus loin, Atshan invoque un sondage de Pew[1] indiquant une faible tolérance pour « l’homosexualité » en Cisjordanie et déplore l’absence de données similaires sur les attitudes des Palestiniens d’Israël, mais conclut qu’il « ne serait pas surprenant que les taux d’acceptation parmi la population y soient en effet plus élevés que dans les Territoires Occupés. » Il est difficile de savoir comment Pew a réussi à sonder les attitudes envers l’homosexualité d’une population qui se méfie de la surveillance étatique ou impériale – et pour qui, comme l’admet Atshan, le concept d’« homosexualité » n’a pas de sens. Il est également difficile de comprendre pourquoi Atshan suppose, sans preuve, que les Palestiniens d’Israël auraient un plus fort taux d’acceptation – sauf à supposer que la proximité avec les occupants modernes ferait progresser l’esprit arabe arriéré.
Les propres attaques libérales d’Atshan envers les populations palestiniennes, promouvant les « droits queers » – c’est-à-dire l’intervention violente de l’État dans la vie de famille, les nouvelles techniques policières, l’incarcération et l’embourgeoisement urbain –, dans la lignée des programmes politiques impériaux, sont curieusement dépeintes comme « émancipatrices » et « progressistes » pour le Sud Global, tandis que les critiques qu’on fait Massad et Puar de l’ingénierie sociale impériale sont présentées comme un « purisme radical » paralysant. Malgré le fait qu’il reconnaisse l’absence de « répression par les autorités patriarcales » des Palestiniens queers, Atshan se lance dans une croisade visant à rendre cette population queer encore plus visible pour l’État – une tactique rappelant la gestion impériale des « minorités visibles », des « Chrétiens de l’Orient » aux « femmes de l’Est » : les pouvoirs impériaux avaient encouragé ces « minorités » à se rendre visibles, qu’il s’agisse de retirer les privilèges et droits spéciaux à l’Empire ottoman ou de sur-employer ces minorités dans les administrations coloniales, ou, plus tard, de leur accorder un accès spécial aux visas euro-américains. Cette augmentation des privilèges attira une attention populaire néfaste sur ces populations autrement bien intégrées, jusqu’à ce que leur environnement devienne si hostile que seule leur restait la mort ou l’émigration.
Cette émulation, par Atshan, de la doctrine impériale « diviser pour mieux régner », ne semble « progressiste » que si elle est considérée à travers une grille de lecture faisant correspondre la lutte politique à la visibilité. « [E]n plus du regard blanc, il me faut aussi faire face au regard sioniste, au regard hétéronormatif et au regard puriste radical […] et cela peut être étouffant pour les queers palestiniens. » D’autres font face à l’occupation coloniale, à la violence policière, aux attaques militaires ou aux peines de prison arbitraires et à la torture. Atshan lutte avec son syndrome du lapin pris dans les phares, et élève cette photosensibilité au rang de programme politique. « Parce que je suis un Palestinien queer qui est également pris dans des formes de surveillance externe, le développement de ma propre conscience reflète de certaines manières le développement de ce mouvement [queer] dans son ensemble. »
Le présent lecteur aurait souhaité qu’Atshan fasse moins usage du développement de sa conscience comme modèle : originaire de la classe moyenne supérieure, ayant fréquenté une école d’élite Anglo-Quaker à Ramallah, avant Swarthmore et Harvard, enchaînant ensuite avec un poste dans son alma mater, il ne représente guère le quidam palestinien. Un examen plus critique de sa position sociale particulière, ou la lecture en diagonale d’un manuel de sociologie, auraient pu l’empêcher de colporter des stéréotypes orientalistes tels que celui voulant que les musulmans croient que « les hommes non-mariés n’ont pas encore complété “la moitié de leur religion” », de prétendre que le discours radical anti-impérial empêche l’avènement des droits de l’homme dans le monde arabe – la principale thèse de la politique étrangère américaine de Nixon à Clinton ; ou d’écrire au nom des victimes arabes, en consacrant un chapitre entier à enfoncer les deux seules associations queers locales, ainsi que leurs fondatrices palestiniennes. Les accusations de mercantilisme contre Massad et Said – qui ont défendu leurs positions politiques à grand coût personnel – ont la teneur d’un rituel initiatique de passage à tabac permettant l’accès aux plus hautes sphères du monde universitaire américain.
Ce qui émerge du narcissisme méthodologique d’Atshan est un désir – non pas d’une moindre surveillance – de visibilité pour la communauté queer palestinienne aux yeux des blancs, quel qu’en soit le coût. Atshan rejette toute suggestion d’une politique d’invisibilité comme étant une relique d’un passé préhistorique, un attachement lâche au placard. « Le sexe brut » (Bare sex), par exemple, est évidemment inférieur au couple romantique. La politique de visibilité équivaut à concourir pour l’attention de l’élite mondiale, en étant fidèle à leurs codes de respectabilité bourgeoise. Queer Palestine excelle en ce sens. Les seuls exemples d’émancipation queer « subversive » du livre se noient sous cette soif de respectabilité blanche. Le premier concerne un couple gay de Cisjordanie conduit par des amis gays étrangers sur une route israélienne militarisée jusqu’à Tel-Aviv, où ils respirent l’air romantique de la mer sur un balcon, et où « l’esprit de la résistance palestinienne queer » se rapproche dangereusement du simple droit à la consommation.
Dans le second exemple, Atshan se rend à une fête où « scripts et mouvements corporels pouvaient être aussi outranciers que le permettait un contexte palestinien. » Traduction : une femme imitant Leonardo DiCaprio étreint un homme incarnant Kate Winslet qui se tient à la proue d’un bateau. Cette reproduction du script de Titanic émeut aux larmes l’assemblée à la pensée des dangers auxquels ils ont échappé en confinant cette performance « subversive » à un événement privé. Nous sommes là dans le territoire du culte hollywoodien millénariste, regorgeant d’invocations aux esprits d’ancêtres queers américains (Kate et Leonardo), d’antiques sons gays ésotériques (Céline Dion) et de possession cathartique (les « mouvements corporels outranciers »), guérissant ainsi les blessures traumatiques de l’histoire. Comment se rituel subvertit-il l’occupation israélienne ? Il s’agit-là d’une question qui nous taraudera pour toujours. Plus important encore, pourquoi Atshan devrait-il se soucier de la longue histoire de performances drag arabes – de Fairuz à Ismail Yassin en passant par Bassem Feghali – qui occupèrent le prime time bien avant que RuPaul[2] ne soit connu, ou de quelques autres symboles culturels locaux pertinents lorsque les symboles hégémoniques impériaux sont largement disponibles ?
La reconnaissance est moins douce quand elle émane des faibles que lorsqu’elle provient de ceux qui tiennent les rênes des subventions, de la célébrité ou de la titularisation. Pendant qu’il accorde à ses amis le droit de jouer à DiCaprio en huis clos ou dans des hôtels de Tel-Aviv, Atshan éprouve de la rancune envers le fait que les « Palestiniens queers militants [radicaux] trouvent cela pratique de se barricader derrière des arguments tels que “’le coming out et la gay pride sont occidentaux”’ ». Échapper au regard sanguinaire de l’Arabe en s’habillant en Américain constitue une bonne forme d’invisibilité, échapper aux sondages Pew et aux catégories identitaires euro-américaines, aux statistiques et au monde universitaire, en est, à l’inverse, une mauvaise. Avec quelle aisance la visibilité converge-t-elle avec le succès commercial, et la reconnaissance avec le marketing de soi, lorsqu’on est à Swarthmore.
Il existe une compréhension tacite au sein des communautés queers marginalisées selon laquelle la visibilité signifie une certaine prise de risque personnel. La culture drag a perfectionné le « reading[3] » en tant que forme d’art pour cette raison : la visibilité implique de s’exposer, et les insultes rituelles sur scène endurcissent contre les vicissitudes de la vie. Les agitateurs LGBT de temps révolus, comme Harvey Milk, avaient remué ciel et terre et risqué leur vie dans leur lutte. Aux premières lueurs de la bataille, Atshan, comme tant d’autres prophètes arabes du sexe – du calibre de Mona al Tahawi – se sont rapidement téléportés vers des rivages plus sûrs, jetant malheureusement en pâture, à la torture et à la répression étatiques ces vies racisées de plus en plus visibles.
L’affaire Sarah Hegazy constitue un excellent exemple de cette dynamique. En 2017, la militante avait brandi un drapeau arc-en-ciel à un concert de Mashrou’ Leila au Caire – inspirée par le chanteur ouvertement queer du groupe libanais, Hamed Sinno. Sarah fut ensuite arrêtée et torturée par les forces étatiques. Un an plus tard, Sarah et le chanteur du groupe ont tous deux déménagé en Amérique du Nord, où celle-ci s’est suicidée en 2020. Le reste de la population égyptienne doit faire face à une nouvelle loi sanctionnant les actes homosexuels d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, et offrant de nouvelles possibilités à la police de surveiller les réseaux sociaux. La visibilité, pour le gay de la classe moyenne, demeure tout de même synonyme de succès – malgré toute preuve du contraire. Là, la théorie queer rencontre les dogmes économiques de l’École de Chicago : « A demain le bon sexe ! mais d’abord il faut faire des sacrifices ! » Il faut casser des œufs basanés pour faire des omelettes queers ; curieusement, ce sont toujours ceux de vos voisins qui y passent en premier.
« Ces dernières années, le mouvement palestinien queer s’est orienté vers le purisme radical et sa croissance a atteint un plateau. » On ne peut qu’imaginer tous les militants palestiniens de terrain lisant Massad ou Puar avec enthousiasme, se convertissant en masse au « purisme radical » et à la « paralysie existentielle » et conduisant leur mouvement vers un « plateau toxique », freinant son plus haut potentiel de visibilité, « sa part de marché naturelle en termes de public et de capacité ». La visibilité ne peut pas flirter avec la respectabilité si elle n’a pas de part de marché « conséquente » pour la soutenir. Alors elle flirte avec le langage monogame des ventes, s’écartant bien loin du discours polyamoureux de la solidarité.
*
Le dévoilement et la sortie du placard sont des obsessions européennes aussi vieilles que les Lumières, que la réforme et l’ingénierie sociale. La définition kantienne de l’Aufklärung, « oser savoir », a encouragé l’élite à apporter la Lumière de la Raison aux masses réticentes, les transformant en une transparence domesticable. Le grand-père de la pensée du marché, Adam Smith, regrettait l’invisibilité des désirs humains et théorisa par conséquent le déploiement de « mains invisibles » du marché comme seule façon rationnelle pour un souverain aveugle de gérer l’opacité humaine. Karl Marx se raccrochait à une vision « scientifique » du socialisme, laquelle donnerait au prolétariat le pouvoir de « voir » leur intérêt « réel » et « objectif » à décapiter la bourgeoisie globale. Le projet de vie de Freud était d’« amener le ça dans le moi » – de rendre visibles les instincts sous-jacents qui sabordent le contrôle humain.
Convaincre de larges strates de la classe moyenne que se soumettre au regard de l’État et de son armée de drones était, d’une manière ou d’une autre, désirable a nécessité un travail idéologique continu et maintes concessions financières. La célébrité de Kim Kardashian tire ses racines de l’abolition des rideaux dans les régions protestantes des Pays-Bas et de l’Allemagne au XVIIe siècle. Pourquoi s’embarrasser de rideaux lorsque votre salon ressemble à la salle de réception d’un hôpital ? Des mains invisibles faisaient désormais le travail du Diable. Une culture entière d’auto-police, de confession et de délation se répandit à travers ces régions d’Europe, réduisant les dépenses en surveillance pour le prince et facilitant sa domination. En Bavière, les voisins qui dénonçaient auprès de l’État un camarade paysan qui n’avait pas maximisé l’utilisation de son terrain se voyaient octroyer ce terrain pour eux-mêmes. Ce culte protestant de la vertu visible s’est enraciné tant et si bien qu’il demeure quasiment inchangé dans les débats actuels sur la vie privée en ligne : pourquoi aurait-on besoin de vie privée si l’on n’a rien à cacher ? Plutôt qu’un terrain, ce sont des likes sur Facebook qui viennent nous récompenser.
La Sainte Trinité « visibilité, reconnaissance et pouvoir » a profité aux privilégiés et porté atteinte aux masses – car l’élite n’a jamais cultivé une irrépressible bienveillance pour les damnés de la terre. Historiquement, l’accroissement de la visibilité s’est donc traduit par une domination simplifiée, ainsi que par un ressentiment majoritaire envers les revendications des plus vulnérables. Les séquelles sont profondes. Les Afro-Américains esquivent par réflexe le regard mortel des officiers de police. L’ensemble des populations coloniales fuit les études contrôlées aléatoires des entreprises. En arabe, le mot bahth, signifiant recherche, est proche de mabaheth, les Services d’Intelligence de l’État. La géolocalisation, le traçage des contacts et le cyberharcèlement ont même poussé la classe moyenne protestante à chercher désespérément un semblant de vie privée. La multitude – ne possédant ni argent, ni statut, ni réseau, et n’ayant pas accès à de puissants avocats – vit la visibilité non pas comme une ressource nécessaire à la survie du plus fort, mais comme un tsunami de haine sociale, d’isolement et de perte de ses moyens de subsistance. Le contrecoup des mesures de discrimination positive, notamment les réactions contre le féminisme et contre les minorités queers à travers le monde, témoigne avec force de la fragmentation sociale résultant d’une politique de mise en avant des différences visibles. Pour les Kardashians du monde – une poignée de privilégiés qui possèdent les ressources sociales et symboliques permettant de transformer leur visibilité en privilège croissant – la visibilité demeure un gage de vertu.
À partir des années 1960, les intellectuels de la nouvelle gauche ont habilement repositionné ce culte tricentenaire de la visibilité dans le champ du dogme progressiste. Dans une quête de réforme des préoccupations marxistes exclusivement portées sur les classes ouvrières et le conflit de classe, ces penseurs ont déployé une politique plus « sophistiquée » de l’identité et de la visibilité. La nouvelle équation émancipatoire a dès lors associé la visibilité à la reconnaissance sociale, elle-même liée aux droits politiques. Le mouvement américain des droits civiques a entrepris de lutter pour que le regard des suprémacistes blancs aille au-delà du voile de mélanine de la peau afro-américaine et étende marché et participation politique à tous. Les critiques féministes du patriarcat se réunirent autour du slogan « le personnel est politique », soulignant ainsi la continuité du patriarcat, depuis la lumière crue des conseils d’administrations des entreprises jusqu’à l’ombre des rideaux des chambres à coucher. Les désirs les plus intimes sont devenus des actes politiques, sous-tendus par des forces sociales aspirant profondément au changement. En pleine crise du sida, le mouvement LGBT s’est rallié autour du slogan aujourd’hui célèbre d’ACT-UP, SILENCE=MORT, afin de lutter contre l’indifférence gouvernementale et sociétale à leur détresse invisible. Au sein de la théorie démocratique, la préoccupation centrale de la gauche était compréhensible : comment le progrès pouvait-il se faire sans visibilité, si la visibilité était une précondition à la représentation politique ?
L’iconoclasme de Foucault, du Panoptique à l’histoire de la folie, a été d’insister sur l’association entre visibilité et domination. L’invention de la sexualité au XIXe siècle a participé au fondement du programme étatique victorien visant à rendre visibles les désirs de la population, et donc gérables, par divulgation constante et confession attentive. Les résultats, deux siècles plus tard, sont clairs : de l’industrie pornographique aux boîtes de nuit, de l’abonnement obligatoire à la salle de gym à la chirurgie esthétique, des stéroïdes et amphétamines au Viagra et aux anti-dépresseurs, des Incels au sadomasochisme, du travail du sexe au trafic sexuel. La suraccentuation du désir comme pilier fondamental de l’identité personnelle et de « la belle vie » a mené à la désintégration de la solidarité politique, et à l’avancée de la consommation concurrentielle. Imaginez les heures passées à soulever des poids, de masturbation pornographique, de discussion sur des applis de sexe, canalisées dans l’aide aux pauvres et aux marginalisés, ou dans la lutte contre la prédation des entreprises, et vous pouvez imaginer ce que la privatisation du plaisir sexuel a fait à notre vie en commun.
Les visions du monde antique et médiéval comprenaient les désirs comme des mouvements accidentels de l’âme ; de simples faiblesses de la chair auxquelles on devait à l’occasion donner satisfaction avec dérision. Les désirs se traînaient à la périphérie du Soi. L’invention de la sexualité, en liant désirs et identité personnelle, a renforcé le dogme du marché selon lequel les désirs sont les fondements du Soi, qui nécessitent une observation sociale incessante, un examen médical, un questionnement psychanalytique et une analyse criminologique. Plus tard, la sacralisation des désirs sexuels, devenus un enjeu des droits de l’Homme, a facilité la notion adjacente selon laquelle il « n’y a pas d’alternative » au libéralisme du marché. S’il existe un droit au plaisir – par le sexe – alors il y a un droit politique à tous les plaisirs, y compris à la consommation. Si les désirs méritent la plus haute forme d’attention et de protection, alors qui mieux que la démocratie libérale de marché pour répondre à la tempête des désirs toujours changeants ? Le communisme et son étalage fade de marchandises fonctionnelles et de sexe utilitaire a échoué historiquement.
Plus qu’aucun autre mouvement de l’âme, le désir offre un terrain fertile aux gouvernements qui soutiennent que les désirs sont des affaires politiques nécessitant d’être régulés. Laissée sans surveillance, la sexualité peut conduire à un nombre de dangers innommables qui menacent de mettre la société à genoux. Trop de femmes insatisfaites et « hystériques » menaceraient de se transformer en mères tueuses en série. Trop de pédophiles pourraient mener à une génération d’enfants brisés. Trop d’homosexuels, à l’effondrement du taux de fertilité de la nation et à l’affaiblissement de la force militaire. Trop de couples interraciaux, à la disparition de la race blanche. Trop de pères indignes et de mères assistées, à la prolifération des gangs de rue et à la fin de la propriété privée. Dans l’imaginaire bourgeois, les perversions sexuelles constituent l’une des voies les plus rapides de l’annihilation nationale et donc un domaine de surveillance primordial. Ainsi, l’ennemi interne queer vient compléter la peur des barbares à nos portes.
Cette histoire de la sexualité et de la domination politique demeure fortement eurocentrée. La sexualité n’a pas été l’élément le mieux exporté par l’impérialisme européen. À ce titre, le cas de la « journaliste » égyptienne Mona Iraqi est édifiant. Iraqi dirigeait une émission « d’enquête » appelée « Al-Mostakhabi » (Ce qu’on nous cache). En 2016, de façon anonyme, elle dénonça les bains Beit El Bahr aux autorités, pour dépravation homosexuelle. Son équipe a facilement capturé les images du raid de police qui s’en est suivi, filmant sous de multiples angles pendant que des hommes nus se faisaient arrêter pour débauche publique. Quelques jours avant la diffusion prévue à la télévision égyptienne de son épisode traitant des pratiques sexuelles invisibles, son mur Facebook a fait l’objet d’une déferlante de mécontentement populaire : peu de personnes comprenaient la nécessité de s’immiscer dans la vie sexuelle d’inconnus, si ce n’est pour qu’Iraqi puisse satisfaire sa soif de sensationnalisme et de célébrité. Le contrecoup fut suffisant pour qu’Iraqi annule cette diffusion. Quelques mois plus tard, elle a toutefois annoncé que l’émission serait diffusée à l’occasion de la Journée Internationale du Sida. Entre temps, l’émission avait été dépeinte comme une enquête sur les pratiques sexuelles propageant le VIH d’homme à homme, puis à leurs épouses à la maison, et finalement à la nation entière. Présentée comme une enquête de santé publique pénétrant les recoins ténébreux de la vie cairote, l’émission a été diffusée sans grande résistance. Cependant, les tribunaux ont innocenté les victimes d’Iraqi de tous les chefs d’accusation, et leurs familles ont gagné leur procès pour diffamation contre Iraqi, qui a été condamnée à une peine de six mois de prison.
Malgré l’insistance constante et racoleuse de l’État postcolonial consistant à soutenir que les gangs de « queers » menacent de ruiner le pays, malgré les rapports de la presse et des ONG internationales traitant de l’existence des queers au cœur de l’obscurité, malgré PornHub lui-même, le concept de sexualité n’arrive pas à s’établir en dehors d’une section cosmopolite de la classe moyenne supérieure du Tiers Monde. Comme le dit un chef de la sécurité congolais aux Nations Unies : « Comment les hommes blancs nous ont-ils convaincus que la polygamie est contre nature, mais que l’homosexualité ne l’est pas ? » Bien que beaucoup d’observateurs internationaux l’interprètent comme une source de préoccupation pour les minorités invisibles, l’absence de sexualité, et des nombreuses techniques de contrôle sur les désirs « normaux » qui en découlent, pourraient fournir des opportunités politiques permettant d’éviter le destin réactionnaire des politiques libérales euro-américaines. Se battre contre les chefs autoritaires et leurs brutales interdictions légales pourrait se révéler plus simple que lutter contre l’apathie sociale du consumérisme et des désirs normalisés.
L’augmentation des homicides homophobes à San Francisco dans les années 1970 offre un bon exemple de l’emprisonnement réactionnaire de la sexualité. Selon un militant, la visibilité « pourrait être notre succès le plus évident des années 1970, mais cela signifie également que tous les homophobes de l’Amérique savent comment nous reconnaître et où nous trouver. » Ce n’est qu’en 1980 que cette tendance a commencé à reculer, avec l’embourgeoisement croissant de la ville et l’expulsion des classes ouvrières catholiques hors du centre-ville, au soulagement de beaucoup de militants LGBT. Comme l’expliquait Dan White, assassin de Harvey Milk et homme politique catholique irlandais de la classe ouvrière, dans son journal de prison, « les gens de mon quartier trouvaient que les gays avaient rendu les choses encore plus difficiles pour les familles nombreuses parce qu’ils n’ont pas d’enfants pour lesquels s’inquiéter et plusieurs d’entre eux peuvent mettre leurs salaires en commun et payer des loyers plus importants qu’une seule famille, et ceci a pour effet d’augmenter les coûts. » Les victimes de violence homophobe sont-elles à blâmer lorsqu’elles se rangent du côté de leurs bienfaiteurs bourgeois – la police, les banques discriminatoires et les promoteurs immobiliers racistes ? Peut-être. Ou peut-être que le choix entre « être nous-mêmes »/lécher les bottes de la bourgeoise et « rester dans le placard »/lutter n’est pas du tout un choix.
*
« Il y a un grand secret autour du sexe : la plupart des gens n’aiment pas ça. » L’injonction de Leo Bersani à replacer la bonne vieille copulation à sa position légitime – à la périphérie de nos êtres – dessine les contours d’une issue de secours menant hors de la prison de la sexualité. Le sexe n’est ni dangereux ni transcendant, et ne mérite pas particulièrement notre temps. Relégué aux confins de chambres hypothéquées, de baisers monopolisés et de galipettes chimiquement améliorées, le sexe se noierait dans son propre ennui répétitif et standardisé. Les bonobos – nos experts sexuels désignés – malgré toute leur propension à cette activité, ne semblent pas en profiter pendant plus de 13 secondes à la fois, et peut-être à raison. Pour que survive la mythologie du sexe comme plaisir ultime, il faut du théâtre : affublé d’un déguisement oriental, entouré du spectre de la répression, appuyé par le placard et ses divers agents de police. Rien n’attise le feu d’une technique raffinée de contrôle gouvernemental autant qu’un obstacle bénin à la consommation – tel le coût prohibitif d’un sac Louis Vuitton. Le culte de la sexualité est la psychologie inversée de l’état de marché, une grossière injection de doses régulières de passion pour nous éviter de tomber dans l’insipidité d’une vie faite de purs intérêts. Reléguer nos désirs au second plan ombragé de nos esprits, où nous ne pouvons ni les voir, ni en être obsédés, ni en discuter, ouvre des pistes inexplorées de résistance.
L’invisibilité et l’opacité pourraient-elles être des stratégies politiques plausibles pour un autre programme de gauche ? Les droits universels socialistes constituent, à ce titre, une des techniques d’invisibilité politique profitant aux plus vulnérables, sans diriger les projecteurs sur une lutte particulière. La participation des femmes trans aux compétitions féminines ne représenterait pas un tel problème si chaque athlète professionnel recevait un salaire décent, au lieu de surpayer les trois qui montent sur le podium. Pourquoi faire campagne pour l’égalité du « droit de conduire » pour que les femmes puissent tenir le volant en Arabie Saoudite alors que le droit universel au « transport public gratuit » se languit silencieusement dans un coin ? Si la mobilité est un enjeu pour les femmes en particulier, c’en est également un pour la majorité pauvre. Pourquoi insister sur le besoin de discipliner les familles palestiniennes pour qu’elles acceptent leurs enfants « queers » – le plaidoyer des droits humains d’Atshan – au lieu de se concentrer sur tous les enfants « vulnérables » ? Au lieu d’imposer des catégories d’identité sexuelle bourgeoises soutenues par force de loi, pourquoi ne pas promouvoir le droit universel au logement et au revenu pour que tous les adolescents rejetés par leur foyer (ainsi que les adultes) puissent échapper à la rue, et se garder loin de l’étreinte chaleureuse des services secrets israéliens ? Les sans-abris ne trahissent-ils leur patrie que s’ils sont queers ?
On pourrait dire la même chose des campagnes pour le mariage gay qui se concentrent sur le traitement discriminatoire au chevet d’un amant agonisant et non-épousé. Au lieu d’ouvrir un chemin à l’égalité du mariage, ces gauchistes auto-proclamés auraient pu lutter pour abolir les privilèges juridiques et économiques conférés par l’amour contractuel. Cette stratégie pourrait être attrayante pour une bien plus large population – les veufs et veuves, les parents célibataires, les jamais-marié(e)s, les marié(e)s repentant(e)s – et aurait l’avantage supplémentaire de rendre l’héritage plus difficile pour tout le monde – un vieil objectif progressiste. Les objectifs sociaux, économiques et politiques égalitaires pourraient être atteints en rendant les groupes vulnérables moins visibles, plutôt que l’inverse. Mais la bourgeoisie veut acheter et vendre plus de voitures, veut sculpter les masculinités de la classe ouvrière, pour maintenir les structures familiales assurant la perpétuation de la propriété et du privilège, et concourir à coup de millions dans des tournois sportifs. Et ainsi, nous payons tous la facture.
Les anarchistes ont longtemps développé des cultures du passer inaperçu, se créant des espaces de liberté invisibles, hors de la surveillance de l’État et des entreprises. Le tubercule a tiré sa popularité fanatique parmi les peuples libres grâce à sa capacité à prospérer en dessous du voile protecteur de la terre, se dérobant ainsi au regard des percepteurs d’impôt ou des envahisseurs charognards. Les structures sociales tribales ont depuis longtemps prisé des formes extrêmes de désagrégation sociale, basées sur des ménages éparpillés et une agriculture de subsistance, ce qu’Ernst Gellner a baptisé la stratégie du « diviser pour ne pas être gouverné ». Si les Ottomans préféraient négocier avec les chrétiens et les juifs plutôt qu’avec les sectes hétérodoxes, si les Britanniques ont constamment inventé des traditions tribales pour créer des unités administratives impériales, c’est parce qu’il est plus difficile de régner sur des populations amorphes et déstructurées – ne possédant pas un langage commun, mais un entrelacement complexe d’idiolectes adjacents, ni de chef manifeste avec lequel négocier, et caractérisées par une mobilité nomade qui les rendait difficiles à cerner.
On pourrait en dire de même de la corporatisation quasi complète des mouvements LGBT en Europe comparée aux multiples formes d’anxiétés que les populations « déviantes » inspirent aux gouvernements arabes : il est plus simple d’appréhender une communauté gay structurée et ses représentants parlementaires – en les soudoyant à base de Grindr et d’égalité du mariage – plutôt qu’une multitude de sujets invisibles et mécontents qui sèment constamment le trouble. Sans l’attachement à la visibilité et à la politique des identités, la conjoncture actuelle présente un grand potentiel : au lieu de craindre la prolifération de « tribus » incohérentes, nous pouvons nous laisser diviser jusqu’à devenir une épine ingouvernable et impossible à identifier dans les pieds des États et des grandes entreprises. À la fin des années 1990, quand dans une usine indonésienne, les ouvriers semblaient être tous possédés en même temps, les propriétaires de l’usine, pris de panique, ont été forcés de sacrifier des poulets pour apaiser les esprits ancestraux en colère et nourrir les ouvriers. Peut-être est-il temps de laisser croître nos désirs, tels des tubercules, voilés par notre propre désintérêt, ou peut-être les laisser prendre possession de nous aux moments les plus imprévisibles, tels des esprits vengeurs instigateurs d’épidémies de révolte.
Tandis que pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, l’invisibilité a été une forme d’art fondamentale pour les pauvres et les faibles, ces derniers siècles ont vu l’invisibilité devenir la prérogative de quelques rares élus. Alors que tous sont forcés d’adopter des nomenclatures identitaires progressivement restrictives, la prédation corporatiste de haut niveau se produit de plus en plus dans l’ombre, à l’abri des regards. Le luxe de pouvoir se retirer derrière des enceintes fortifiées, des tours d’ivoire et des résidences sécurisées – exemptes des régulations sociales et des effets les plus délétères du marché – est devenu le marqueur de vraie richesse et de vrai pouvoir. Ironiquement, le niqab obéissait à cette logique très élitiste. Il a gagné en popularité parmi les populations arabes et centrasiatiques les plus riches pour distinguer leurs femmes des travailleuses du sexe qui seraient disponibles pour les soldats d’occupation européens. Pendant les années 1980, le hijab s’est frayé un chemin dans le cœur et dans la tête des ambitieuses classes moyennes urbaines, présenté comme objet conférant un statut exclusif et des avantages positionnels sur un marché du mariage saturé. Si les campagnes de dévoilement sont si importantes dans le regard européen, c’est parce que le voile reflète la logique du pouvoir de l’invisibilité des élites blanches, mais sous une forme monstrueuse.
« Persée se couvrait d’un nuage pour poursuivre les monstres », écrivait Marx. « [N]ous, pour pouvoir nier l’existence des monstruosités, nous nous plongeons dans le nuage entier, jusqu’aux yeux et aux oreilles. » Si les prédateurs chassent dissimulés dans la pénombre, la proie survit grâce à des stratégies de camouflage. Il n’est pas surprenant que les prédateurs dénigrent le camouflage autant que la conspiration comme manières futiles et primitives de leur gâcher la fête. Le voile est une stratégie adaptative de survie face à bien des prédations. La renonciation – stratégie visant à réduire délibérément les désirs et la consommation jusqu’à leur minimum le plus invisible – a été la seule stratégie politique écologique radicale du 21e siècle à avoir représenté une menace efficace pour la domination des entreprises. Au lieu de dénigrer le voile et de chercher à nier l’existence de dynamiques de pouvoir monstrueuses dans le monde, une politique progressiste devrait insister sur l’importance de l’invisibilité pour les masses vulnérables, et sur la transparence obligatoire pour les riches et puissants. Au lieu de lutter contre « l’homophobie en Palestine » en augmentant le contrôle policier et les incarcérations, luttons contre ses causes véritables : le militarisme causé par l’occupation israélienne, la famille patriarcale liée au maintien des rapports de propriété privée, la masculinité comme agression en raison des exigences du conflit de classe. La proie s’adaptera et perdra son camouflage lorsque les prédateurs seront neutralisés, lorsque des structures économiques seront mises en place qui empêcheront l’accumulation massive du capital et du pouvoir. Le livre d’Atshan n’est ni plus ni moins que la continuation de siècles de campagnes de dévoilement, le symptôme dégradé d’une politique néolibérale de la visibilité et de l’identité. Donc, plutôt que de nous plonger corps et âme dans les nuages, concentrons nos énergies politiques à lutter contre les très visibles monstres qui nous empêchent d’être la meilleure version de nous-mêmes.
Marc Aziz Michael enseigne la sociologie, les études du Moyen-Orient et les études de genre à l’American University de Beyrouth. Avant cela, il a enseigné à NYU et NYU à Abu Dhabi. En dehors du champ académique, ses écrits ont été publiés par Al Jazeera, Jadaliyya, The World Today, CounterPunch et OpenDemocracy. Il écrit actuellement un livre sur l’histoire du secteur des banques commerciales. Il consacre son temps libre à se former à la thérapie de groupe.
Notes
[1]N.d.t. : Le Pew Research Center est un think tank étasunien – publiant notamment des sondages.
[2]N.d.t. : Drag queen américaine.
[3]N.d.t. : Échanges d’insultes si violentes et personnelles qu’elles en sont comiques.

