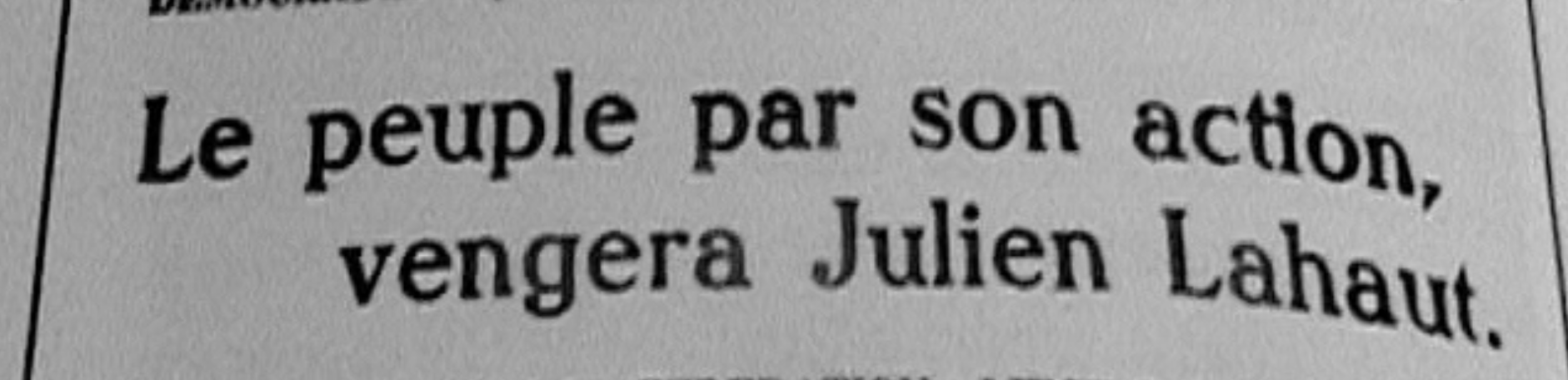Ce 18 août 2025, il y aura 75 ans que Julien Lahaut a été assassiné. Quatre balles d’une arme de fabrication américaine, un Colt 45, tirées à bout portant sur le pas de sa porte à Seraing, ont abattu le leader charismatique du mouvement ouvrier wallon. Julien Lahaut n’était pas seulement le Président du Parti Communiste belge, il en représentait l’âme militante, profondément nourrie par l’héritage de la révolution soviétique de 1917 et son internationalisme. Il faut relire la presse communiste des années 20 jusqu’au milieu des années 30, pour mesurer l’ampleur de la hargne qui animait alors l’anti-militarisme et l’anti-impérialisme des communistes de la première heure. Aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés à une situation de guerre impérialiste globale contre les peuples et dans l’urgence de refonder un anti-militarisme et un internationalisme conséquent, la vie et l’assassinat de Lahaut sont toujours en mesure de nous éclairer.
L’Enterrement du Soleil
Après son assassinat, le corps de Julien Lahaut a été veillé au Théâtre de Seraing par une foule innombrable. Ses camarades se sont relayés nuit et jour aux côtés de son cercueil. Entre 100 000 et 250 000 personnes, selon la police – et jusqu’à 500 000 selon d’autres sources – ont gravi la colline de Seraing jusqu’au cimetière des Biens communaux, pour y enterrer « celui qui avait le soleil dans sa poche ». Ce surnom, il le tenait du camp de concentration de Neuengamme où il laissait la messe être célébrée sur son lit. Dès le lendemain de l’assassinat, le Parti communiste belge lance des milliers de tracts dans les rues, concluant par ces mots : « Par son action, le peuple vengera Julien Lahaut ». Mais c’est l’inverse qui se produit. Dès septembre 1950, Camille Pholien, Premier ministre PSC, prend des dispositions formelles : le droit de grève est interdit dans les services publics et les communistes en sont exclus. Les agents de l’État et les fonctionnaires affiliés ou sympathisants à un groupement jugé subversif ou révolutionnaire sont écartés. La chasse aux sorcières commence. Après avoir été le fer de lance de la lutte pour la libération nationale face au nazisme – et avoir payé un lourd tribut avec la déportation et l’assassinat de leurs membres dans les camps -, les communistes avaient rejoint le gouvernement entre 1944 et 1947, portés par la reconnaissance populaire et la légitimité acquise dans la Résistance. Mais leur exclusion fut brutale. Leur leader est assassiné, ils sont désignés comme “ennemis intérieurs” et chassés de l’administration. La nouvelle union nationale se scelle sur cette mise à l’écart, comme l’expliquera brillamment l’historien José Gotovitch dans Du Rouge au Tricolore (Gotovitch, 2018).
Il y a quelque chose de pourri au Royaume de Belgique.
En 1985, les historiens Rudi Van Doorslaer et Étienne Verhoeyen identifient les cercles léopoldistes comme responsables de l’assassinat de Julien Lahaut. Selon eux, les commanditaires cherchaient à réinstaller Léopold III sur le trône et à instaurer un gouvernement d’extrême droite, dans un contexte de polarisation politique extrême. En 2002, un financement public est octroyé au CEGESOMA pour l’étude des 14 000 pages du dossier judiciaire… ou plutôt de la copie de la défense, l’original ayant été « malencontreusement » détruit dans les couloirs du tribunal de Liège. Cette nouvelle enquête aboutit à la publication, en 2015, de Qui a tué Julien Lahaut ? Les ombres de la guerre froide en Belgique, sous la direction d’Emmanuel Gerard, Françoise Muller et Widukind De Ridder (Gerard, Muller & De Ridder, 2015). Les auteurs replacent l’assassinat dans le contexte plus large de la guerre froide et de l’anticommunisme d’État, mettant en lumière l’existence d’un réseau anticommuniste et d’un service de renseignement privé créé à l’initiative du baron Paul Delaunoy, chapeauté par le holding Brufina et la Société Générale.
L’homme de main de ce réseau était André Moyen, ancien résistant de droite devenu barbouze. Il dirigeait le BACB (Bloc Anticommuniste Communiste Belge) et opérait à la fois depuis la métropole, via Milpol, et depuis le Congo, à travers le Réseau Crocodile, fondé en 1948 – comme l’a documenté l’historienne Anne-Sophie Gijs dans Le pouvoir de l’absent. Les avatars de l’anticommunisme au Congo (1920–1961) (Gijs, 2016). Le commando chargé d’assassiner Lahaut appartenait à ces réseaux.
Les historiens du CEGESOMA ont mis au jour un document clé dans les archives du ministre Camille Pholien – nommé à la tête du gouvernement deux jours avant l’assassinat de Julien Lahaut. Dans ce document daté de la fin août 1950, André Moyen évoque l’existence d’« une sorte de synarchie », disposant de relais jusque dans les services chargés de l’enquête sur l’affaire Lahaut. Il ne s’agit pas d’une organisation théorisée, mais d’un réseau informel d’influence, transversal et clandestin, mêlant anciens militaires, agents de renseignement, milieux économiques et hauts fonctionnaires. Ce qui frappe ici, c’est que la logique de ce réseau ne se heurte pas au pouvoir politique – elle s’y prolonge. Moyen y exerce une pression explicite pour que des mesures soient prises contre les communistes, ajoutant que le groupe d’action « poursuivra sa série jusqu’à ce que le gouvernement se décide à mettre fin lui-même aux agissements de la cinquième colonne soviétique. » On sait que Jean Terfve, député communiste et membre du Bureau politique du PCB, ainsi qu’Edgard Lalmand, secrétaire général du parti, figuraient parmi les cibles désignées. Les décisions prises par le gouvernement Pholien ne marquent pas une simple influence de l’ombre : elles traduisent une adhésion partielle, au sommet même de l’État, à la stratégie du Bloc anticommuniste belge (BACB).
75 ans après les faits, nous avons un non-lieu judiciaire faute de preuve et d’aveux, nous avons des preuves et nous avons la promesse d’une vengeance populaire par l’action qu’il nous reste encore à honorer.
Du Rif au Katanga : trajectoires d’un engagement communiste inachevé
Lorsqu’il est assassiné, Julien Lahaut est président du Parti communiste belge. Un titre essentiellement honorifique, mais chargé de sens : il incarne l’attachement profond que lui vouaient les milieux ouvriers et paysans wallons, pour qui il restait une figure de combat, proche et intègre. Cette popularité contrastait avec la méfiance croissante du secrétariat national, notamment d’Edgar Lalmand, secrétaire général, et d’Andor Bereï, représentant officieux de l’orthodoxie soviétique au sein du parti, souvent perçu comme « l’œil de Moscou » dans les arcanes du PCB. Anarcho-syndicaliste, antifasciste et antimilitariste convaincu, « Noss Julien » avait mené, en pleine occupation allemande, la grève des 100 000, obtenant une hausse salariale de 8 % - une concession exceptionnellement rare de la part des autorités allemandes dans l’Europe occupée. Déjà avant la guerre de 1914, dans sa fonction de secrétaire du syndicat Relève-toi, Julien Lahaut tenait des meetings de solidarité, par exemple avec des syndicalistes japonais menacés d’exécution. Plus tard, on le retrouve engagé dans l’action pour tenter de sauver Sacco et Vanzetti. Il mobilise sa base à l’appel de la IIIe Internationale pour s’opposer à la répression de la révolte anticoloniale d’Abdelkrim al-Khattabi dans le Rif marocain, incarnant ainsi les plus belles heures d’une Internationale communiste qui faisait de la lutte de libération nationale et de l’anti-impérialisme le fer de lance de sa stratégie révolutionnaire (Pirlot 2010).
L’historien José Gotovitch a bien synthétisé les différentes phases de la relation entretenue par le Parti communiste de Belgique (PCB) avec le Congo dans un article de 2019. Dès sa fondation, le PCB dénonce l’impérialisme esclavagiste belge . Lors de son IIIe Congrès, en 1926, il réclame « l’indépendance totale de la colonie. La liberté d’association sans limite des indigènes » (Gotovitch, 2019, p. 3). Une analyse approfondie du Drapeau Rouge, la presse communiste belge entre les années 1920 et 1935, révèle une activité intense en métropole dénonçant les intérêts conjoints des hommes politiques et des industriels, notamment l’engagement industriel et colonial du fondateur du POB, Édouard Anseele (ibid., p. 4)[1].
Pourtant, à partir de 1935, on observe un affaiblissement de cette ligne intransigeante : abandon progressif de la stratégie léniniste d’émancipation des peuples colonisés à la faveur de l’alliance avec les socialistes et le POB (Front Populaire), alignement sur la ligne stalinienne, et absence de stratégie claire sur le plan anticolonialiste à l’approche de la guerre. Cette évolution transparaît dans les colonnes du Drapeau Rouge, où se construit une véritable ligne de crête : comment continuer à défendre l’anti‑impérialisme historique du Parti tout en appelant à protéger le Congo d’Hitler ? Comment défendre face à l’agression fasciste un territoire que nos propres ennemis – industriels et hommes d’État belges – se sont approprié et ont organisé en colonie d’exploitation ? On retrouve cette tension dans les articles publiés par E. Stiers les 15 et 22 novembre 1938, au lendemain de Munich : ils alertent sur la menace d’Hitler sur le Congo tout en peinant à articuler cette défense avec une critique cohérente de l’ordre colonial. Cette contradiction traverse alors le Parti, sans qu’une position stable puisse être trouvée. Une analyse approfondie des questions parlementaires de l’époque, ainsi que du projet de loi déposé par Bosson, devra encore être effectuée pour comprendre ce moment crucial. On peut cependant déjà critiquer Stiers qui dans ses articles, opère un tri entre “bons” et “mauvais” indigènes lorsqu’il plaide pour l’amnistie de certaines relégations (Kibangistes, Kitawala, marins de Matadi…), reproduisant ainsi une hiérarchisation coloniale au moment même où il prétend consolider la défense du Congo.
Cette tension demeure la nôtre aujourd’hui, face à des mouvements sociaux puissants et organisés, les industriels et leurs relais dans l’État n’hésiteront jamais à financer l’entrée en guerre pour défendre leurs intérêts.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, entré en clandestinité, le PCB se concentre sur la Résistance en Belgique. Il évoque peu la question coloniale : « La disparition dans les camps des quelques militants qui s’étaient investis dans ce secteur contribue sans aucun doute à cette page blanche » (ibid., p. 7), écrit Gotovitch. Au sortir de la guerre, la question coloniale ressurgit avec force autour de l’uranium congolais, devenu un enjeu stratégique majeur pour les Alliés. Edgar Sengier, administrateur délégué de l’Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) – la filiale de la Société Générale de Belgique chargée de l’exploitation minière au Katanga – a déjà vendu aux Américains non seulement toutes ses réserves d’uranium entassées aux États-Unis, mais aussi celles du Congo belge. Il accepte également de rouvrir la mine de Shinkolobwe. Ces transactions se font à l’insu du gouvernement belge en exil à Londres (Barbé, 2014, p. 20-21).
Les gouvernements américain et britannique exigent alors de la Belgique qu’elle s’engage à leur livrer toute la production future d’uranium congolais. Les négociations sont longues et tendues. Un accord intergouvernemental est finalement paraphé le 6 septembre 1944, quelques jours avant le retour du gouvernement à Bruxelles. Il s’agit d’un contrat d’exclusivité de dix ans, conclu dans la plus grande discrétion. La Constitution imposant que le roi cosigne les traités, la question est politiquement sensible : Léopold III a répété dans son « testament politique » du 25 janvier 1944 qu’aucun engagement majeur ne pouvait être pris sans son accord. Les Britanniques et les Américains ne veulent pas prendre ce risque. Le 20 septembre, jour de la proclamation du prince Charles comme régent, un conseil des ministres secret est convoqué. Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères, y révèle l’existence de ce contrat à des ministres qui n’en avaient jamais entendu parler. Le gouvernement, confronté à une situation intérieure explosive -70 000 résistants encore armés, 8 000 gendarmes mal équipés, couvre-feu, problèmes alimentaires - entérine l’accord dans l’urgence (Barbé, 2014, p. 23-25).
Cet accord est antidaté pour éviter qu’il n’ait à être avalisé par le nouveau gouvernement qui allait compter trois ministres communistes. Ceux-ci auraient très probablement refusé de le signer, ce qui aurait déclenché une crise politique et révélé l’affaire à la presse. Le PCB entre au gouvernement quelques jours plus tard et y restera jusqu’en mars 1947, mais sans jamais réussir à remettre en cause cet accord ni à imposer un rapport de force sur la question coloniale.
Les modalités financières accentuent le caractère opaque du dispositif : les Américains paient directement l’UMHK, de façon à ce qu’aucune trace ne figure dans les documents douaniers du Congo belge. L’entreprise verse ensuite les sommes perçues sur un compte personnel de Pierre Ryckmans, gouverneur général du Congo belge (1934-1946), puis futur commissaire à l’énergie atomique. Seul le premier président de la Cour des comptes peut consulter ce compte. À l’autre bout de la chaîne, la Constitution américaine interdisant de tels engagements à long terme, les versements sont effectués depuis un compte personnel du général Groves, chef du projet Manhattan. Il s’agit là d’une architecture financière entièrement hors cadre légal (Barbé, 2014, p. 25-27).
Cerise sur le gâteau, les contrats conclus entre l’UMHK et les Américains ne portent pas sur le minerai brut mais sur l’oxyde d’uranium extrait. L’UMHK garde les résidus, qu’elle rapatrie en Belgique, notamment sur le site d’Olen, où des montagnes de déchets radioactifs s’accumulent encore aujourd’hui. Et, paradoxalement, la même UMHK a vendu des quantités importantes de minerai d’uranium à l’Allemagne nazie pendant la guerre, avant que l’affaire ne soit étouffée après 1945 (Barbé, 2014, p. 31-33).
Au moment où il est encore au gouvernement, le PCB tente de reprendre la main. Dès 1947, il propose la nationalisation de l’uranium congolais, avec l’objectif d’arracher ce secteur stratégique aux mains de l’UMHK et des Américains (Barbé, 2014, p. 38 ; Gotovitch, 2019, p. 8). Cette revendication s’inscrit dans la continuité de ses positions sur la nationalisation des grands secteurs économiques : elle se veut une réaffirmation de la souveraineté belge sur ses ressources stratégiques.
Mais cette position porte en elle la même ambivalence observée avant-guerre. Elle n’est pas formulée comme une solidarité avec les luttes de libération congolaises, mais comme une mesure de défense nationale : il s’agit de protéger “notre” uranium congolais de la mainmise américaine.
Ce repositionnement laisse le PCB vulnérable : le PSB et le PSC, soucieux de préserver l’appui américain dans le contexte de guerre froide, s’opposent frontalement à la nationalisation. En mars 1947, le PCB est écarté du gouvernement et entame une période de marginalisation politique. Entre 1946 et 1949, il conserve encore 23 députés et 17 sénateurs, mais il est affaibli par la montée de l’anticommunisme.
Ce n’est pas un simple « vide stratégique », mais un dispositif structuré et verrouillé. Marginalisé dès 1947, le PCB se trouve confronté à un réseau anticommuniste efficace, transformant toute critique du colonialisme en « menace rouge ». André Moyen, agent du service militaire belge (2ᵉ section EMGA)¹(Debruyne 2017, 87‑100) – le service de renseignement de l’État‑Major Général chargé de traquer l’« ennemi intérieur », dont les agents, officiers de police judiciaire auxiliaires, peuvent réquisitionner l’armée et contrôler gendarmerie et police – coopère pendant la guerre avec l’OSS américain (Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA), puis fonde au Congo le réseau « Crocodile », alliant renseignement, propagande et influence. Moyen agit en partie par conviction anticommuniste, mais ses réseaux sont soutenus et financés par des acteurs capitalistes majeurs : la Société Générale de Belgique, l’Union Minière du Haut‑Katanga (UMHK, filiale de la Générale) et la Brufina². L’anticommunisme devient ici un véritable instrument de gestion des intérêts économiques. Ces groupes apportent un soutien financier et logistique — notamment un bureau à Bruxelles — et utilisent le réseau pour surveiller syndicats, cadres congolais et tout élément jugé « suspect ». Une logique de renseignement privé s’installe, au service d’un capitalisme soucieux de se prémunir contre toute contestation. Dans ce contexte, l’anticommunisme devient un outil de verrouillage politique, légitimant surveillances, répressions et exclusions, tout en servant une logique économique : sécuriser le cuivre et l’uranium congolais au profit de l’ordre impérial.
Cette infrastructure d’intérêts financiers, de renseignement et de répression idéologique — véritable « État profond » colonial et intérieur, qui protège minerais et empire tout en fabriquant l’ennemi intérieur, racialisé ou transbordé dans la « cinquième colonne » dès qu’il en conteste les intérêts — produit le climat de l’assassinat de Julien Lahaut en 1950. Elle assure la protection d’André Moyen, bien qu’il soit expulsé du Congo la même année avec son réseau, pour ses activités de renseignement incontrôlées. Cantonné à la Belgique, il continue d’agir dans un espace où les frontières entre l’informel et l’institutionnel restent poreuses. Soixante-quinze ans plus tard, cette configuration nous laisse face à un non-lieu.
L’assassinat de Lahaut, effet boomerang du colonialisme
La guerre avait brisé la cohérence stratégique et anti-impérialiste des années 1920, celle d’un internationalisme qui liait intimement le sort des militants et des classes populaires de la métropole à celui des populations colonisées, soumises au même État central. Cette rupture s’amorce déjà, en creux, dans les compromis du Front populaire, où l’antifascisme l’emporte sur la critique de l’empire. Ces faits nous obligent à relire nos passés et nos défaites à l’aune des logiques de contre-insurrection et de l’effet boomerang colonial.
Dans La guerre globale contre les peuples (La Fabrique, 2025), Mathieu Rigouste cartographie cette mécanique impériale : tandis qu’elle exportait des formes de féodalités dans les colonies, la configuration coloniale n’a jamais cessé de réimporter en métropole ses savoir‑faire, ses agents et ses « composants culturels, idéologiques et organisationnels », forgés dans les guerres de conquête et réagencés pour réprimer les classes populaires (Rigouste, 2025, p. 20). C’est ce que Césaire nommait dès 1950, dans Discours sur le colonialisme, le « choc en retour » et l’« ensauvagement » de l’Europe coloniale.
Dès 1949, ces savoir‑faire contre‑insurrectionnels sont redéployés sur la « subversion communiste » en métropole. Le continuum impérial passe alors sous contrôle d’un dispositif militaire et diplomatique transatlantique dominé par les États‑Unis (Rigouste, 2025, p. 79). La technique du stay‑behind, inspirée des unités britanniques Jedburgh, structure des réseaux dormants dans la plupart des États européens. Ce sont précisément ces commandos – comme l’a établi l’enquête du CegeSoma – qui ont assassiné Julien Lahaut. Rigouste rappelle aussi que certains cadres du SOE, futurs formateurs des équipes Jedburgh, avaient forgé leur expérience opérationnelle en Palestine et en Égypte : les guerres coloniales ont ainsi directement nourri la répression des classes populaires européennes.
Où est le peuple qui vengera Lahaut ?
La Wallonie portait pourtant en elle un rêve. De toutes les collines, de toutes les plaines, de toute l’Europe, les dépossédé·e·s étaient venu·e·s s’y loger, dans des baraquements de fortune. Notre langue, le wallon, domestiquée à coups de représailles physiques par la culture philanthropique et l’école, charriait le grec, l’arabe, le polonais, l’italien… dans une même langue commune, impétueuse, indomptable et digne. Beaucoup, depuis la mine et les usines, incarnaient en chair et en os l’Internationale. Ils avaient lutté dans leur pays d’origine avant de lutter ici, en Wallonie.
Ce rêve s’est mué en cauchemar. La Wallonie qui chantait l’Internationale s’est tue.
Elle est devenue aujourd’hui le principal exportateur d’armes de Belgique.
La Wallonie de Lahaut est devenue un nœud logistique et productif de la guerre mondialisée : elle abrite non seulement FN Herstal, mais aussi Spatz, filiale d’Israel Aerospace Industries, qui permet à Israël de contourner les embargos pour exporter vers des États arabes. Thales, Forges de Zeebrugge, John Cockerill, Clermont tissent un maillage serré entre énergie, automatisation, munitions, roquettes, tourelles.
Ce complexe militaro‑industriel nourrit directement les conflits internationaux – Gaza compris. Ce n’est pas une “industrie d’excellence” : c’est une industrie de la mort, assumée, régionale, soutenue par les gouvernements successifs.
Nous fabriquons les armes qui assassinent les peuples que nous prétendions défendre.
Ce basculement n’est pas seulement technologique ou économique. Il est idéologique. La fin de l’Internationale communiste, en 1943, et l’abandon progressif de l’anti-impérialisme comme ligne centrale nous furent fatals. Ce retrait s’enracine dans un tournant plus ancien : la politique de Front populaire initiée par l’Internationale dès 1935, qui plaçait l’alliance antifasciste au-dessus de la solidarité révolutionnaire avec les peuples colonisés. C’est là que se joue le renversement des priorités stratégiques : au nom de l’unité antifasciste, on enterre l’internationalisme radical des années 1920.Nos rêves de lointain se sont racornis dans le cadre national et sous la tutelle des industriels.La chasse aux sorcières fut insidieuse et brutale.
Les crimes du stalinisme firent le reste, instillant la honte dans les esprits et dans les corps.Nous vivons enfermés dans la séquence atlantiste, confondant depuis 75 ans libération et libéralisme.Le sang de Lahaut nous rappelle que nous ne sommes ni victorieux, ni libres.Nos solidarités et notre humanité se sont étiolées avec l’entrée dans cette nouvelle modernité « après‑guerre ». De façon fragmentée, sans ligne claire, il y eut bien la solidarité avec les Béninois, les Chiliens… Mais plus que jamais, nous étions en minorité.La politique s’était « ONGénisée ». Dans les années 1980, la fin progressive de la pilarisation – ce système qui organisait la société belge en blocs idéologiques cohérents, dotés de leurs propres syndicats, journaux, mutuelles, écoles – a laissé place à un nouvel encadrement moral : celui d’organisations non gouvernementales et d’acteurs internationaux prétendument neutres, qui redéfinissent les cadres de la légitimité politique sans enracinement populaire ni conflictualité historique.
La fin de l’Histoire, en quelque sorte. Une vie et une mémoire populaires, atomisées, réduites à des non-lieux. Nous n’avons pas encore affronté notre impuissance.
Simon Assun, militant juif décolonial et cofondateur du collectif Tsedek!, un espace antisioniste et antiraciste fondé en France pour « briser le discours promu par les institutions juives censées nous représenter », nous rappelait avec une immense justesse, lors de l’Université Décoloniale à Pantin, que c’est justement cette impuissance‑là qu’il nous faut politiser : la reconnaître comme point de départ à l’élaboration d’une stratégie – non pour s’y résigner, mais pour construire, depuis elle, une force commune. 75 ans après les faits, nous devons reconnaître que nous avons été impuissants à accomplir la promesse de Venger Lahaut par l’action du peuple.
C’est pourtant d’elle, peut‑être, que pourra recommencer la perspective lointaine de la reprise du rêve, malgré l’horreur historique – dans l’esprit de ce que Frédéric Neyrat appelle un « communisme du lointain ». Ce rêve n’est pas un horizon abstrait : il consiste à tenir ensemble la mémoire des vaincu·e·s et les luttes du présent.
Ce rêve, que nous avions cessé de nommer – hypnotisé·e·s par les privilèges de la modernité occidentale – renaît dans les luttes décoloniales et antiracistes matérialistes, forgées dans les quartiers, les solidarités anti‑colonialistes, et la dénonciation des crimes policiers. La présence en métropole des enfants issus de l’immigration post‑coloniale est une chance, une aubaine – si et seulement si nous savons nous souvenir de qui nous sommes. L’intransigeance du mouvement décolonial rouvre en Belgique une perspective politique que nous avions laissée mourir. C’est à travers lui que le rêve de Lahaut – celui d’une fraternité des peuples, d’une lutte des opprimé·e·s par-delà les frontières – recommence à s’écrire.
Le peuple qui venge Julien Lahaut existe. Il tentait il y a quelques mois d’entrer en Palestine avec les convois par Rafah. Il est sur les bateaux qui voguent pour Gaza.
Il est debout face à l’armée égyptienne et israélienne, debout à la Bastille, à la Bourse de Bruxelles, et dans les rues de toutes les capitales européennes.
Il vit dans la sueur et les bras croisés des dockers qui stoppent les livraisons d’armes. Il s’oppose à la colonisation, à l’apartheid, au nettoyage ethnique. Il défend le droit à la résistance armée. Il est aux côtés des familles de Fabian, Lamine, Sabrina, Ouassim, Jozef, Mehdi, Adil, Sourour, Mohamed, Ilyes, Mawda, Isaac…[2] tous et toutes tué·e·s par la police entre 2017 et 2025.
Il dénonce la complicité des États européens et de la Belgique, qui continue d’entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec des États génocidaires. Il affronte le relativisme moral des grands médias et, ce faisant, renoue avec le rêve internationaliste et anti-impérialiste.
Venger Lahaut, c’est faire ce que Walter Benjamin appelait dans ses Thèses sur le concept d’histoire : « s’emparer d’un souvenir tel qu’il apparaît en un éclair à l’instant du danger. » (Thèse VI) Et le danger, aujourd’hui, est partout. Il est dans l’anéantissement des traditions vivantes par la culture de masse, dans notre incapacité à réagir face au génocide en cours à Gaza, dans les commémorations tièdes et muséales, et dans l’oubli programmé. Nous devons arracher Lahaut à la tradition figée et au conformisme, et tenter de rallumer dans le passé l’étincelle d’espérance. Même mort, Lahaut n’est pas en sécurité si l’ennemi est vainqueur. Et cet ennemi, aujourd’hui comme à l’époque de Benjamin, n’a pas cessé de vaincre.
Julie Jaroszewski
Assun, Simon. 2024. Intervention lors de l’Université Décoloniale, Pantin, été. Notes personnelles.
Barbé, Luc. 2020. La Belgique et la bombe. Du rêve atomique au rôle secret dans la prolifération nucléaire. [En ligne] : https://etopia.be/books/la-belgique-et-la-bombe/
Benjamin, Walter. 2000. Sur le concept d’histoire. In Œuvres III, trad. Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch. Paris : Gallimard, coll. « Folio essais ».
Césaire, Aimé. 1950. Discours sur le colonialisme. Paris : Présence Africaine.
Debruyne, Emmanuel. 2017. « Invasion 40 – La Belgique face à ses “ennemis de l’intérieur”. Entre peur et impuissance ». In La Belgique docile, 87‑100. Villeneuve‑d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.
[En ligne] : https://books.openedition.org/septentrion/7348?lang=en
Gerard, Emmanuel, Françoise Muller et Widukind De Ridder. 2015. Qui a tué Julien Lahaut ? Les ombres de la guerre froide en Belgique. Waterloo : Renaissance du Livre.
Gijs, Anne‑Sophie. 2016. Le pouvoir de l’absent. Les avatars de l’anticommunisme au Congo (1920–1961). Bruxelles : Peter Lang Verlag.
Gotovitch, José. 2018. Du rouge au tricolore : les communistes belges de 1939 à 1944. Un aspect de la résistance en Belgique. Bruxelles : Éditions CArCoB. – 2019. Agir à travers un cordon sanitaire : le Parti Communiste de Belgique et le Congo. Bruxelles : CArCoB. [En ligne] : http://www.carcob.eu/IMG/pdf/pcb_et_congo_jg-2.pdf
Löwy, Michael. 2018. Avertissement d’incendie. Une lecture des thèses “Sur le concept d’histoire” de Walter Benjamin. Paris : Éditions de l’Éclat.
Neyrat, Frédéric. 2022. Le cosmos de Walter Benjamin. Un communisme du lointain. Paris : Éditions Kimé.
Pirlot, Jules. 2010. Julien Lahaut vivant. La Louvière : Éditions du Cerisier.
Rigouste, Mathieu. 2025. La guerre globale contre les peuples. Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire. Paris : La Fabrique.
Tsedek! 2024. Manifeste fondateur. [En ligne] : https://tsedek.org (consulté en juillet 2025).
Van Themsche, Guy. 1989. « Des caisses d’épargne régionales à Coop‑Dépôts ». In Histoire de l’épargne sociale à travers l’évolution de la banque d’épargne Codep et de ses prédécesseurs, éd. Els Witte et René De Preter, 171‑294. Bruxelles : Labor.
[1]Depuis 1927, la Compagnie de la Ruzizi exploite une plantation de coton de 20.000 ha qui pratique le travail forcé et la BBT participe à différentes entreprises coloniales. L’effondrement de la Banque socialiste gantoise en 1934 révèlera l’étendue de l’engagement industriel et colonial menée sous la férule du fondateur du POB, Edouard Anseele. Guy Van Themsche, Des caisses d’épargne régionales à Coop-Dépots in Els Witte & René De Preter (Dir), Histoire de l’épargne sociale à travers l’évolution de la banque d’épargne Codep et de ses prédécesseurs, Bruxelles , Labor, 1989, pp 171- 294. (cité par Gotovitch 2019 )
[2]Liste établie notamment par le site Bruxelles Panthères : https://bruxelles-panthere.thefreecat.org/