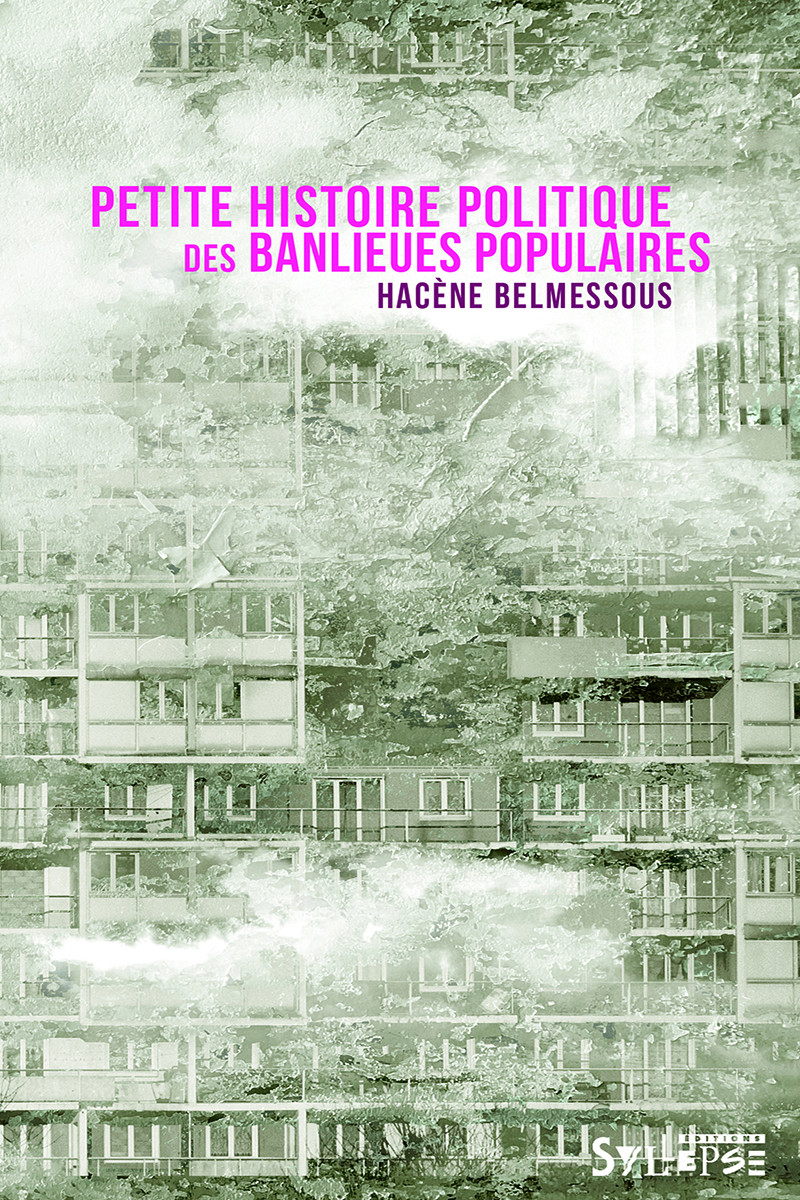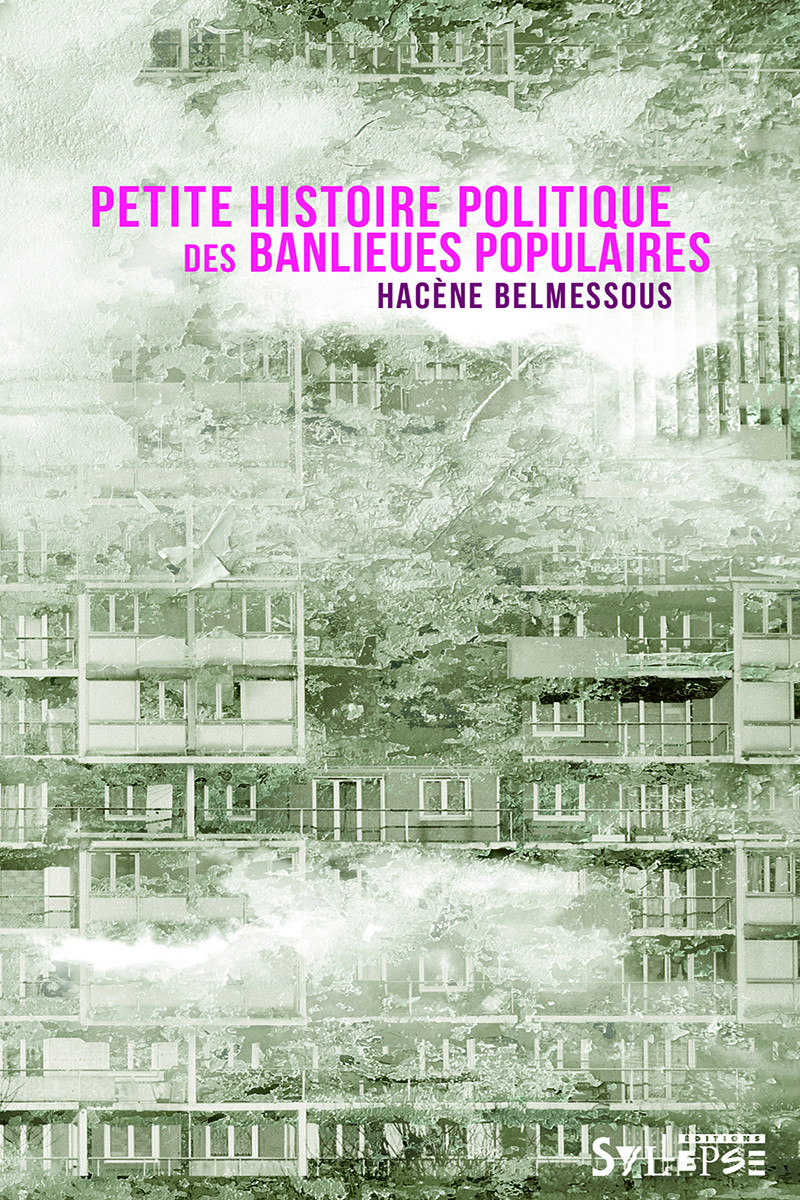Nous avons le plaisir de publier en exclusivité un extrait du livre « Petite histoire politique des banlieues populaires » de Hacène Belmessous
Avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse.
La police, un État dans l’État
La police n’est pas un acteur social ordinaire dans les quartiers populaires. La nature de son rôle, en charge de cette fonction régalienne qui en fait le garant de la sécurité publique, a muté au mitan des années 1990 lorsque l’État a reconsidéré son action dans ces lieux. Après la figure de l’État social qui a orienté les politiques publiques entre 1975, avec l’instauration de la première phase de la politique de la ville, et les années 1990, le pacte de relance pour la ville a introduit en 1996 la sécurité comme modalité centrale de sa politique dans les banlieues populaires. Depuis ce renouvellement de l’appareillage idéologique de la politique de la ville, opéré sous un gouvernement de droite – Alain Juppé était le Premier ministre de Jacques Chirac – l’institution policière s’est totalement émancipée de la tutelle de l’État dans les banlieues populaires. Elle ne remplit plus ses missions régaliennes, son rôle étant désormais illimité, puisqu’outre le fait qu’elle expertise les opérations d’urbanisme – la rénovation urbaine vise d’abord à reconfigurer architecturalement les quartiers d’habitat social de manière à faciliter les interventions des forces de l’ordre – elle y agit à sa convenance : un État policier fort face à un État social aux moyens réduits. La police des banlieues populaires s’est intronisée en agent de cohésion sociale de la vie de ces lieux. Elle contient les influences de toutes les institutions publiques (école, services sociaux, bailleurs sociaux, etc.) dans les limites du pouvoir qu’elle s’est arrogée, multipliant les pressions externes sur le gouvernement, et internes sur les élus locaux et les administrations locales, imposant ses formes de régulation dans certains arbitrages politiques et le contrôle de la vie sociale des habitants. Les différents gouvernements ont tant cédé à ses exigences que la police y concentre désormais entre ses mains tous les pouvoirs : sécuritaire, social, politique, juridique, moral, normatif. Sans conteste, cette dérive témoigne d’une terrible régression démocratique dans les quartiers populaires. Cette police d’« hommes à tout faire » n’a plus de correctif dans l’évaluation de son action. Elle est puissante et entend le rester. Ainsi, quand la justice ou les associations critiquent ou dénoncent certains de ses modes opératoires, elle fait aux gouvernants le chantage de la défection : « Si on n’a pas tous les moyens d’y intervenir, les voyous vont gagner » ; ou sa variante plus offensive, « Si on échoue, ce sera la guerre civile en France ». Dans un contexte de tensions sociales, de surenchère sécuritaire et de menaces terroristes, la possibilité qu’elle ne soit pas entendue est évidemment minime. Ce remplacement progressif d’un espace démocratique régulé par la société civile par un environnement social dominé par le contrôle policier a créé les conditions d’une omnipotence policière. Certes, tous les policiers ne sont pas des militants de la théorie de l’ennemi intérieur mobilisé dans les banlieues populaires, il n’en reste pas moins que ce qui caractérise l’action d’une part importante d’entre eux, c’est une volonté d’en découdre avec le monde fantasmé des « jeunes des cités ».
Cela fait bientôt trente ans que le corps policier cherche à convaincre la doxa que « les cités [leur sont] interdites[1] ». Inévitablement, le renoncement de l’État à instaurer du droit commun, comme à lutter efficacement contre le traitement différencié de ces habitants en matière d’accès au logement, à l’emploi ou à la culture, a facilité la diffusion du dogme policier, quand les avertissements des associations et des collectifs habitants sur les conséquences inquiétantes de cette mainmise policière étaient réduites à l’état d’incantations. Cette reconfiguration de l’espace public des banlieues populaires selon les normes produites par la police s’est évidemment faite aux dépens de leurs habitants. Surveillés et punis, pour paraphraser le philosophe Michel Foucault, ces individus mènent une existence sociale ajustée par les différentes validations policières dont les contrôles d’identité représentent la forme la plus légitimée de cette emprise disciplinaire.
des policiers impunis
Lorsque le projet d’une Marche pour l’égalité et contre le racisme fut enclenché en avril 1983, deux ans après les premières révoltes sociales dans les quartiers populaires de l’est lyonnais, un des éléments structurant cette mobilisation était le rejet des pratiques policières. Les jeunes de ces quartiers ont en effet dès l’origine critiqué l’action de la police dans ces lieux en pointant le fait qu’elle reposait sur des fondements violents et ne reposait sur aucune légitimité. Cette accusation ne tenait pas d’une conviction antiflics a priori mais se construisait sur une expérience incontestable. Dans la France de la « nostalgérie », le statut de l’immigré arabe, puis celui de ses enfants, devenus français puisque nés sur le territoire national, suggérait dans la conscience nationale une hiérarchie des conditions.
Depuis le début des années 1970, les ratonnades, ces expéditions expéditives qui les ciblaient, s’étaient banalisées sur le territoire national, contribuant à intensifier la violence de la racialisation des rapports sociaux entre Français et Arabes. En outre, en dépit du vote de la loi du 1er juillet 1972 contre le racisme et les discours de haine, il régnait dans la société française une forme d’euphémisation sociale du racisme. Les victimes n’étaient pas seulement les travailleurs immigrés, des jeunes nés en France étaient également visés.
Afin de contextualiser la marche civique partie de Vénissieux, il n’est pas inutile de recenser ici quelques-uns de ces crimes qui eurent pour cadre l’aire urbaine qui englobe Vénissieux. Le 14 juin 1980, à Caluire, Kaddour Mammad, 17 ans, était descendu à coup de 22 long rifle par un homme qu’il avait croisé dans la cité en raccompagnant un copain. Le 10 juillet 1981, à Vaulx-en-Velin, Daniel Zanouda, 19 ans, était tué par un retraité. En octobre 1982, à Lyon, Norredine Babas était surpris en flagrant délit de vol. Un policier lui tirait dessus, arguant lors de son audition qu’il lui avait intimé de lever les bras mais que le jeune homme avait refusé d’obtempérer. L’Inspection générale des services classa l’affaire sans suite, le juge d’instruction rendant une ordonnance de non-lieu en juillet 1987, quand le jeune homme était condamné à vingt mois de prison pour vol. Le 22 octobre 1982, à Lyon, Wahid Hachichi, 16 ans, était tué d’une balle par le propriétaire d’une voiture au motif qu’il tournait autour de sa voiture. Le 6 novembre 1982, toujours à Lyon, Mohamed Abidou était tué par un inspecteur de police qui se défendit en arguant qu’il avait agi ainsi car il avait été pris à partie par deux Arabes, et qu’il n’avait fait que se défendre. Le policier ne fut jamais jugé. Le 18 juin 1983, aux Minguettes, Toumi Djaïdja, 20 ans, était grièvement blessé au ventre par un policier qui avait lâché son chien sur un jeune de la cité ; Toumi Djaïdja voulait s’interposer quand il reçut cette balle. Le policier plaida l’agression et l’accident[2].
Si l’on tire du fil de ces manifestations racistes une activité policière caractérisée par des interventions sans « juste mesure républicaine », le constat est sans appel : une frange substantielle du corps policier avait déjà basculé dans des pratiques moralement condamnables et psychologiquement insupportables pour les populations ciblées. Des résistances se sont pourtant maintes fois fait entendre au sein du corps policier. En octobre 1974, les inspecteurs de police membres de la section parisienne de la CFDT « se désolidarisent avec la plus extrême vigueur d’un comportement qui déconsidère encore un peu plus la police », affirmant que « des ratonnades de cette violence sont rendues possibles par le racisme latent qui gangrène le corps policier, bien souvent entretenu par ceux qui voudraient refaire leur guerre d’Algérie[3] ». Nous pensons également à cette tribune publiée dans la presse nationale en 1979 et qui suggérait en creux quel corps délictueux cette institution « républicaine » était devenue :
L’impunité est la règle, le silence est la loi à tous les étages des hiérarchies policières et judiciaires. […] Une société démocratique ne peut durer avec un appareil policier enfermé dans un ghetto qui le place entièrement dans la main du pouvoir, le laisse sensible aux pires tentatives de la violence et avec une justice complice s’enfonçant dans le déshonneur[4].
À entendre un des premiers soutiens actifs de la Marche en 1983, l’homme d’Église Christian Delorme, l’impératif d’une police républicaine et le refus de se soumettre à sa discipline forcée et humiliante furent un des moteurs de cette mobilisation de l’automne 1983 :
Il faut se rappeler que déjà en mars 1983, des jeunes du quartier Monmousseau, aux Minguettes, avaient fait une grève de la faim qui avait duré quatorze jours pour alerter l’opinion publique et politique sur l’usage excessif de la force par la police. Un climat d’extrême violence dominait la vie de la cité. On ne comptait pas les morts violentes de jeunes, et le fait que la justice libérait assez vite les auteurs de ces morts était intimement mal vécu par ces jeunes. S’ils avaient cessé leur grève de la faim sur la promesse politique qu’ils seraient entendus, les incidents liés à la police n’avaient ensuite pas cessé. Des jeunes continuaient d’être maltraités par la police et la balle reçue par Toumi Djaïdja fut vécue comme le fait divers de trop[5].
des contrôles d’identité arbitraires
L’emprise policière sur les habitants des quartiers populaires se mesure à l’aune de cette modalité d’action qui lui est conféré par des textes de loi : le contrôle d’identité, par exemple, est souvent mis en œuvre autoritairement en débordant les dispositions légales proprement dites pour pérenniser sa domination symbolique sur la vie des habitants de ces quartiers.
Lorsque la gauche arrive au pouvoir en mai 1981, elle était attendue sur cette question sensible. Alors que la loi « sécurité et liberté » d’avant mai 1981, n’intervenait que pour réglementer les contrôles dans les cas de vide juridique, la loi du 10 juin 1983 était supposée marquer une évolution démocratique en codifiant ces contrôles. En neutralisant la dimension arbitraire du contrôle d’identité, le législateur définissait une norme éthique dans cette procédure. Ainsi que le notait alors un document de l’École nationale supérieure de police, « c’est en fonction des apparences qui se présenteront à lui et l’interprétation qu’il en donnera, que le policier procédera éventuellement à une mesure de contrôle d’identité ». Et les auteurs du document de préciser cyniquement qu’« en réalité, une attitude, un comportement, une façon d’être dans un certain contexte, peuvent être perçus comme un indice. L’exercice de ces actes de police judiciaire n’est d’ailleurs soumis à aucune autorisation préalable des magistrats du parquet qui vérifieront “a posteriori” la légalité des conditions de l’intervention. Comment pourrait-il en être autrement, puisque la perception de l’indice ne peut être le fait que de celui qui est “en situation”. Permettre au policier de l’analyser revient en définitive à s’en remettre à sa sagacité[6] ». Or, en laissant en toute conscience à l’appréciation policière la validité du contrôle d’identité, le gouvernement socialiste revenait sur ses premières intentions, légitimant le postulat que la culpabilité immanente restait du côté des populations ciblées par la police. En clair, la probabilité d’un abus de pouvoir policier est bien moindre que le « problème » posé par les jeunes des quartiers d’habitat social. Ces contrôles a priori étaient pourtant substantiellement partiaux, autrement dit, au faciès. Il importe dès lors de s’interroger sur le renoncement de la gauche à neutraliser la mainmise policière sur l’existence sociale de ces jeunes. Il faut ici écarter d’emblée l’idée que le corps policier manipulait le pouvoir socialo-communiste en se fabriquant dans les banlieues populaires des espaces de souveraineté qui lui étaient invisibles. Ces communes étaient en effet massivement gérées par des élus issus de cette même gauche.
Lorsque l’est lyonnais se révolta durant l’été 1981, il était autant gouverné par des maires socialistes que par des maires communistes. Ces élus étaient en outre parfaitement informés des pratiques déviantes de la police sur leur territoire. Seulement, déjà à cette époque, les discours prophétiques sur la menace à venir d’une « guerre civile dans les banlieues » et l’aspiration policière à y intervenir à sa guise pour y faire valoir « son » ordre opéraient dans la société française.
Dans ce contexte, la contestation par la gauche du monopole policier sur la vie quotidienne des banlieues populaires, et de cette arme symbolique qu’est l’usage de l’arbitraire des vérifications d’identité, était limitée et inaudible. Ainsi, quand le député socialiste de l’Allier, Jean-Michel Belorgey, président par ailleurs de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, appelait à « une exigence éthique et déontologique » de l’action de la police. Son vœu, au demeurant assez isolé, resta lettre morte et il regrettera plus tard que :
La police constitue à n’en pas douter, pour cette couche particulière de la population qui a contre elle à la fois la jeunesse et la couleur ou des signes extérieurs qui lui sont apparentés, une incontestable source d’insécurité quand bien même elle ne se trouverait pas placée dans une situation qui l’expose naturellement à la douteuse sollicitude des représentants de l’ordre : la délinquance, les situations irrégulières du point de vue du séjour. Les jeunes d’origine étrangère ou réputée telle sont, plus d’autres groupes sociaux, victimes des bavures policières, pour le moins de contrôles d’identité musclés. C’en est même tellement évident qu’il paraît étrange de se demander pourquoi. […] Point n’est en effet besoin aux policiers, même si cela leur arrive parfois, de se prendre pour les sauveteurs inspirés d’une société mise en péril par le laxisme de ses responsables, pour que la jeunesse d’origine étrangère leur apparaisse sous le jour d’une sorte de gibier[7].
À ces dérives de la culture policière de l’impunité dans les banlieues populaires, Jean-Michel Belorgey tenta durant des années de les neutraliser. Dès l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, il poussa à la création d’une structure indépendante de surveillance de la déontologie policière. Ce Conseil supérieur de l’activité de la police nationale vit le jour le… 16 février 1993, un mois avant des élections législatives que la gauche savait perdues. Au reste, à peine nommé ministre de l’intérieur dans le gouvernement Balladur, Charles Pasqua mit fin à sa brève existence. La droite n’en voulait pas, la gauche avait bloqué sa mise en place. « Manifestement, l’ambition d’assurer une transparence suffisante de l’activité policière ne faisait pas l’affaire du pouvoir et d’une fraction de la hiérarchie. La partie du rapport consacrée à la commission d’information sur les activités des services de police est une de celles que, dès le printemps 1982, le ministre de l’intérieur se déclarait publiquement décidé à tenir pour non avenue », écrira Jean-Michel Belorgey dans un texte testamentaire[8].
Si les partis de droite ont toujours légitimé l’action de la police et ses modes d’opérer comme condition nécessaire de ses performances et de son efficacité en matière de maintien de l’ordre, ce que l’ancien ministre de l’intérieur Charles Pasqua avait théorisé d’une formule obscène – « on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs[9] » – il faut pourtant s’interroger sur le rôle ambigu de la gauche de gouvernement.
[1] . Rapport des commissaires du syndicat SCHFPN, La cité interdite ?, 1995.
[2] . Ces informations ont été puisées sur le site http://quefaitlapolice.samizdat.net.
[3] . Voir Le Monde, 14 octobre 1974.
[4] . Michel Marcus, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, et Bernard Deleplace, secrétaire général adjoint de la Fédération des syndicats de police, Le Monde, 11 octobre 1979.
[5] . Entretien avec l’auteur.
[6] . École nationale supérieure de police, Contrôles et vérifications d’identité, DFEP, Centre de documentation et d’information de la police nationale, septembre 1985.
[7] . Jean-Michel Belorgey, « Les jeunes d’origine étrangère », Hommes et Migrations, n° 1127, décembre 1989.
[8] . Jean-Michel Belorgey, « De profundis… Vie et mort d’un “conseil moignon” de déontologie policière », Plein Droit, n° 21, juillet 1993.
[9] . Cette phrase fut prononcée le 5 mai 1988 dans le journal de 13 heures d’Antenne 2 après l’intervention des forces de police lors d’un raid dans la grotte d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie où des indépendantistes kanaks avaient retenu des militaires en otage. Dix-neuf Kanak et deux militaires trouvèrent la mort lors de cet assaut.
Petite histoire politique des banlieues populaires
Collection : « Arguments et mouvements »
Auteur-e : Hacène Belmessous
Parution : Mars 2022
Pages : 200
Format : 115 x 190
ISBN : 979-10-399-0021-8
Présentation
L’histoire récente des banlieues populaires demeure un terrain en grande partie délaissé et inexploré. Pourtant, ces lieux concentrent depuis plusieurs décennies tous les débats, toutes les polémiques, toutes les fractures qui témoignent d’une société française qui ne sait pas comment aborder ces quartiers de relégation où dominent la pauvreté et la ségrégation.
Cet ouvrage s’efforce de décrire et analyser ce qui s’y est joué durant cette période en abordant de façon incisive une série de questions : la police, le logement social, l’islam, la politique de la ville, les politiques conduites dans ces quartiers. Pour cela, l’auteur s’est appuyé sur des archives locales de communes emblématiques, des documents pour certains étonnamment souvent jamais consultés, et sur des entretiens avec des personnages de l’histoire urbaine récente.
Revenir sur l’histoire politique de ces quartiers, de ces villes, de ces banlieues c’est aboutir à ce constat implacable: la République, dans les banlieues populaires, c’est pour leurs habitants quarante années d’humiliations sociales.