« Emilia Perez », le film de Jacques Audiard, se porte bien : récompensé au printemps dernier au festival de Cannes, en janvier aux Golden Globes, en février aux Césars et en mars aux Oscars. Encensé par la critique et ayant rencontré un certain succès commercial, la production française a pourtant fait l’objet d’une importante contestation populaire au Mexique. Celle-ci est bien résumée dans un récent article du journal Mediapart, qui regroupe différentes analyses pointant le l’européocentrisme, voire le racisme du film.
Selon l’activiste trans Mikaelah Drullard, le film renferme ainsi ce « regard blanc occidental [qui] cherche à capturer une réalité du Sud global, sans procéder en amont aux études et consultations nécessaires. (…) Un film célébré par des Blancs en raison de leur ignorance eurocentrée, et répudié par celles et ceux qui se trouvent au plus proche des difficultés que le film cherche à représenter. » Le journal Prospect va dans le même sens en considérant que c’est : « un film sur les Mexicains, réalisé par des non-Mexicains, à destination d’un public non-mexicain. » Le critique Alonso Día de la Vega (revue Gatopardo) voit dans le film d’Audiard « un instrument du néolibéralisme, qui intègre les revendications des minorités sexuelles et/ou racisées, pour mieux légitimer la même élite – blanche – qui écrit et produit la majorité des films de Hollywood et d’Europe. »
Et comme pour illustrer toutes ces critiques, l’actrice du film, Zoe Saldana, s’est lancée dans un discours pathétique après la réception de son prix aux Golden Globes : « Monsieur Audiard (…) je vous admire (…) vous êtes tellement chic et français. ». Quand une jeune femme Noire cire les pompes d’un vieil homme blanc.
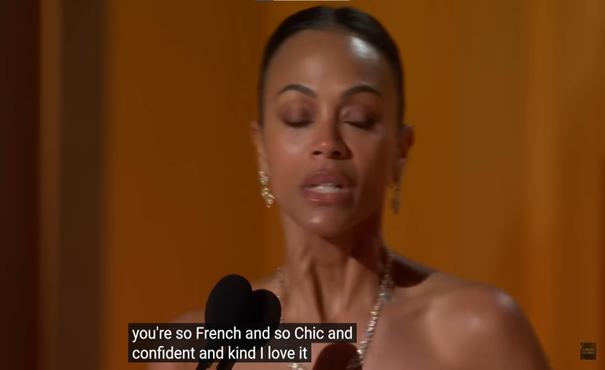
Figure 1 – capture d’écran du discours de Zoe Saldana aux Golden Globes
Poupées russes
Comme si cette couche raciste et européocentrée du film ne suffisait pas, des propos de l’actrice Karla Sofía Gascón, relevés sur Twitter il y a entre cinq et neuf ans, sont réapparus. Ceux-ci visaient notamment les musulman·es, ou encore George Floyd et le mouvement Black Lives Matter.
A ressurgi également la déclaration suivante du réalisateur français Jacques Audiard : « L’espagnol est une langue de pays modestes, de pays en développement, de pauvres et de migrants. ».
Tout ceci nous rappelle qu’on peut difficilement séparer les artistes et leurs œuvres.
Il ne faut pas s’émouvoir outre mesure des déclarations de l’actrice Karla Sofía Gascón (d’autant que l’affaire a sans doute pris une proportion plus importante du fait de sa transidentité) : l’islamophobie est un vieux sport mondial qui fait battre le cœur des structures politiques, sociales, médiatiques et psychiques du Monde Libre. Les artistes, qui symbolisent la libre créativité, n’ont donc aucune raison de se priver.
Tous les mêmes !!!
Ces derniers mois, différents cinéastes ont d’ailleurs sauté sur cette occasion d’exercer la libre expression raciste défendue récemment par le vice-président étasunien J.D. Vance. Voici quelques films dont la structure narrative est un quasi copié-collé du film « Emilia Perez » :
- Il suffit de remplacer « Emilia Perez » par « Touda », de remplacer « Mexique » par « Maroc », et « narco-trafic » par « prostitution », et on obtient le dernier film de Nabil Ayouch, Everybody Loves Touda. Un film qui suit bien le schéma narratif proposé ci-dessus : un cinéaste blanc produit un film raciste à destination d’un public blanc européen, dans lequel la question féministe sert de piédestal à la domination politico-culturo-symbolique occidentale.
• Il suffit de remplacer « Touda » par « Rabia », de remplacer « Maroc » par « Syrie », « prostitution » par « endoctrinement/terreur islamique » ou « prostitution islamique » (au choix), et on obtient le film de Mareike Engelhardt, Rabia. Là encore, le schéma narratif est identique : une cinéaste blanche produit un film raciste à destination d’un public blanc européen, où la question féministe sert de prétexte à la domination politico-culturo-symbolique occidentale. - On peut remplacer « Rabia » par « Souleymane », remplacer « Syrie » par « Noirs », « endoctrinement islamique » par « violence/exploitation de Noirs par d’autres Noirs » ou « esclavagisme libyen » (au choix), et on obtient le dernier film de Boris Lojkine, L’histoire de Souleymane. Ce film coche aussi toutes les cases mentionnées : un cinéaste blanc produit un film raciste à destination d’un public blanc européen, et la question migratoire est utilisée pour légitimer la domination politico-culturo-symbolique occidentale.
Pour vous exercer, vous pouvez par exemple essayer avec Io Capitano (Matteo Garrone, 2023)
« Zone d’intérêt » et territoires occupés
Lors de la récente cérémonie des Césars, où il a reçu le César du meilleur film étranger pour son film « Zone d’intérêt », le réalisateur Jonathan Glazer a déclaré : « Aujourd’hui la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza ». Le réalisateur anglais ne faisait sans doute pas directement référence à l’industrie cinématographique, mais on est obligé de constater que ces derniers mois, de nombreux films ont effectivement utilisé le thème de la Shoah :
- On peut d’ailleurs commencer cette liste par le film de Jonathan Glazer lui-même : Zone d’intérêt, qui dépeint la vie autour du camp d’Auschwitz.
- Réalisé par Brady Corbet, The Brutalist (2024) raconte la vie d’un architecte hongrois qui fuit la Shoah pour se réfugier aux USA.
- Réalisé par Michel Hazanavicius, La Plus Précieuse Des Marchandises (2024) est un film d’animation qui raconte l’histoire d’un bébé juif recueilli par des bucherons.
- Réalisé par Andres Veiel, le documentaire Riefenstahl (2024), décrit le déni de l’actrice/réalisatrice Leni Riefenstahl face aux archives témoignant de sa collaboration avec le régime nazi.
- Le réalisateur Tim Fehlbaum apporte une variante et traite directement du terrorisme palestinien (la prise d’otages des JO de Munich de 1972) dans son récent film « 5 septembre » (2024), un « 5 septembre » qu’on doit sans doute prononcer « 7 octobre ».
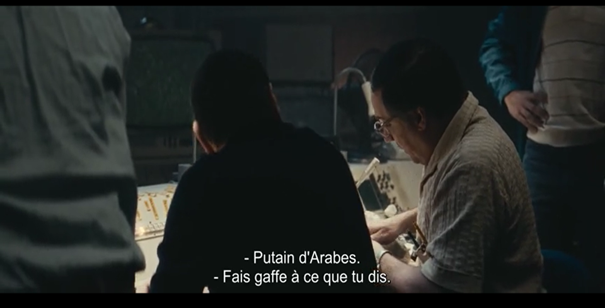
Figure 2 – Capture d’écran du film « 5 septembre »
• Réalisé par Zar Amir Ebrahimi et Guy Native, le film Tatami (2023) nous donne une leçon sur l’autoritarisme patriarcal du régime iranien (vs la liberté israélienne). À la fin du film, l’héroïne, une judoka iranienne, refuse d’obéir au pouvoir iranien et accepte d’affronter une judoka israélienne. Pour célébrer cette libération, l’Iranienne retire son voile. Et cela, le monde occidental adore.
Comme le suggère Jonathan Glazer, ces différentes productions servent sans doute très bien la hasbara (propagande sioniste à destination de l’étranger).
Sortir des salles obscures ?
En 1946, le Tribunal de Nuremberg condamna Julius Streicher, le propriétaire d’un journal antisémite, pour son rôle durant la Shoah. En 2015, le Tribunal pénal international pour le Rwanda condamna la radio Mille Collines et le journal Kangura pour leurs rôles dans le génocide. Aujourd’hui, un Craig Mokhiber (ancien juriste des Nations Unies) se demande si les médias occidentaux ne se rendent pas complices du génocide à Gaza (en raison de la couverture biaisée et de la déshumanisation des Palestiniens), et s’ils ne devraient pas rendre des comptes un jour devant la justice.
On ne va bien entendu pas attendre une improbable condamnation des médias occidentaux mais on n’oublie pas, on ne pardonne pas les invasions et les massacres commis sur les populations irakiennes, afghanes, libyennes,…On peut par contre inviter ici l’industrie cinématographique et plus modestement les salles de cinémas belges (et particulièrement les salles « indépendantes ») à réfléchir leur rôle dans la propagation de schémas racistes, islamophobes et prosionistes.
Aleph Walden pour Bruxelles Panthères

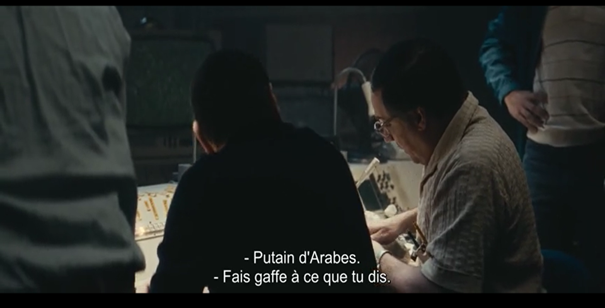

Salut à vous,
Petit retour sur Bruxelles 1960-70 suivi de Sing Sing Song
https://www.youtube.com/watch?v=WTNWXFqYtDA
Bonne écoute
Merci de votre travail!
Anne Fz
Nb: Bruxelles 1960-70. Entre soleils mouillés, paroles en exil et nuits hallucinées, beaucoup parmi nous sont partis trop tôt.
Au-delà de nos joies partagées, en toile de fond, un sentiment d’insécurité, un système répressif, une violence suspendue.
Hommage aux ami.es disparu.es, aux militant.es, aux musicien.es, aux poètes qui nous ont accompagné.es. A Claude Nougaro dont la voix a réchauffé des enfants perdus.
Derroll Adams: banjoïste, chanteur, victime du maccarthysme, il quitte les Etats-Unis dans les années 50. https://www.derrolladams.org/index.html
Marcinelle: ville wallonne où s’est produit, en 1956, la plus grande catastrophe minière dans l’histoire de la Belgique au « Bois du Cazier » https://www.charleroi-decouverte.be/p…
Les Asturies: bassin minier du Nord de l’Espagne d’où viendront de nombreux mineurs après 1956 pour travailler dans les charbonnages belges. https://medialatitudes.be/nl/le-temps…
Berkane, Jerada, Tanger, Al Hoceima: villes du Nord du Maroc https://www.rtbf.be/article/au-maroc-…
CLOTI: « Comité de liaison des organisations des travailleurs immigrés » mis en place en 1971 par plus de 80 organisations de travailleurs immigrés. « Le Cloti servait aussi de coordination pour les organisations démocratiques d’immigrés qui luttaient contre la dictature et la répression dans les pays d’origine (Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Maroc). Contrairement à la « génération invisible » de leurs parents, les générations nées ici n’acceptent pas, à juste titre, d’être discriminées.» Abderrahmane Cherradi, ancien permanent syndical FGTB Bruxelles
Amilcar Cabral, fondateur du P.A.I.G.C. Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, qui rendra l’indépendance à ces 2 Etats colonisés par le Portugal.
En 1965, Claude Nougaro enregistre Sing Sing Song, chanson adaptée du standard jazz Work Song composée par Nat Adderley. Celui-ci s’est inspiré d’un souvenir d’enfance: un groupe de prisonniers enchaînés ensemble, a chain gang, en train de paver la rue devant la maison de ses parents. Il l’enregistre en 1960 avec Wes Montgomery à la guitare, Bobby Timmons au piano, Percy Heath à la basse et Louis Hayes à la batterie. Oscar Brown, écrivain, poète, interprète et militant des droits civiques, en écrira les paroles.